Bernard Wolfer, président du Cercle Condorcet de Paris présente les trois intervenants:
L’émancipation entravée, l’idéal au risque des idéologies au XXème siècle, avec Michèle Riot-Sarcey.

Agrandissement : Illustration 1

Michèle Riot-Sarcey est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris VIII-St Denis. Historienne du politique, de l’Utopie et du genre. Elle a notamment publié 1848, la révolution oubliée (avec Mauricio Gribaudi, 2008), une Histoire du Féminisme (la Découverte 2002), Le réel de l’Utopie (Albin Michel, 1998). Son dernier ouvrage : L’émancipation entravée, l’idéal au risque des idéologies du XXème siècle (la Découverte, 2023). Elle est déjà intervenue au Cercle Condorcet de Paris sur le thème de l’utopie, en 2014.

Agrandissement : Illustration 2

Qu’est devenue la liberté ? Ainsi commence le dernier ouvrage de Michèle Riot-Sarcey. Depuis plus de deux siècles, l’idée d’émancipation, des personnes et des peuples, est au cœur des mouvements révolutionnaires, mais aussi d’acquis obtenus par des luttes et a permis de notables avancées. Pour autant les idéologies qui dominent régulièrement la marche des sociétés réduisent la portée des émancipations quand elles ne les détruisent pas. 1789 a conduit à l’Empire et aux guerres napoléoniennes. 1848, première république démocratique et sociale, s’est terminée par une répression féroce et l’essor d’un libéralisme très conservateur, que Napoléon III a consolidé. La Commune de 1870 a ouvert de nombreuses formes d’émancipation (éducation, égalité homme-femmes, etc.), mais que la III ème République a mise pour la plupart sous le boisseau. Les conquêtes ouvrières ou féministes ont mis plus d’un siècle pour se réaliser, encore imparfaitement. Ce qui est le plus troublant c’est non seulement la capacité des réactions conservatrices à les empêcher ou à les réduire, mais aussi les idéologies supposées libératrices à les enfermer dans des carcans qui en limitent la portée. C’est vrai des idéologies socialistes, comme des idéologies « libérales » ou des idéologies structuralistes, des mouvements nationalistes comme des internationalistes.
L’intérêt de l’ouvrage de Michèle Riot Sarcey est de revisiter, après le 19ème siècle dont elle a étudié la révolution de 1848, notre XX-ème siècle et ses grands mouvements d’émancipation des personnes et des peuples. Son ouvrage et sa réflexion se présentent comme Les Mémoires (au sens historique) des moments d’émancipation et des revers que les idéologies dominantes leur font subir. De l’affaire Dreyfus à mai 68, du mouvement ouvrier américain à la confiscation des expériences ouvrières par les avant-gardes, d’Hiroshima aux luttes anti coloniales. Et bien sur, les révolutions de liberté, réprimées partout dans le monde aujourd’hui. Michèle Riot-Sarcey place Condorcet comme le principal précurseur des idées émancipatrices (femmes, esclavage, éducation, etc.), notamment dans son dernier ouvrage sur le progrès humain. Elle rappelle opportunément combien la plupart des grands mouvements d’émancipation se sont inspirés, consciemment ou non, des grands principes qu’il a porté. Ceci mérite d’être souligné...
Tous les Cercles Condorcet travaillent sur l'Europe. C'est le thème de prédilection du Cercle Condorcet de Paris. Dès 1991, quatre ans après sa fondation, un séminaire co-organisé avec le Monde Diplomatique et l’Evènement Européen, traitait d’Une certaine idée de l’Europe. Tout dernièrement, le 16 mars 2023, Bernard Guetta présentait ses réfléxions sur le thème "Retour de la guerre en Europe : Russie-Ukraine Une guerre d’un autre temps? Ou une guerre de temps nouveaux?"
"A l’Est du nouveau, mais l’Europe peut-elle encore grandir ?" est le sujet approfondi par Pierre Vimont, ambassadeur de France, familier depuis des années du Cercle de Paris.

Pierre Vimont a été représentant de la France à Bruxelles, ambassadeur à Washington, directeur de Cabinet du ministre des Affaires Européennes, puis du ministre des Affaires Etrangères, enfin Secrétaire Général exécutif des affaires extérieures de l’UE. Sa réputation de négociateur en situations difficiles en fait un bon expert de l’Europe. Il a été représentant du Président de la République en Russie. Il est membre de la fondation Europe Carnegie. Il enseigne à l’université Columbia à New-York.

L’Europe, sous la forme d’une union de pays, s’est construite aux lendemains de la seconde guerre mondiale pour créer un espace de paix et de prospérité. On peut considérer que les six pays fondateurs ont réussi, même si aujourd’hui les critiques ne manquent pas. Parvenue un temps à 12, puis à 15, elle s’est vue brusquement élargie aux pays de l’est de l’Europe issus, pour certains, de l’ex-Union soviétique, à partir de 2004. Depuis bientôt vingt ans ces pays constituent, par leurs origines, leurs histoires, leurs différences économiques et culturelles, un apport particulier à l’Union Européenne. Leur appartenance au monde communiste pendant plus de cinquante ans a laissé des empreintes et on observe des divergences entre l’est et l’ouest mais aussi avec le sud de l’Europe qui bousculent parfois les idées courantes sur la construction européenne et ses effets de convergence, jusqu’à supposer que leur entrée a affaibli l’Europe en termes démocratiques et sociaux. Le départ de la Grande Bretagne n’a pas manqué de souligner ce déséquilibre, et les risques d’éclatement qui pourraient en résulter. D’autant que les politiques libérales en économie, n’ont pas toujours favorisé ces pays, accroissant les divergences sociales, devenues difficiles à combler.
L’agression de l’Ukraine par la Russie a montré une adhésion forte, à quelques rares exceptions, au soutien politique et militaire contre la Russie. Les pays de l’est ont ainsi confirmé leur attachement à la plupart des valeurs démocratiques « occidentales », même si parfois elles s’en distinguent sur certains points (notamment par « illibéralisme »). Certes, on peut, en matière de défense, estimer que l’OTAN prévaut sur l’UE. Mais à regarder de plus près, ce sont aussi les soutiens économiques de l’UE, en période de crise, et ses décisions en matière de défense qui déterminent l’adhésion de ces nouveaux pays. Plus encore, ils manifestent parfois une volonté de leadership pour défendre des intérêts communs, montrant ainsi leur intégration aux processus européens. Le fait d’être en première ligne près de la Russie est sans doute un facteur déterminant. Vingt ans après, l’élargissement à l’Est est-il pour autant signe de renouveau ? La question est ouverte. L’Union Européenne peut-elle, avec les menaces à l’Est, fonder une alternative aux tendances nationalistes, populistes et autoritaires qui se manifestent un peu partout dans le monde ? On dit souvent que l’Europe se construit dans les épreuves : est-ce encore le cas, et vers quoi ? Peut-elle représenter encore un modèle et un projet politique suscitant le soutien des peuples de l’Europe ?
L’énergie, le débat public et la mer, avec Francis Beaucire

Agrandissement : Illustration 6

Francis Beaucire, Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de Géographie, docteur en Géographie et Aménagement, a consacré l’essentiel de son activité aux relations entre réseaux et territoires, notamment dans la perspective de l’écologie urbaine puis du développement durable. Après avoir présidé la commission Eolien Normandie, il a présidé la commission particulière Oléron Aquitaine Sud.
Le changement climatique bouscule notre rapport à l’énergie, sa production comme sa consommation. Il en fait un débat non pas seulement d’ingénieurs, mais un débat de société, notamment parce que l’énergie a partie liée, une fois de plus mais une fois nouvelle, avec mers et océans. L’abandon des énergies fossiles semble inéluctable, parce qu’elles sont l’une des causes majeures du changement climatique. L’énergie nucléaire, bien qu’elle puisse encore se prévaloir de sa neutralité sur l’effet de serre, est discutée. Dès lors les énergies renouvelables présentent les plus sérieux atouts pour fournir nos besoins présents et futurs. Le vent et le soleil en sont les sources privilégiées. Mais elles sont l’objet de controverses quant à leur usage.
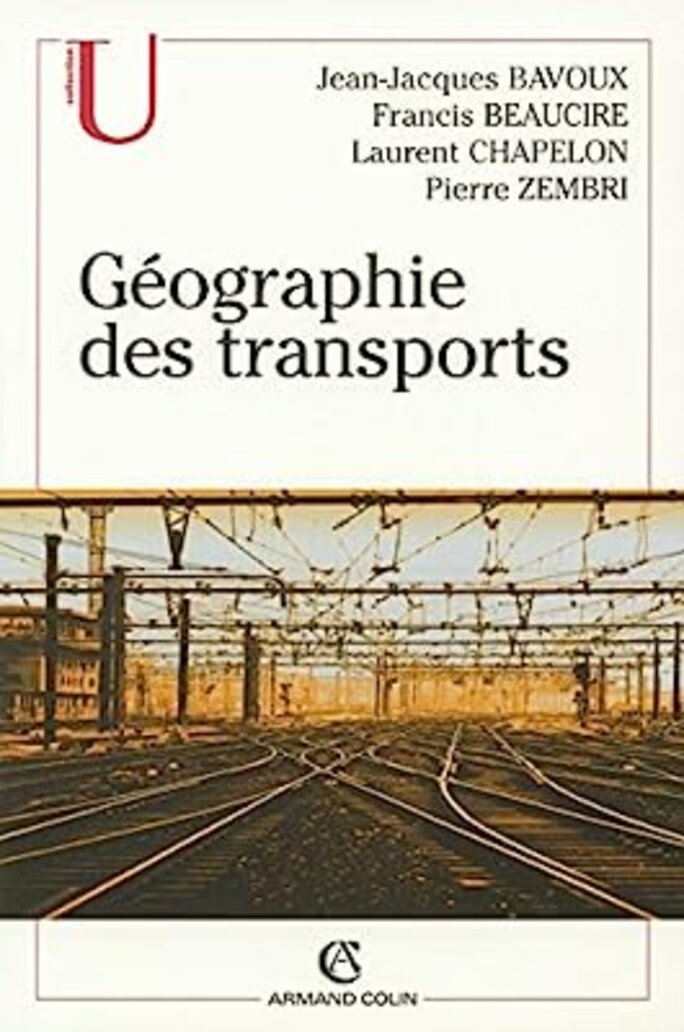
Sur des plans différents, certaines controverses portent sur leur consommation de métaux rares et d’énergie fossile pour les fabriquer. D’autres sur leurs impacts sur la nature. En particulier sur les paysages et leurs habitats. Ils sont l’objet de débats publics. Ils permettent à ceux qui seront touchés par l’implantation d’éoliennes de donner leur avis et ainsi, peut-être, d’agir sur la prise de décision. Ce débat de société est-il aujourd’hui à la hauteur des enjeux ? Permet-il de construire un consensus sur les modes de production et de consommation d’énergies soutenables ? Quelles places pour les citoyens, mais aussi les « objets » de nature que sont les animaux, les végétaux, les paysages dans ces débats? Peut-on élaborer, entre technique et nature, un commun nouveau ? Francis Beaucire, géographe, professeur des universités a présidé des débats publics sur l’Eolien en mer. Il nous a exposé ce que son expérience permet de penser de ces débats publics, et, notamment, de l’éclairage qu’ils procurent sur les possibilités de la gestion future de l’énergie.



