Alice Béja (Paris III Sorbonne-Nouvelle) s'étonne que le projet du gouvernement concernant le statut des enseignants-chercheurs propose d'alourdir la charge d'enseignement pour ceux dont les travaux n'obtiennent pas suffisamment de reconnaissance, ce qui équivaut à considérer que transmettre le savoir est une sanction.
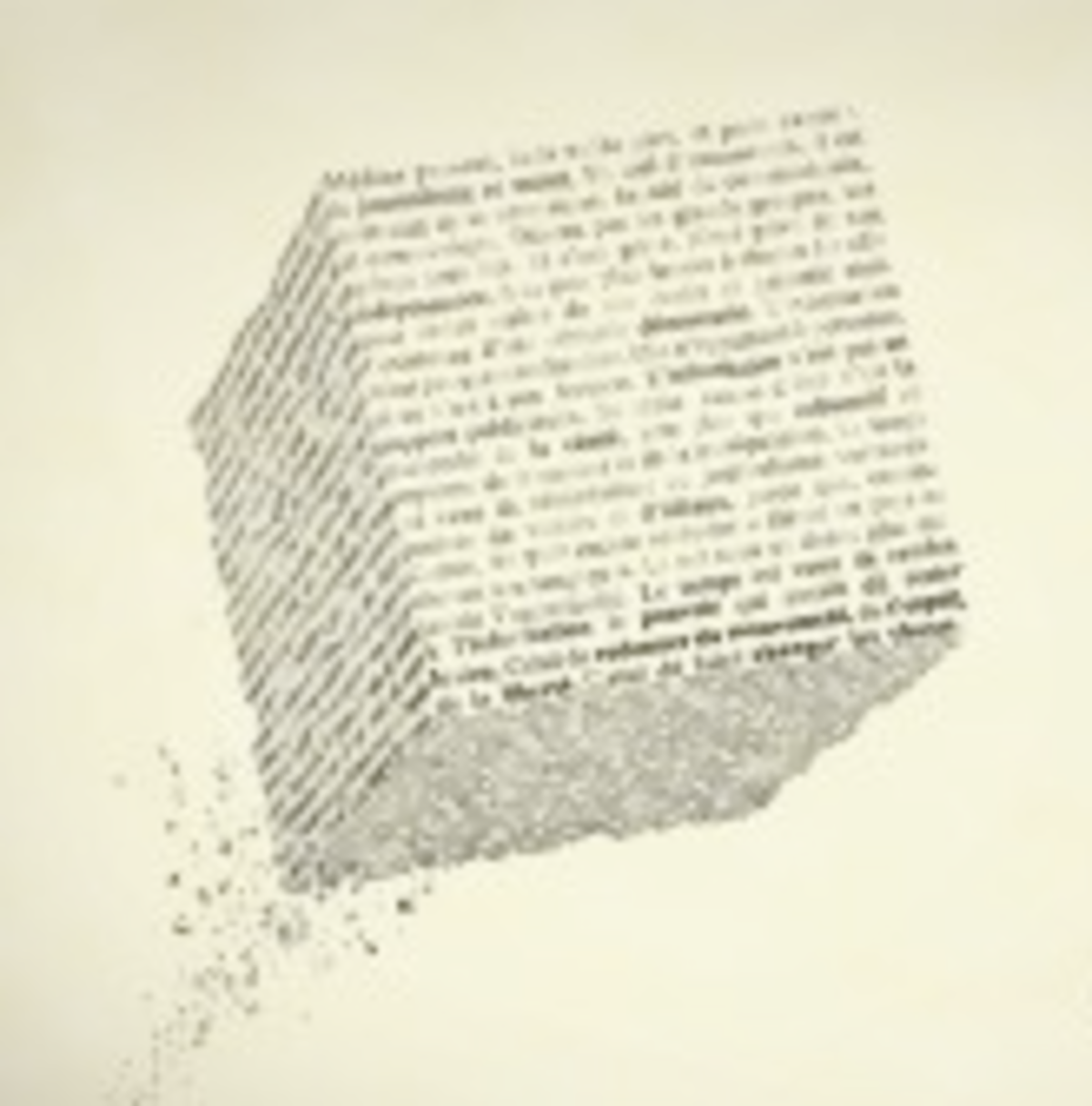
De nombreux éléments du décret de modification du statut des enseignants-chercheurs ont provoqué, avec raison, la colère de la communauté scientifique. Il convient de revenir sur l'un d'entre eux, la modularisation des services, qui révèle l'estime dans laquelle le gouvernement tient « les jeunes » – malgré l'octroi récent d'un haut commissariat leur étant consacré – ou du moins une partie d'entre eux, les étudiants.
Le projet de décret stipule en effet que la charge d'enseignement des enseignants-chercheurs pourra être alourdie si ceux-ci ne sont pas suffisamment performants dans leur recherche. Outre les problèmes soulevés par l'évaluation de la recherche – démontrés par les récents débats autour de la bibliométrie – cette mesure révèle une conception pour le moins curieuse de l'enseignement à l'université.
Dans l'hypothèse où le gouvernement aurait réellement pour objectif de valoriser les « bons » chercheurs – et non pas simplement celui de faire des économies en donnant aux universités la possibilité d'augmenter selon leurs besoins les heures d'enseignement afin d'éviter de créer des postes – comment expliquer qu'il estime que les étudiants ne méritent que les « mauvais » chercheurs?
L'enseignement deviendrait alors une sanction, une punition pour celles et ceux qui ne réussissent pas assez bien dans leur recherche. Ils seraient condamnés à passer des heures à transmettre leur savoir à des jeunes gens qui, pour reprendre la rhétorique gouvernementale, ne sont jamais que l'avenir de la nation.
Lorsque l'on s'engage dans des études longues, souvent difficiles à financer, dans l'espoir (qui s'amenuise de jour en jour) d'obtenir un poste dans le supérieur, ce n'est pas pour rester seul dans son bureau (quand on a la chance de disposer d'un bureau, ce qui est rare) toute la journée. C'est aussi pour se retrouver devant des étudiants, pour leur transmettre un savoir, des outils d'analyse, pour leur permettre d'acquérir des connaissances, mais aussi un certain esprit critique.
Le système tel qu'il existe aujourd'hui, la plupart des universitaires en conviennent, est loin d'être parfait. Mais les projets de réforme actuels tendent à renforcer ses travers (localisme, précarisation des personnels, valorisation exclusive de la recherche au détriment de l'enseignement...) plutôt qu'à les corriger.
Le personnel des universités est déjà fragmenté en une myriade de statuts ; sa précarisation grandissante rend les conditions d'enseignement de plus en plus difficiles. Comment se concentrer sur des projets à long terme et construire des parcours pédagogiques cohérents lorsque l'on doit à chaque instant se demander si l'on sera là pour les mettre en pratique?
Comment susciter des vocations, alors même que ceux qui se sont engagés dans la voie de l'enseignement supérieur ont souvent l'impression d'avoir emprunté une impasse?
Les réformes sont nécessaires. Mais elles doivent être précédées d'une large concertation, pour éviter l'urgence, les pressions, et les résultats bâclés. Concertation et écoute sont des mots que ce gouvernement – et pas uniquement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche – semble avoir du mal à saisir.
____
Alice Béja est allocataire monitrice à l'université Paris-III Sorbonne-Nouvelle



