
Le philosophe russe Grigory Pomeranz est décédé le 16 février à Moscou. Lasha Otkhmezuri et Jean Lopez l'avaient longuement interviewé en janvier 2011, pour leur livre Grandeur et misère de l’Armée rouge. Entretien-portrait d'un homme qui a traversé le siècle soviétique et dont la pensée a soutenu les dissidents.
Grigory Pomeranz était le philosophe le plus « pur » de la Russie, a-t-on dit de lui en faisant allusion à son mysticisme et à son ascétisme. Il avait débuté en philosophie avec Marx, qu'il avait abandonné après la bouleversante rencontre de Pascal qui lui révéla son propre néant. Epouvanté, il trouvait refuge chez Tolstoï et Dostoïevski. Grigory Pomeranz est décédé le 16 février à Moscou, quelques semaines avant de fêter ses 95 ans.
Petit, frêle, très doux, il souriait presque à chaque fin de phrase. Son russe et ses manières étaient plus ceux d'un XIXe siècle policé que ceux d'un homme qui a traversé le siècle soviétique, l'indicible carnage de la Seconde Guerre mondiale et connut le Goulag. Ses premiers livres ont été publiés en Occident, en russe, et n'auront droit de cité dans son pays qu'en 1990... pour ses 72 ans. Marginalisé, oublié, il se contentait de donner quelques conférences à un petit groupe d'adeptes en général aussi mal à l'aise que lui dans la Russie consumériste. Il avait pourtant mérité un chapitre entier dans les mémoires d'Andréi Sakharov qui écrivait :
« Les exposés de Grigory Pomeranz, ancien prisonnier politique et spécialiste de philosophie orientale, étaient particulièrement profonds et intéressants. Je fis sa connaissance à cette occasion et je fus frappé par son érudition, sa largeur de vue, son humour sarcastique et son « esprit universitaire » dans le bon sens du terme. […] Pour l’essentiel, les thèses de Pomeranz, telles que je les ai comprises, étaient les suivantes : la valeur exceptionnelle de la culture créée par les efforts conjugués de toutes les nations de l’Orient et d’Occident durant des millénaires ; la nécessité de la tolérance, des compromis, de la largeur de vue ; […] la stérilité et la pauvreté des nationalismes étroits, des théories du terroir. […] Il me semble que l’apport de Pomeranz à la vie spirituelle de notre temps n’a pas encore été apprécié à sa juste valeur. »
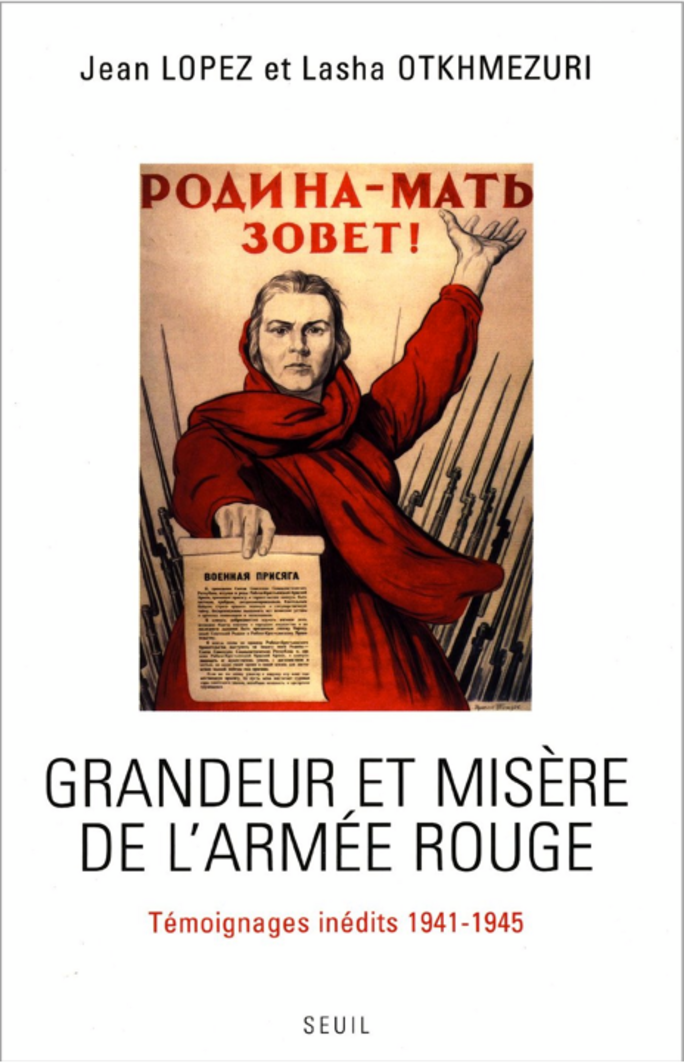
Agrandissement : Illustration 2
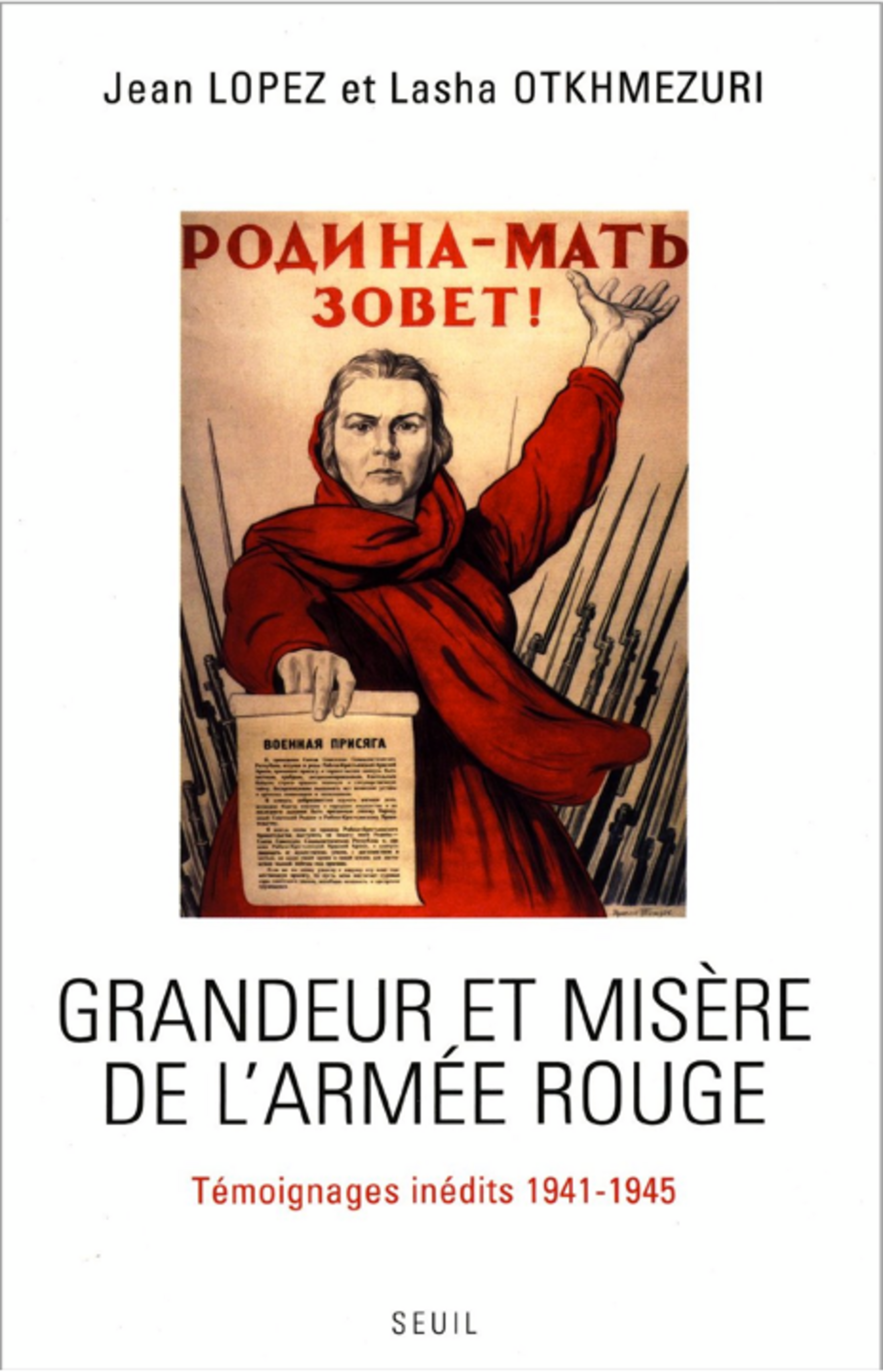
La pensée de Grigory Pomeranz a soutenu le mouvement des dissidents dans les années 60, 70 et 80. Peu nombreux sont les Russes à se souvenir quelle a alors été son influence sur la vie intellectuelle de Leningrad et de Moscou.
Pour notre livre Grandeur et misère de l'Armée rouge (Le Seuil, 2011), nous l'avions longuement rencontré, en janvier 2011.
Voici l'interview:
Vous êtes né à Vilno [aujourd'hui Vilnius, Lithuanie] en 1918, au moment où cette ville sort de l'empire russe et est disputée entre Allemands, Polonais et Lithuaniens. Et votre famille choisit, en 1925, d’émigrer en Russie soviétique. Etait-ce un choix politique ?
Ça a été un choix forcé. Mon père était membre du Bund, le parti socialiste des travailleurs juifs. A cause de cette activité politique, il a été obligé de quitter Varsovie et de s’installer à Vilno, où il a connu maman et l’a épousée. Vilno, la ville où j’ai passé mon enfance, avait une population juive pour la moitié. Ces juifs étaient en grande majorité très pauvres et nous-mêmes crevions de faim. Certains militants du Bund ont accepté le système soviétique, d'autres l'ont rejeté. Mon père est resté au milieu – il n’est pas devenu membre du Parti communiste, mais de temps en temps il rendait service aux Rouges, ce qui déplaisait aux Polonais. Nous avons dû pour cette raison quitter Vilno et nous installer à Moscou. J’y ai très vite oublié le yiddish au profit du russe que je parlais cependant avec un accent juif. Les enfants m'obligeaient à prononcer kukuruza (maïs), ce que je n'arrivais pas à rendre, et alors ils me battaient.
Ma mère était comédienne. En 1930, elle est partie à Kiev pour entrer dans une troupe de théâtre juif. J’avais 12 ans et pour moi ce départ marque la fin de mon enfance. En janvier 1934, je suis allé la voir à Kiev. C’était l’époque de la grande famine en Ukraine. Sur le quai, devant la porte de sortie, une paysanne était allongée à même le sol, avec son enfant sur le ventre. Ils étaient en train de mourir. Pour continuer mon chemin, je devais l'enjamber. Autour de moi, les passants, habitués à ce spectacle, passaient par-dessus sans plus de manières. Je suis resté figé. La femme m'a regardé et j'ai lu dans ses yeux que je pouvais y aller. Plus de 75 ans ont passé. J’ai oublié les rôles que maman a joués sur les planches mais le regard de cette paysanne agonisante est resté gravé dans ma mémoire.
1934, c'était aussi l’année du premier congrès des écrivains, où Pasternak a annoncé « le pire est derrière nous », « le socialisme a gagné » et « tout ira bien ». C’était aussi l’année du XVIIe congrès du parti, le « congrès des vainqueurs » selon la version officielle, durant lequel Staline a annoncé que l’URSS, de pays médiéval et agricole, est devenue un pays avancé et industrialisé et que l'étape socialiste est déjà franchie. En fait, ce congrès va entrer dans l’histoire comme le « congrès des fusillés », car presque tous les délégués présents seront passés par les armes pendant la Grande Terreur (1937-38). Avant 1934, on nous annonçait qu’on posait les fondations du socialisme, et puis, brusquement, on nous a déclaré que le socialisme était déjà construit. Comme on affirmait ça avec toute l'insistante omniprésence de la propagande, nous l’avons accepté comme la pure vérité.
Vous êtes plutôt un spécialiste de littérature. Qu’est-ce qui vous a poussé vers la philosophie ?
Ma mère... [Il sourit]. Un jour, elle m’a demandé : « Grichenka, est-ce vraiment le socialisme ? C’est pour ça que le peuple était prêt à se sacrifier en allant au bagne et à la potence ? » Je lui ai répondu : « Bien sûr, puisque nous avons la propriété collective des moyens de production.» Mais en disant cela, j’ai fait une grimace et un point dans ma poitrine, ce que j’appelle le chakra du cœur, s'est manifesté comme un signal douloureux : tout cela est faux, tout cela n'est que mensonge. Je n’ai pas dit un mot, mais je l’ai senti. Et bientôt j’ai commencé à chercher des arguments pour prouver que nous n’avions pas construit le socialisme. Quand, finalement, j’ai été arrêté, on m’a montré des rapports de mouchards de mon entourage citant mes propos sur ce point. Par exemple que le socialisme n’existe pas chez nous, que les paysans et les ouvriers vivent plus mal qu’en 1927. [Il sourit]. Voilà, c’était mon approche très naïve de ce problème. J'ai compris à cette époque que je peux avoir des intuitions capables de renverser tous les systèmes idéologiques. C'est après avoir fait cette découverte que j’ai décidé d'entreprendre des études de philosophie et de tout vérifier avec mon chakra.
Pardonnez-moi d'insister, mais vous êtes plus connu comme spécialiste de littérature russe que comme philosophe...

Oui. Ce virage, c'est à cause d'un coup de foudre. J’ai lu Tolstoï et Dostoïevski et je suis tombé fou de ces deux auteurs. J’ai découvert chez eux l’horreur métaphysique devant l’éternité, la conscience que l’homme est une poussière infime et futile, qu'il ne vaut rien. S’il y a l’Infinitude, Je n’existe pas et si J'existe l'Infinitude n'existe pas. A 20 ans, j’ai réussi pendant trois mois à me concentrer sur cette question et finalement j’ai reçu une lumière. J’ai compris que J’existais. C’était en 1938, durant la Grande Terreur avec ses procès interminables, au sein même de notre institut de philosophie. Mon père a été arrêté en 1938. Une blague circulait à l'époque. Nous vivons comme les passagers d'un bus : la moitié sont assis, l'autre moitié attend en tremblant que les sièges se libèrent [en russe, être assis signifie également être en prison]. Je ne voulais pas ressembler à un passager debout, j’ai voulu rester moi-même. Ce refus m'a jeté dans les bras de Tolstoï et de Dostoïevski.
A cette époque, j’ai senti que mon esprit gagnait en force. Je ne voulais pas reculer devant la « Peur de l'infinitude de Tolstoï ». Je suis parti à l'assaut de son Journal d’un Fou et des Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Mon travail sur Dostoïevski a été condamné par la faculté. Mais j’ai eu la chance que cette condamnation soit intervenue au printemps de 1939, pendant le court recul de la terreur, provoquée par la grande fatigue de la machine terroriste elle-même. Au lieu d’être arrêté, j’ai été placé sous surveillance. J'ai quand même montré ce travail condamné à Léonid Pinski, un grand professeur, miraculeusement demeuré vivant et libre. A son tour, il a montré mes feuillets à son ami Vladimir Grib, et Grib, en pleine nuit, est allé chez Pinski dire son souhait de devenir mon maître. Grib ne m’enseignait rien. Il me posait une question et me laissait parler. Dès que je commençais à sortir des profondeurs pour remonter vers la surface des choses, il m’arrêtait d'un signe, d'un mot, d'une grimace. J’ai retenu ces entretiens avec Grib et notamment sa maïeutique, que j’ai reprise deux décennies plus tard avec mon épouse Zinaïda Mirkina.
En quoi la guerre a-t-elle marqué votre pensée ?
C’était plutôt ma pensée qui a marqué la guerre... Soyons sérieux... J'ai été mobilisé comme collaborateur littéraire non titulaire à un journal de division d'infanterie de choc. Il était très difficile d’écrire sur les exploits de nos soldats dans une guerre qui ressemblait à un carnage sans nom.
Lors de la première bataille, quand les avions allemands nous pilonnaient sans pitié, j’ai eu très peur. Je voulais être avec ma mère. Et puis je me suis rappelé de cette expérience dont j'ai parlé tout à l'heure et je me suis dit : si j’arrive à dépasser la peur de l’infinitude, n’est-il pas possible de dépasser la peur des bombardiers allemands ? La peur a disparu jusqu’à la fin de la guerre. Cette peur à disparu à tel point que je pouvais regarder le canon allemand en fumant, un peu comme Lermontov pendant son duel. [Il sourit].
Mais ma volonté, mon courage, se sont effondrés après la guerre. J’ai perdu mon ossature, je suis devenu une poule mouillée. Je n'étais pas le seul à vivre cet affaissement. Beaucoup, parmi les soldats et les officiers démobilisés, ont perdu cette élasticité de la volonté acquise pendant la guerre.
Votre arrestation, en 1949, a-t-elle accentué cette dépression ?
Non au contraire. Je me suis secoué après mon arrestation. Je l'ai vécue comme une déclaration de guerre. J'ai remis mes effets militaires et je me suis senti de nouveau dans le combat – et, de nouveau, j’ai retrouvé la volonté et le courage. En fait, avant l’arrestation je me trouvais dans une situation artificielle, je n’appartenais ni à une rive, ni à l’autre. Et une fois arrêté, je me suis retrouvé tout de suite moi-même.
Dans les camps, il y avait un type qui injuriait sans arrêt les prisonniers. Je l’ai pris pour un gardien et je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Ce n'était pas un gardien mais un criminel, qui collaborait avec l’administration du camp et en contrôlait certaines parties. C'était un grand, très costaud. Et vous voyez à quoi je ressemble… Il a levé le tabouret pour me casser la tête. Sans essayer de me défendre, je l’ai fixé dans les yeux. Il m’a regardé un moment et puis il a jeté le tabouret et est sorti. Je pense qu’il n’a pas voulu ajouter encore dix ans à sa condamnation pour le meurtre d’un abruti. Après cette affaire, je suis devenu populaire parmi les prisonniers intelligentny. Ils venaient me voir. L’un d'eux était un ancien prof de philo, un copain de Boukharine ; il m’a dit qu’un poste de contrôleur des normes était libre. Je lui ai dit que je ne comprenais rien à tout cela. Nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes de Hegel et finalement il m’a dit : « Tu vas sûrement te débrouiller dans ce poste. » C'est comme ça que Hegel m'a sauvé la vie en me valant ce poste exempté de travaux pénibles. Je n'ai pas envie de raconter plus sur ma vie en camp qui d’ailleurs n’a pas duré longtemps – après la mort de Staline, en 1953, j’ai été libéré.
En sortant du camp, j’ai trouvé une place de prof dans une école de village, dans le sud de la Russie. Un de mes collègues m'a raconté qu’en 1933 ce village n’avait pas rempli le plan pour la récolte de céréales. Une expédition punitive a été envoyée par Moscou. Le village a été encerclé par l’armée et les paysans fusillés comme saboteurs. Cette exécution sommaire n’a pas augmenté la récolte…
En 1956, j’ai finalement obtenu le droit de retourner à Moscou. J'y ai trouvé le grand amour –Ira Mouraviova, poétesse et critique littéraire. A cette époque je n’écrivais toujours pas. Ira était très malade. Je n’avais qu’un souci, comment adoucir les dernières années de sa vie.
C’est la mort d’Ira qui m’a poussé vers l’écriture. J’ai voulu graver son image dans la littérature. A cette époque, la question de Job me tourmentait : je vivais avec l’impossibilité de vivre sans Dieu et en même temps l’impossibilité de L’accepter.
Mais cette histoire d'amour, c'était avant de connaître votre femme Zinaïda Mirkina, avec qui vous avez écrit plusieurs livres ?
Oui, juste avant. En fait, quelques mois après le décès d’Ira, on m’a demandé d’aller recueillir les vers d’une poétesse pour l’almanach d’Alik Ginsburg (1). Je suis allé visiter cette femme qui s’appelait Zinaïda Mirkina. Le premier vers qu’elle s’est mise à réciter était Dieu Criait. J’ai été abasourdi. Tout de suite, j’ai senti que cette femme vivait dans les grandes profondeurs, dans ces profondeurs autour desquelles je vagabondais, et où je n’arrivais pas à m’établir.

Pour moi, c’était un saisissement du réel, dont j’avais besoin. J’ai tout de suite compris : Dieu est partout. Il souffre avec tout le monde. Après cette rencontre, j’ai décidé de prendre le rôle de Grib. Pendant plusieurs mois, j’allais chez elle, elle me lisait ses essais, ses vers, et je l’écoutais en critiquant sévèrement. Nous avons commencé à vivre ensemble. Après un an de vie commune, j’ai senti son rythme et ce rythme m’a aidé à me retrouver – ainsi j’ai commencé à écrire des essais, à philosopher. Il était tard, j’avais plus de 40 ans. En fait, je ne philosophais plus, je répondais juste à ce qui me blessait, me heurtait. Et je m’arrêtais là où je n’étais plus sûr d’avoir raison. Je ne comprends pas la vie dans sa totalité. J’arrive à comprendre quelques nœuds de cette vie et je les décris. Le reste... Les autres vont se débrouiller avec…
Je restais complètement inconnu. Ce sont les tentatives de réhabilitation de Staline, en 1965, qui m’ont rendu célèbre. Cela s'est passé à une conférence de l’institut de philosophie, durant laquelle j’ai critiqué ces tentatives. Après mon discours, Vladimir Semitchastny, le grand patron du KGB, a appelé deux fois l’institut en exigeant que je sois dénoncé comme antisoviétique. Mais Tvardovski (2) m’a soutenu, il a accepté que mon intervention soit publiée dans sa revue. Le chef tout-puissant du tout-puissant KGB a été obligé de reculer. Sans l’expérience de la guerre, je n'aurais jamais eu le courage de faire cette intervention. Je pensais à ce moment-là que l’intelligentsia était contre les tentatives de réhabilitation de Staline et que mon intervention allait la réveiller. Mais ça n’a pas marché. Je n'ai été soutenu par quasiment personne, sauf un cinéaste, Romm, l’auteur de Fascisme Ordinaire. Malheureusement, en Russie, il y a eu beaucoup d'exemples de courage militaire, mais très peu de courage civil. Le mouvement des dissidents était minuscule. Et encore ce mouvement a connu beaucoup de faiblesses et de reculs. Tant d’exemples de sacrifice sur le champ de bataille. Et sur le champ civil, on ne faisait que se taire.
Parlons justement du mouvement de dissidence. Qui a eu le rôle le plus important : Sakharov ou Soljenitsyne ? Pour beaucoup, en France, il n’y a pas de doute que c’était Soljenitsyne, que c’est bien lui qui a donné le coup de grâce à l’eurocommunisme.
Au début, j’ai été ravi, comme tout le monde, par Une Journée d’Ivan Denissovitch, où Soljenitsyne ne tentait pas de faire une généralisation universelle, mais juste de décrire quelques facettes de la vie. C’était la voix de la vérité. Soljenitsyne était un homme très complexe. Chez lui, la vérité s’entrelaçait avec les idées fausses, provoquée par sa haine des juifs. C’est très curieux qu’il soit resté fidèle à cette haine jusqu’à sa mort, fidèle à la haine qu’il a éprouvée ce jour-là, alors qu'il avait 12 ans. Soljenitsyne était un homme ardent, passionné, avec ses raisons, et un homme impétueux avec ses torts. Soljenitsyne ne pouvait pas raisonner calmement. Il créait tout le temps des schémas, qui à l’époque nous rendaient heureux car il nous sortait du fossé où nous nous trouvions. Avec cette passion envahissante, Soljenitsyne était bien sûr le plus brillant. Il a laissé une trace complexe en moi. Je ne peux pas nier certains des ses mérites, mais en même temps, de temps en temps, il mentait avec insolence.
Il vivait à Rostov avec sa mère, une fille de famille riche considérée comme ennemie de classe. Son père était mort très tôt, en revenant de la Première Guerre mondiale. Sous les tsars, Rostov était fermé théoriquement aux juifs. Mais, en fait, les juifs riches pouvaient y habiter. Voilà pourquoi, dans la classe de Soljenitsyne, il y avait des enfants d'avocats juifs, de médecins juifs… Soljenitsyne était dans une situation paradoxale, lui petit-fils d’un riche Russe affamé parmi les juifs bien nourris. De son enfance, il a gardé le sentiment de vivre dans un monde entièrement injuste. Un jour, Soljenitsyne a traité de sale youpin un garçon de sa classe. Ils se sont battus. L’autre, aidé par un rival de Soljenitsyne, lui a finalement cassé la tête. La grande cicatrice qui barrait son front immense date de cette époque. Les deux garçons juifs devaient être expulsés de l’école, mais un autre juif, Micha Luxembourg, quelqu’un que j’ai bien connu et qui a été témoin de la scène, a rapporté que l’insulte antisémite était à l’origine du conflit. Dans les années 1930, l’antisémitisme était encore considéré comme un délit antisoviétique. Les deux garçons juifs ont été pardonnés mais Soljenitsyne, lui a été puni.
Quand j’ai appris tout ça, j’ai perdu le rapport passionné que j’avais avec lui. Quand j’ai lu ses remarques sur les juifs dans Le Premier Cercle, c’était l’autre Soljenitsyne qui parlait, ce n’était pas l'homme qui critiquait l’Etat soviétique, c'était l'homme qui se montrait aussi antisémite que l'était devenu l'Etat soviétique. Après le Premier Cercle, je lui ai écrit une lettre indignée. Il ne m’a pas répondu et nos relations se sont arrêtées là.
En qui concerne Sakharov, ses idées ont vieilli. Pensez donc qu'il croyait à la convergence des systèmes capitaliste et socialiste... Ce qui est resté, en revanche, c’est sa personnalité. Il a été vraiment un homme extraordinaire, tellement intègre et courageux. Je l’aime beaucoup. Sa mémoire m'est très chère.
Vous souvenez-vous de ce que son adversaire idéologique, Soljenitsyne, a dit de lui ? « Lorsque Lénine conçut et fonda, puis lorsque Staline développa et renforça le génial schéma d’un Etat totalitaire, tout avait été par eux prévu et mis en place pour que ce système pût subsister éternellement, n’évoluant que sur un geste de ses chefs, pour que ne pût retentir aucune voix libre et ne se faire jour aucun contre-courant. Ils avaient tout prévu, sauf une chose – le miracle, le phénomène irrationnel dont on ne peut prévoir les causes, ni le prédire, ni le contrarier. C’est un miracle de ce genre que constitua dans l’Etat soviétique l’apparition d’Andreï Dmitrievitch Sakharov. »
Vous avez dit tout à l’heure : « je ne philosophais plus, je répondais juste à ce qui me blessait, me heurtait. » Pendant les deux dernières décennies, il y a eu beaucoup d'événements qui auraient pu vous heurter, vous blesser, mais on ne vous entend pas en Russie. Pourquoi gardez-vous le silence ?
Oui c’est vrai, je me tais. Il y a cependant de rares moments où je n’arrive pasà me retenir. Par exemple quand sont morts plus de 300 enfants lors de la prise d’otage de l'école de Beslan, 1er septembre 2004. J'ai alors écrit qu’après cette affaire on ne pouvait pas pardonner à notre chef, comment il s’appelle, j’ai oublié son nom, le Premier ministre actuel. Mais il s'est vengé à sa manière – il a ordonné que mon 90e anniversaire soit passé sous silence. Une petite vilainie. A l’époque de Gorbatchev, je disais : attendons la libération de Sakharov, après on pourra parler de la démocratisation du système. Aujourd’hui, je dis : attendons la libération de Khodorkovski...
Jean Lopez, spécialiste du conflit germano-soviétique et rédacteur en chef de Guerres & Histoire,
Lasha Otkhmezuri, ancien diplomate, conseiller à la rédaction du magazine Guerres & Histoire.
(1) Alexandre Ginsburg (1936-2002), poète, est un des premiers dissidents russes. Membre du groupe de Helsinki, et fondateur de l’almanach poétique Sintaxis. Sintaxis va jouer un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle de l’URSS des années 60-70. Ginsburg dirigeait la fondation d’aide aux familles des prisonniers politiques, créée par Soljenitsyne en Suisse. Entre 1960 et 1979, il est condamné à trois reprises au camp de travail. Il est finalement relâché en 1979 et expulsé vers les États-Unis.
(2) Rédacteur en chef de la revue littéraire Novyi Mir, Alexandre Tvardovski (1910-1971), candidat à l'élection au Comité central au moment de l'incident rapporté par G. Pomeranz, a publié Une journée d'Ivan Denissovitch de Soljenitsyne. Il a joué un rôle de premier plan dans le dégel culturel qui a marqué les années post-staliniennes.



