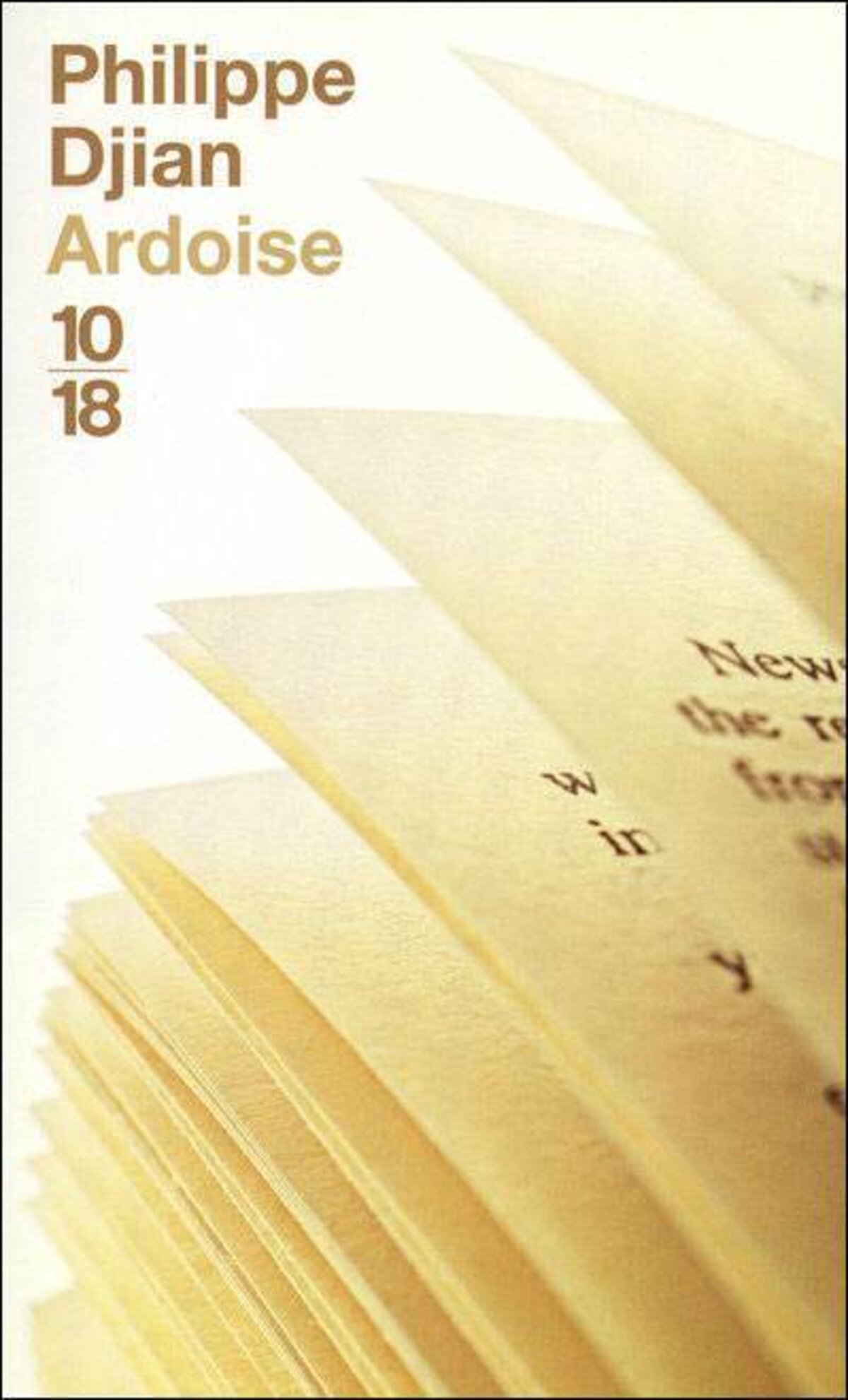
Agrandissement : Illustration 1
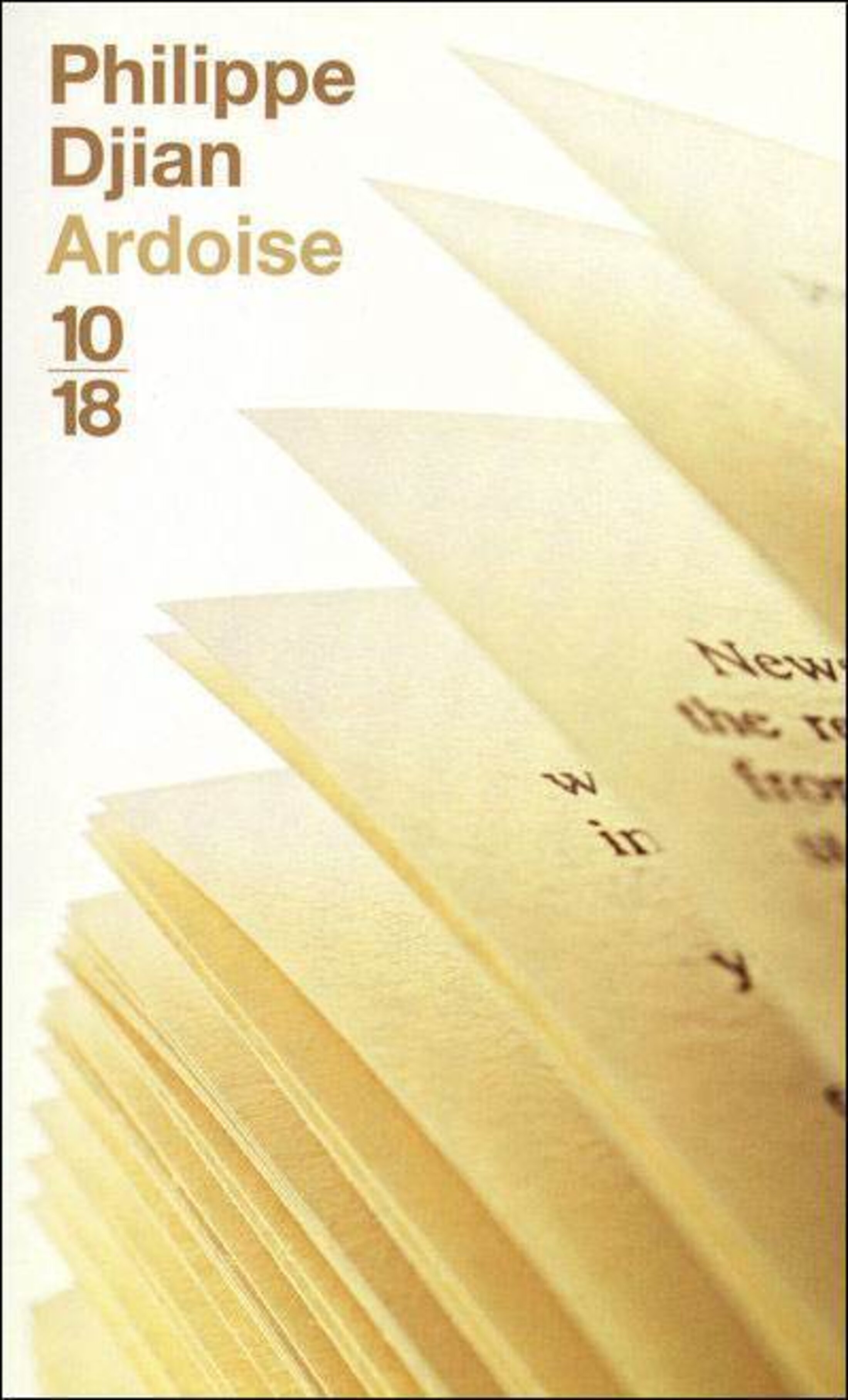
«Il y a cette idée de devoir quelque chose. D’être redevable. D’avoir une ardoise quelque part. Et un jour, il faut régler ses comptes.» S’acquitter d’une dette, littéraire et plus encore intime, existentielle, musicale, vitale, envers dix auteurs qui ont accompagné Philippe Djian, majoritairement américains, des orfèvres du style, du rythme. Dix par défaut, pour ne pas en rajouter, mais il aurait fallu, de l’aveu même de l’auteur d’Incidences, ajouter Roth, Amis, Bret Easton Ellis et McLiam Wilson, évidemment.
Dix textes pour dix auteurs lus, relus, aimés, en une forme de don / contre-don dont seuls les grands écrivains ont le secret : sur l’ardoise de Philippe Djian, Salinger, le Céline de Mort à crédit, Cendrars, Kerouac, Melville, Miller (Henry), Faulkner, Hemingway, Brautigan et Carver. Une manière d’autobiographie dans et par les livres, de la première découverte – saisissante – de l’effet produit par la lecture, à la rencontre de l’écriture, en passant par une traversée de l’Atlantique en tant que docker, sur les traces de Cendrars. Ardoise est le journal d’un lecteur écrivain, publié en 2002 chez Julliard, réédité en 2010 en 10/18.

Lire, comme un acte de chair et de sang, une crainte et un tremblement, une expérience qui part des tripes et non le parcours dégagé, automatique et insipide de pages. On entre dans un livre, il vous soulève et vous prend.
« Je sais de quoi un livre est capable. Je pense à une blessure. Je pense à une blessure qui aurait quelque chose d’amical, d’où le sang continuerait de couler avec douceur pour vous rappeler que vous êtes en vie et même bien en vie et capable d’éprouver une émotion qui vous honore et vous grandit.
Je pense à une blessure car, étrangement, se mêle une notion de douceur à l’amour que l’on porte à certain livre. Il s’est enfoncé dans vos chairs, non pas avec précaution et finesse, mais avec une violence impitoyable. »
« Je crois que l’on peut lire durant toute sa vie sans savoir ce qu’est réellement un livre, sans avoir senti ses genoux se plier et se cogner contre le sol ».
Lire non pour être à même de citer un titre comme une marque ou une « carte de visite », par vanité, bêtise ou fatuité mais par élan, passion, partage, envie, « vertige » :
« Car tout est là : retrouver le choc et la pureté des premiers instants. La magie du premier livre. Comme on cherche toujours à retrouver la première femme. Celle qui vous a tout donné ».
L’Attrape-cœur de Salinger pour Djian, justement, comme le creuset d’une vie dans la chair des livres. Lire, ce n’est pas aller vers un texte mais qu’il vienne vers vous, vous comprenne, provoque « trouble » et « excitation ». Djian souligne la part de séduction érotique du livre ; lisant Henry Miller il perçoit, au centre de l’œuvre, le sexe « comme l’élément indispensable à la compréhension du monde » et la lecture de ses textes comme « une onde de choc ».
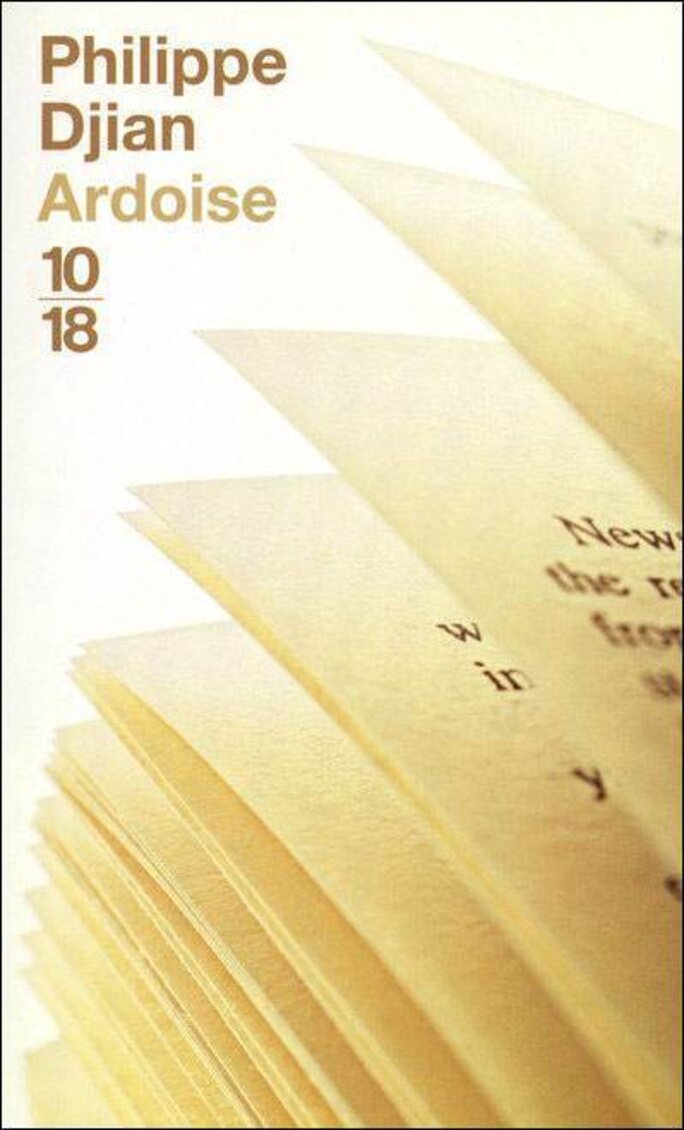
Agrandissement : Illustration 3
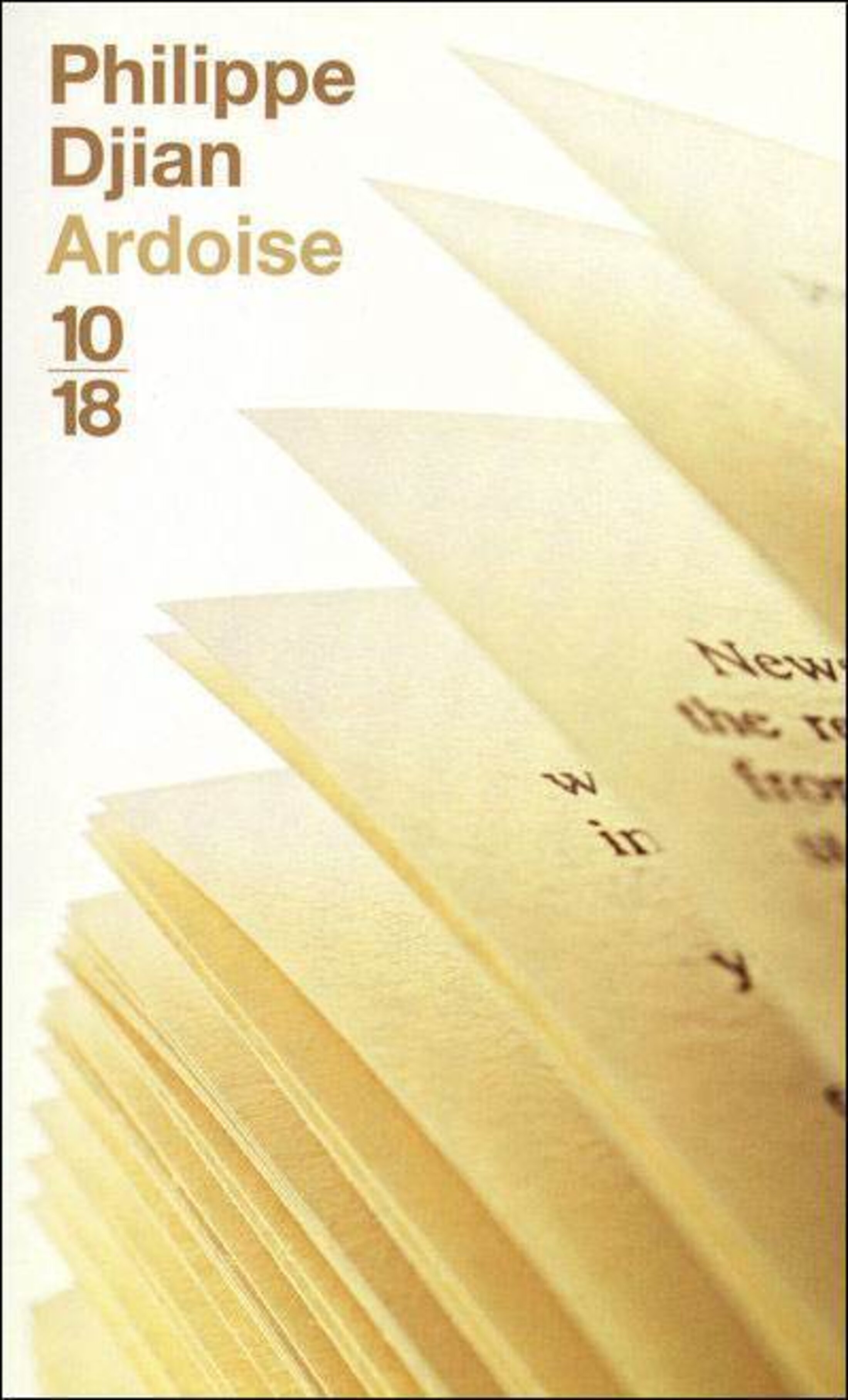
Mais lire pour écrire, aussi. Définir à travers les auteurs admirés son propre style, son propre rythme, son infini. Découvrir, à la lecture de La Crucifixion en rose de Miller, que « soit je n’écrirais plus une ligne de ma vie, soit je ne m’arrêterais plus ». Lire Céline (« le styliste absolu »), Cendrars pour apprendre la « magie » du mot, se frotter à la « matière » de la langue. Et rêver, dès lors, d’un jour « écrire un livre qui ressemblerait à une chanson de Lou Reed », trouver la note, le rythme. Passer « de longues heures à étudier » le style d’Hemingway « à la loupe, essayant de comprendre comment l’on arrivait à une telle acuité, à une telle concision, en évitant le moindre ornement ». Comment on parvient, en somme, des années plus tard, à écrire Impardonnables.
L’écriture n’est pas une pose, un jeu, une activité qui consiste à noircir des carnets ou ouvrir des recueils de poésie aux terrasses des cafés pour draguer (Walt Whitman en v.o. serait imparable, selon Djian) mais un virus, un souffle, une respiration. Travailler pour « entendre sa propre voix », oser se confronter au blanc :
« Je crois que l’on devient écrivain le jour où l’on ne parvient plus à écrire. Le jour où le moindre mot commence à vous poser un problème ».
Le jour où lire comme écrire passe par le corps, par « une écriture qui vous prend littéralement pour support ».
La littérature, ce sont des passions et des haines (ainsi de ces écrivains « comme une armée de notaires défilant sous un ciel pourri »), des refus subjectifs et assumés (Nabokov en rime avec bof), la haine de l’académisme et du diktat du pseudo bon goût (Flaubert et Proust le laissent de marbre, Valéry et Pascal lui donnent la nausée). Ou cette idée totalement stupide selon laquelle tous les grands livres auraient déjà été écrits : oser se frotter au contemporain, à son « foisonnement étourdissant », Bret Easton Ellis ou Murakami.
A vous, dès lors, de trouver ces auteurs qui remuent et renversent, chamboulent votre cerveau comme votre vie et votre perception du dehors, votre ailleurs : ainsi Philippe Djian, à chacun son ardoise.
Philippe Djian, Ardoise, 10/18, 120 p., 6 € 50.



