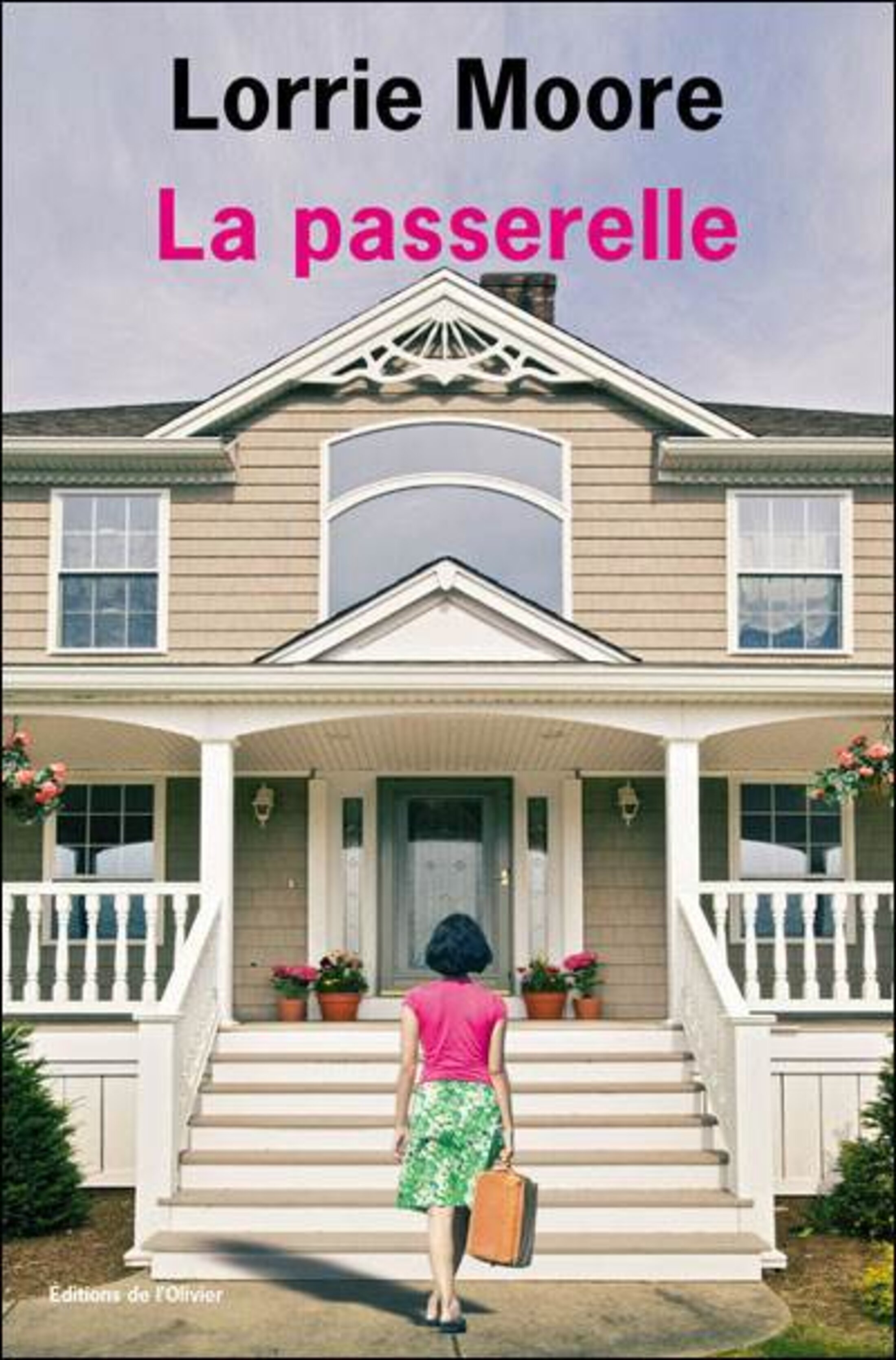« Il régnait dans l’atmosphère cette sorte de distorsion qui vous infléchit un peu, qui rend votre personnalité instable, vagabonde, floue, oblique, face au vaste champ des possibles ».
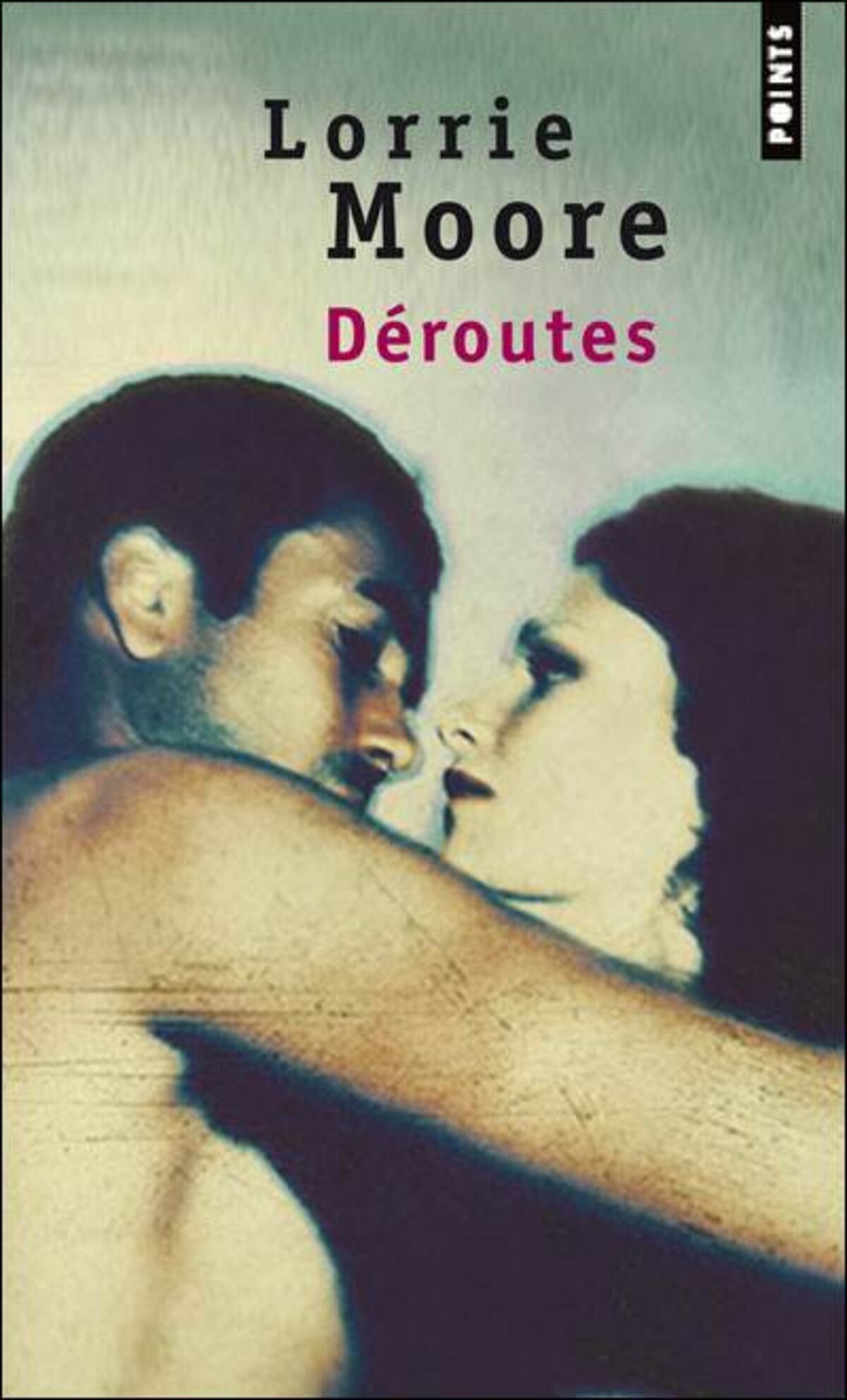
Agrandissement : Illustration 1
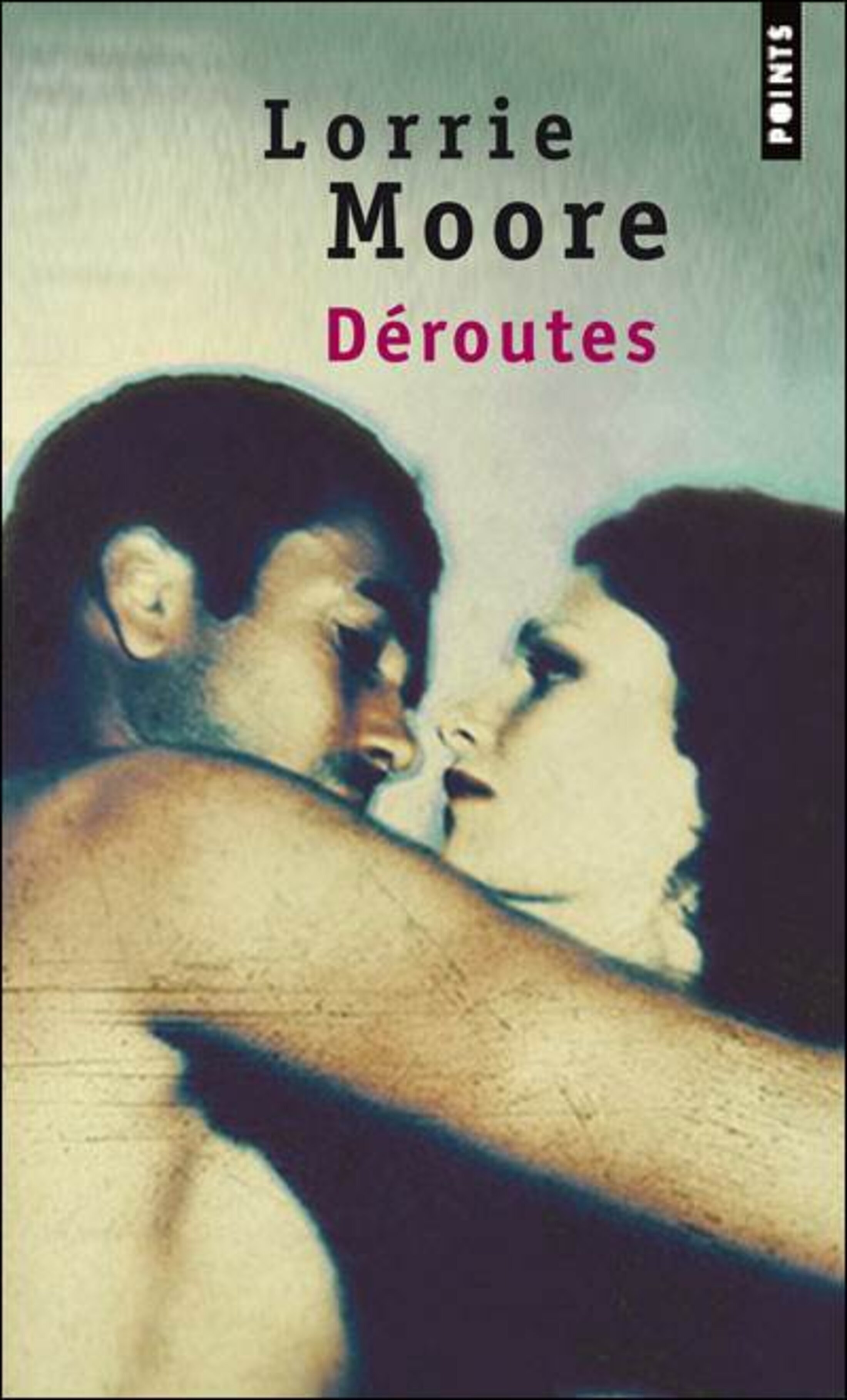
Déroutes. Le titre français de Birds of America (1998), récemment publié chez Points, est en soi tout un programme. Il fait signe vers des débâcles et confusions, vers nos petits et grands désastres, son pluriel signe le recueil (de 13 nouvelles) et il induit des chemins qui se séparent, des routes qui se perdent, changent de direction, de sens. Une géométrie qui est celle de la chambre de Sidra, « en forme de L, comme une vie qui prend un virage brutal ».
« La Mère s’est mise à pleurer : tout ce qu’elle a vécu l’a conduite ici, à cet instant. Après, il n’y a plus de vie. Il y a autre chose, quelque chose qui trébuche, quelque chose d’invivable, de mécanique, quelque chose pour les robots, mais pas la vie. La vie a été prise et brisée, vite, comme une brindille ».
Lorrie Moore avec Déroutes, comme avec Des histoires pour rien, s’attache aux moments climatériques, aux instants fulgurants et pleins, contradictoires, qui font soudain basculer le quotidien. Le retournent. Pour l’une, ce sera la mort de son chat Bert, pour l’autre une dispute, la révélation de l’adultère, du désir du conjoint pour une autre, un déménagement, pour beaucoup des voyages (Abby et sa mère en Irlande, Mack et Quiltie aimantés par les cimetières)… Déroutes fait se succéder des portraits de femmes, majoritairement. Des femmes qui vivent leur identité comme une altérité, qui ont le sentiment de ne pas totalement remplir leur existence, qu’il s’agisse de leur mode de vie, de leur emploi du temps ou même de leur enveloppe charnelle :
« Ruth commença à se sentir mal, de manière générale. Son corps, qui n’avait jamais été un temple, était passé de l’état de foyer à celui de maison, avant de devenir une cabine téléphonique, puis un cerf-volant. Il ne l’abritait plus. Elle ne s’y sentait plus hébergée ».
Jamais aucune certitude dans les récits de Lorrie Moore, qui pratique les ruptures de registres avec virtuosité, de nouvelles en nouvelles, de pages en pages. Du désespoir à l’humour. Du sentiment d’être englué(e) à l’ironie la plus décalée.
« En contemplant l’horizon à travers le pare-brise, Abby songea que toute la beauté, toute la laideur, tous les désordres disséminés dans la nature se retrouvaient également dans le cœur des hommes, réunis en un lieu unique. Toute la terreur et toute la splendeur engendrés par la terre – le vent, les océans –, chaque homme les portait aussi en lui, chaque homme cohabitait avec cette nature disparate et folle qui tourbillonnait à l’intérieur de lui-même. Rien que dans le monde – ni fleur ni pierre – n’était aussi complexe que le simple ʺbonjourʺ prononcé par un être humain ».
On est frappé, de textes en textes, par son sens du détail, du kaléidoscope. Sa manière de jouer de polyphonies, reprenant des motifs (l’adultère, le voyage, le couple, la mère, la perte de l’autre) pour mieux jouer de leur diversité, de leurs échos lointains. Ainsi du chapelet d’exclamations venant définir la vie dans Etat des lieux : « Le labeur douloureux et vain qu’était la vie », « quel supplice raffiné que la vie ! », « quelle saloperie, la vie ! », « la vie : quelle absurde petite histoire ».
« Absurde petite histoire que la vie », dont Lorrie Moore fragmente les approches, de l’indifférence feinte à l’acrimonie, de la résignation à un désespoir proche de la folie. Des existences qui soudain touchent le point zéro, « elles n’étaient rien. Zéro. Mais des zéros au sens mathématique, qui gardaient intacts les nombres et les équations ». Égrener ces vies revient pour l’écrivain à creuser la question de la construction de soi, dès le choix imposé d’un prénom (Olena, anagramme d’alone, seule), dès celui d’un lieu pour vivre, d’une norme (le mariage, un métier, l’Amérique) impossible à remplir, dès ces exils intérieurs, qu’ils soient géographiques ou intérieurs.

Lorrie Moore suggère, tisse entre les lignes, dans les blancs des paragraphes. Elle se focalise sur les intermittences du cœur, les prémonitions, les sentiments de culpabilité et de remords, les doutes, tout ce qui empoisonne le cours de la vie. Tisser des indicibles, des routes, leurs obliques, tel est le chant de la narratrice. En ce sens, l’avant dernière nouvelle de Déroutes définit son rapport d’écrivain au réel dans sa dureté, son impensable. La Mère est écrivain, le Bébé a un cancer.
« Comment décrire cela ? Comment le décrire ? Le voyage et le récit du voyage sont deux choses différentes. La narratrice est celle qui est restée à la maison, mais ensuite elle presse sa bouche contre celle du voyageur, afin de mettre la bouche en action, de la faire parler, parler, parler. On ne peut pas voyager et raconter ; on ne peut pas à la fois voir et dire, pas réellement. On peut y aller, et, au retour, gesticuler d’abondance. La bouche elle-même, qui travaille à la vitesse de la lumière, selon les instructions des yeux, est nécessairement figée : tout va si vite, il y a tant de choses à supporter qu’elle reste béante et muette comme un carillon dégoûté. Toute cette vie indicible ! C’est là que la narratrice intervient. La narratrice arrive avec ses baisers, ses imitations, son ordre. La narratrice arrive et transforme en chant lent et truqué le mutisme impatient de la bouche ».
CM
Lorrie Moore, Déroutes, Nouvelles traduites de l’anglais (USA) par Annick Le Goyat, Points, 357 p., 7 € 50
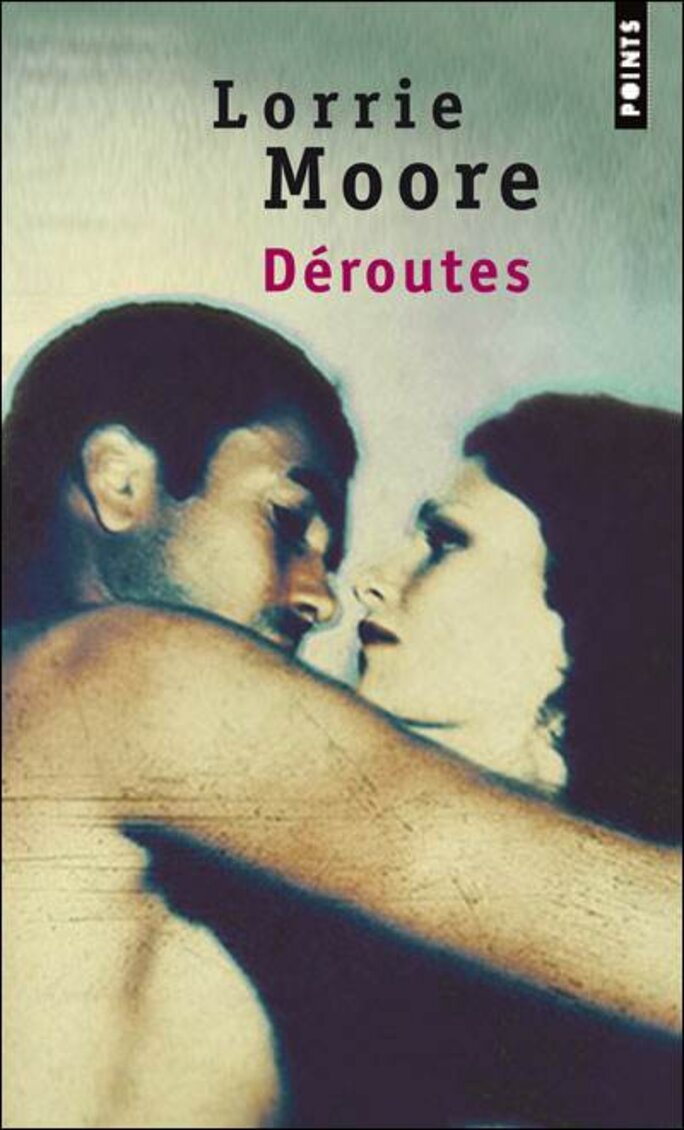
Agrandissement : Illustration 3
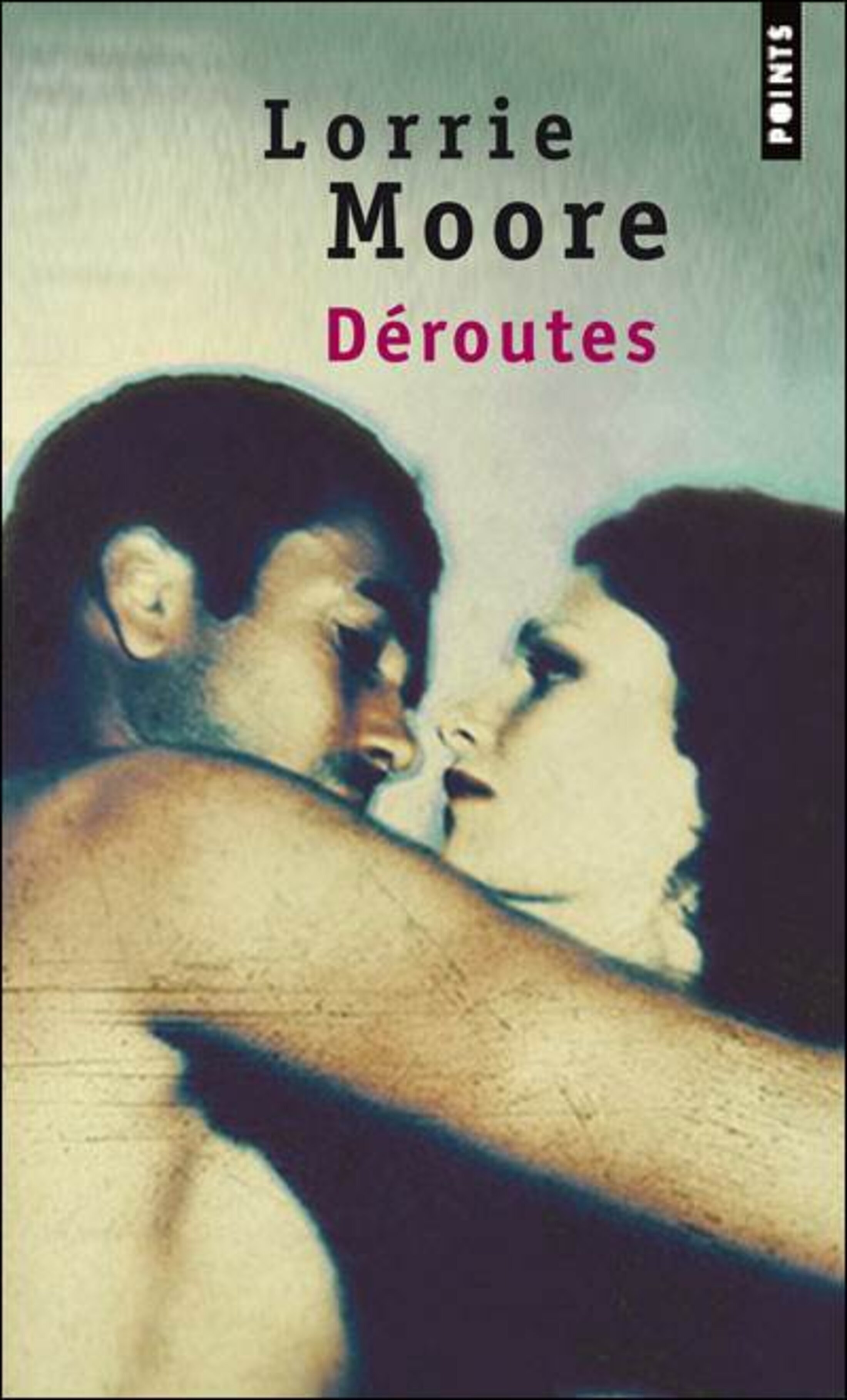
Et :
Lorrie Moore, Des histoires pour rien, Nouvelles traduites de l’anglais (USA) par Marie-Claire Pasquier, Points, 223 p., 6 €
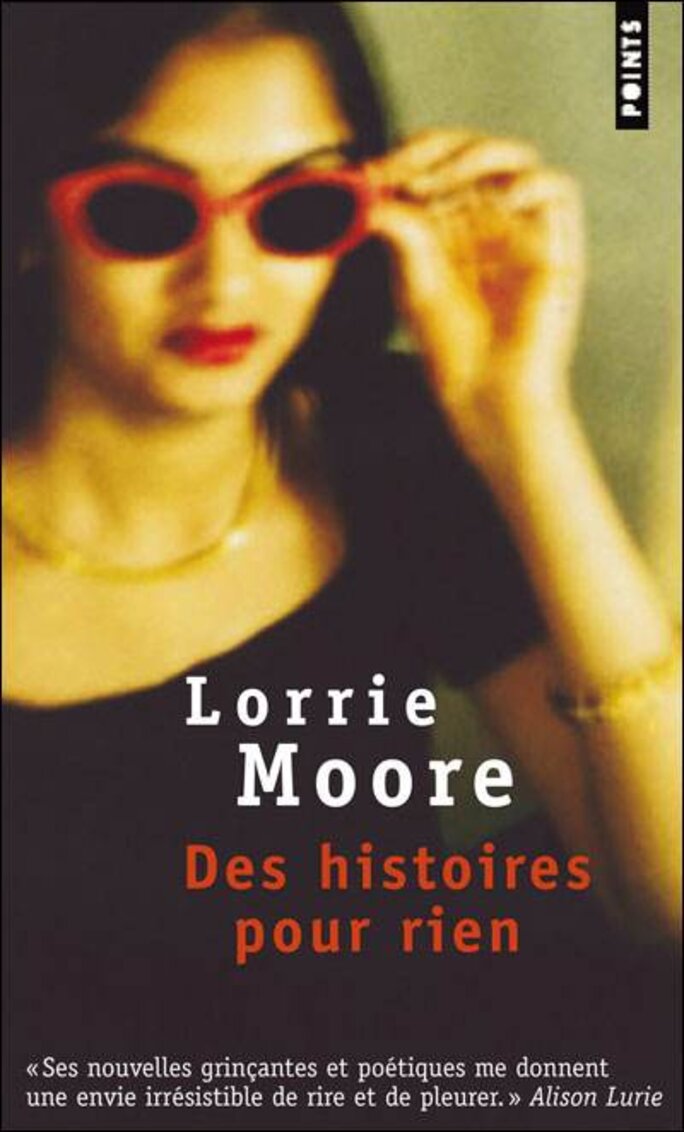
Agrandissement : Illustration 4
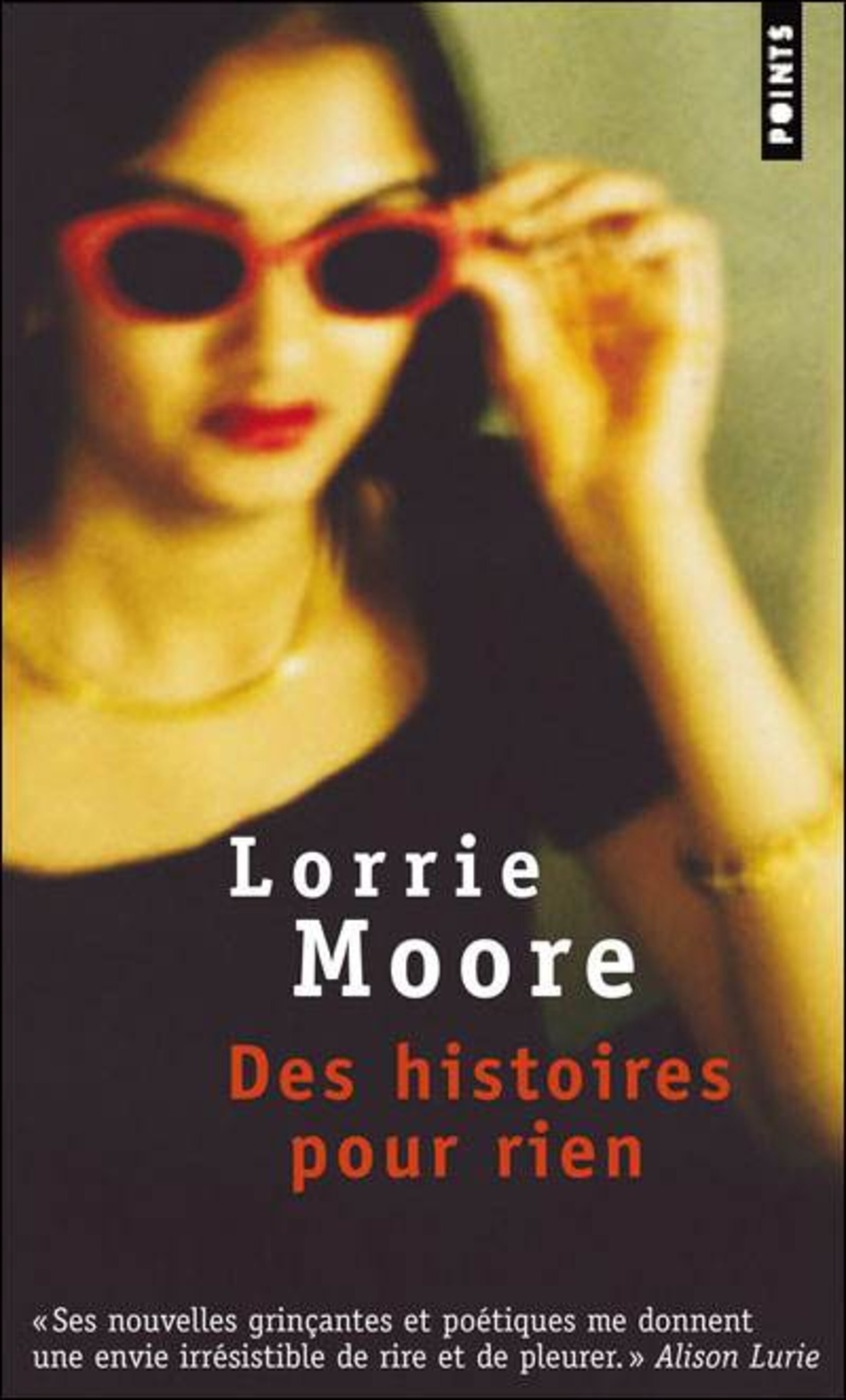
Lorrie Moore, La Passerelle, roman traduit de l’anglais (USA) par Laetitia Devaux, L’Olivier, 361 p., 20 €
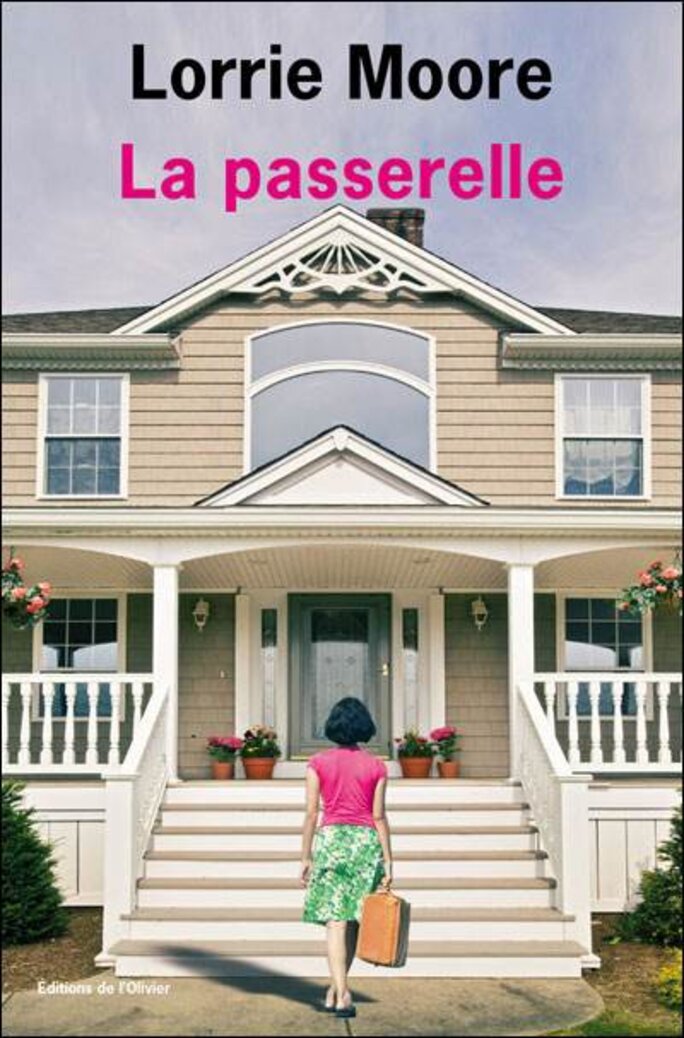
Agrandissement : Illustration 5