Raphaël Haffner a 78 ans. Ancien banquier, il a partagé sa vie entre l’Europe et l’Amérique. «La statue de la Liberté à un bout, la Banque d’Angleterre à l’autre. Mais Haffner ne faisait plus le grand écart au-dessus de l’Atlantique.» Il s’évade, ou du moins espère s’évader d’une histoire personnelle et professionnelle agitée.
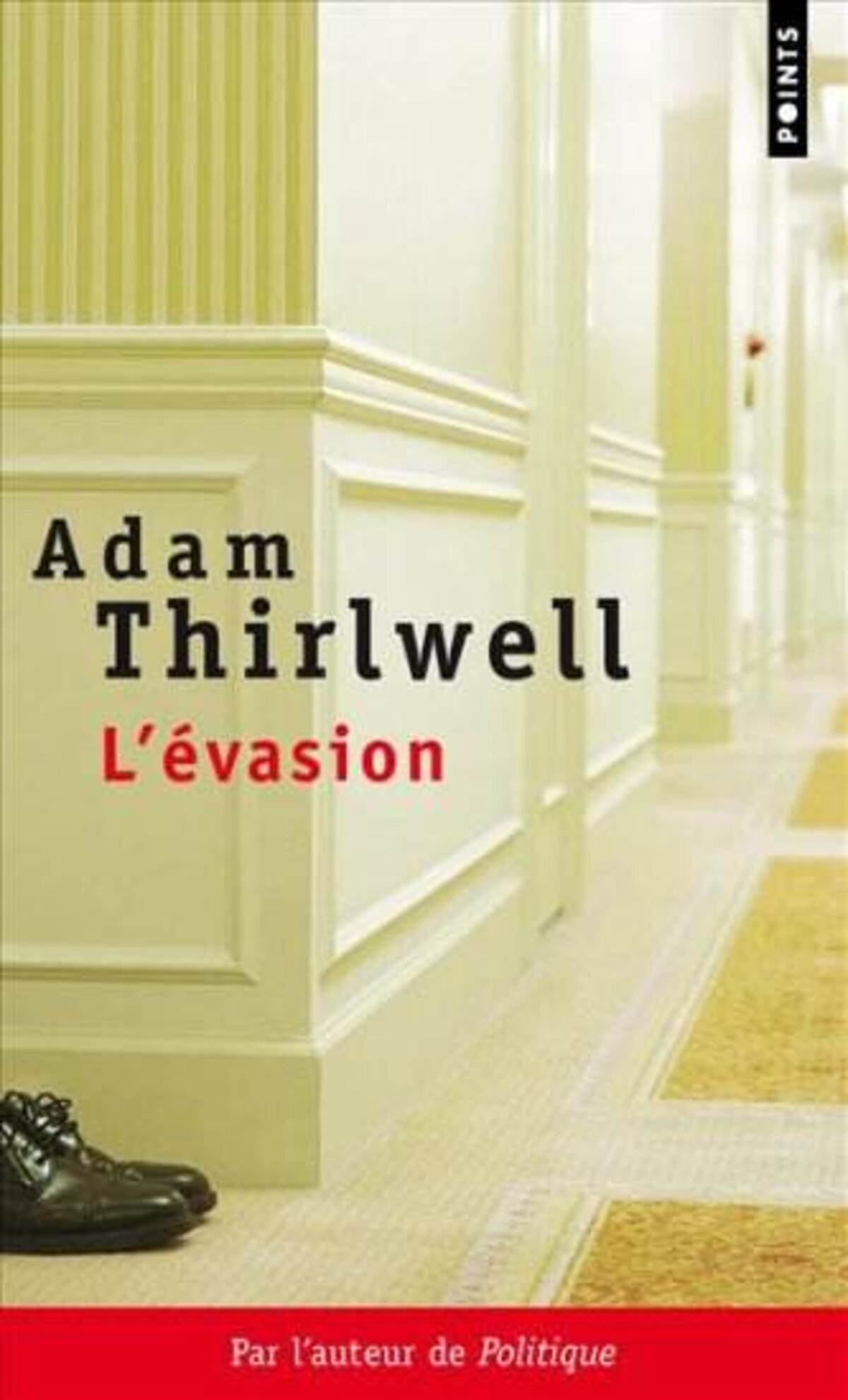
S’installant dans le palace d’une ville thermale de la Mitteleuropa, il dérive, s’abstrait et tente de récupérer une villa appartenant à sa femme décédée : «Veiller au recouvrement légal par sa famille de la villa, que s’étaient tour à tour appropriée les nazis, puis les communistes, enfin des capitalistes nationalistes, et qui, à présent, faute d’autre parent encore en vie, appartenait en théorie à Haffner et à ses descendants».
S’évader, c’est aussi pour lui tenter d’échapper à ses démons, à ses appétits, à sa volonté incessante de séduire, sa «maladie familière, péristaltique, des femmes».
Mais peut-on rompre avec son passé ? Ce dernier n’est-il pas une révolution éternelle, un retour permanent au même ?
La vie d’Haffner tire à sa fin. Ce final sera-t-il mythologie ou farce ? Sans doute un peu des deux. Tout n’est-il pas pris dans la «bipolarité», ce qui fonde aussi le ridicule des choses, «tout dérivait de son contraire : le jour de la nuit, la difformité du beau, la fortune de l’infortune» ?
«Oui, en ce monde rien n’arrive sans une histoire en amont : le plus haut dérive toujours du plus bas et toute victoire contient sa propre défaite».
Avec Haffner, c’est le vingtième siècle que l’on contemple, le vingtième siècle qui se termine. Avec lequel le personnage voudrait rompre :
«Si souvent, il rêvait de renoncer, de s’enfuir de son histoire.»
«Ce qu’il voulait, c’était seulement s’évader. Mais de quoi, il eût été bien incapable de le dire».
Sans doute ne peut-on rompre avec soi, avec son histoire, puisque tout dérive de tout, que tout se répète, selon un principe ironique fondamental. «L’histoire, se dit-il, n’était qu’un théâtre de répétitions. Il était vraiment abasourdi du nombre illimité de ses motifs».

Et comment devenir soi quand on est «déchaîné», «amoureux», «amphibie», «enragé», «apaisé», comme le liste la table inaugurale, en vingt entrées, quand on est «multiple» ?
«Comme tout héros de légende, il fallait le ronger, tel un os, pour découvrir la richesse, le sens profond. Aussi préférais-je mon image privée. Haffner était sa propre matrioshka : abritant en lui les autres petites poupées de son infinie possibilité».
Le narrateur, rendant visite à son ami Haffner agonisant dans un hôpital de la banlieue londonienne («mais il se mourait depuis si longtemps. (…) La fin, comme d’habitude se poursuivait»), décide de tenir la chronique d’une vie, de se faire historien, multipliant les cadrages sur un personnage fabuleux, propre à faire naître le récit, le roman avance par d’étranges retours en arrière, commentaires, comme une forme de mémoire involontaire, tirant sa force du hasard, «comme autant de panneaux d’une frise antique». Car «mesdames et messieurs, peut-être Haffner était-il un grand homme. Peut-être était-il un héros épique». Le roman est tout entier dans ce peut-être, doute, existence soumise aux aléas de la fiction, de l’histoire.
«Deux méthodes s’offraient à l’historien pour faire la chronique de la vie de Haffner. La plus évidente consistait à suivre la chronologie, les annales de Haffner. L’autre, plus philosophique, se trouvait coïncider avec la façon dont Haffner envisageait vraiment les choses : les événements se recoupaient, se regroupaient en thèmes. Dans le privé, suspendu dans le fluide de sa mémoire, Haffner lui-même approchait l’attitude philosophique : médium d’objectivité totale».
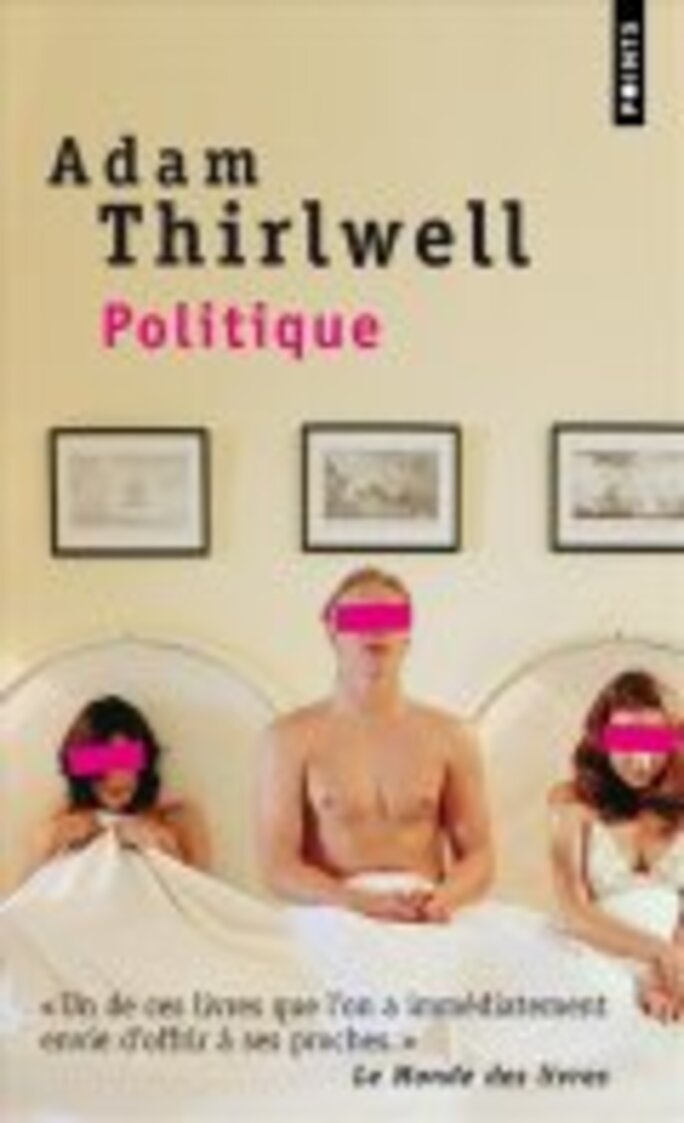
Anti-roman d’apprentissage, L’Evasion est une éducation sentimentale, la chronique d’une époque finissante. Les lecteurs de Politique d’Adam Thirlwell retrouveront l’ironie fondamentale de l’auteur, son sens aigu des êtres et de la marche du monde. Ses théories, sa manière de lire l’époque à travers le sexe, son art de lier histoire privée et publique, littérature, histoire et philosophie. Ils liront une variation sur des thèmes chers à l’écrivain : l’identité, la liberté, l’érotisme, la judéité – sous l’angle ici de la diaspora –, l’exploration de l’intimité et de l’intériorité, cette façon de mêler récit et discours, jusqu’à citer des auteurs énumérés en post-scriptum. Mais L’Evasion est un roman plus classique que Politique, bien plus grave, pesant parfois, celui d’une maturité. Celle de son héros, 78 ans, celle de son auteur, 32 ans. Un texte profondément déceptif, là est son sujet, parfois décevant cependant.
CM
Adam Thirlwell, L'Evasion (The Escape), trad. de l'anglais par Anne-Laure Tissut, Points, 381 p., 7 € 50.
Et toujours : Adam Thirlwell, Politique, traduit de l’anglais par Marc Cholodenko, Points, 284 p. 7 €.
Prolonger : Assises internationales du roman, à Lyon : L'improvisation d'Adam Thirlwell par Sylvain Bourmeau.



