Franz Bartelt écrit notamment des chroniques dans L’Ardennais. Comme Alexandre Vialatte livrait les siennes à La Montagne. Parce que l’humaine nature est partout chez elle, mais d’un point de vue local où la seule chose qui compte ce sont les couleurs. Pour éviter aussi que l’époque qui tourne en rond exagère trop, qu’elle se prenne pour une flèche…
A sa manière, volubile et ironique, il prolonge la marque de fabrique de la plus idiote des villes de province : ce ciel bleu du « regard qui ment », et les coulées de pluie frisquette sur le schiste, et les ornières collantes à travers coteaux et bois, jusque loin après la Belgique. Des gens d’ici aux racines fugueuses…
.

.
Rimbaud le voyou voyageur, Jean-Claude Pirotte l’exilé dans la combe, et André Dhôtel à l’œil blessé… Ceux qui nous mènent vers ces pays où on n’arrive jamais, les seuls qui valent le détour. Un détour qui ne finit pas, un détour qui dépasse la fatigue. Villages perdus, hameaux introuvables. Sans drapeau ni hymne. Sinon la bannière des nuages et le sifflement du vent tournant. Sans stèles ou édifices, que le marronnier où s’incisent les amours défuntes.
.
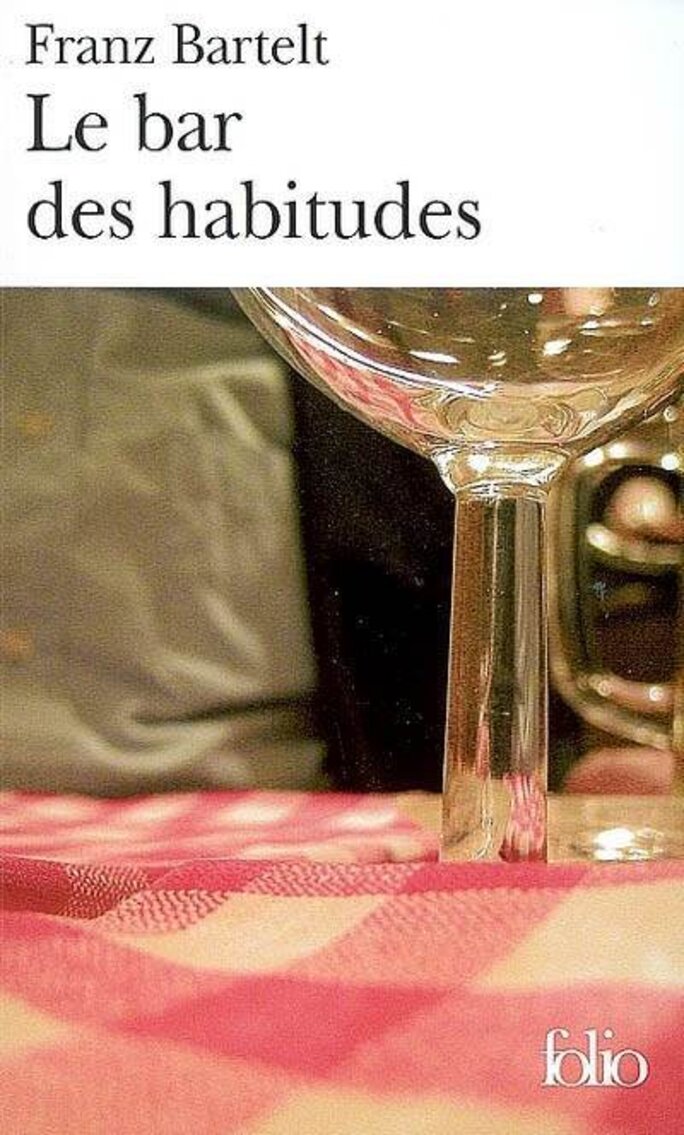
Agrandissement : Illustration 2
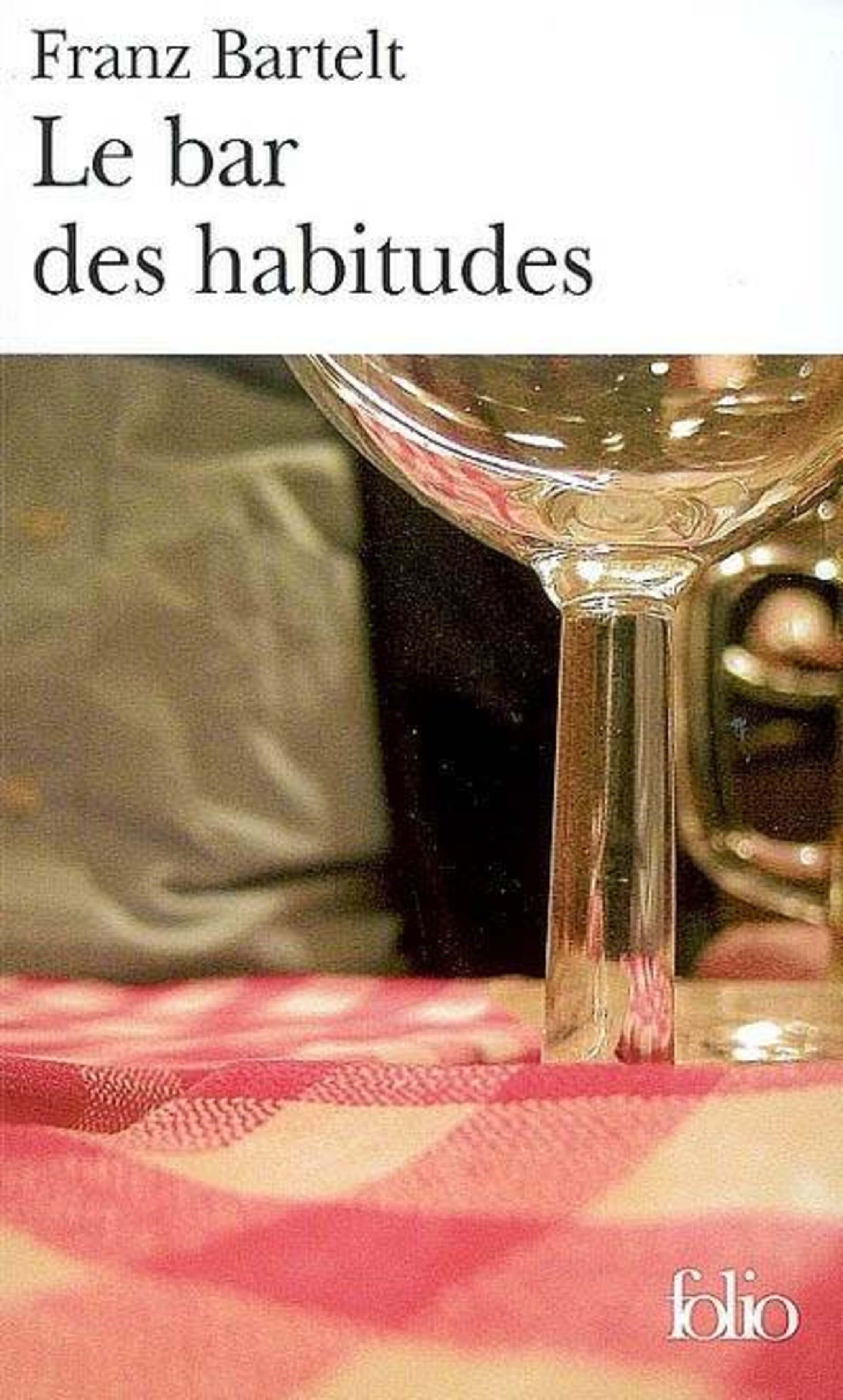
Déjà, avec Le bar des habitudes - titre qui a le charme de son chiasme - distingué par le Prix Goncourt de la nouvelle 2006, Franz Bartelt nous avait montré, en la personne d’un certain Balmont dit « la sardine », que le quotidien n’est pas tout à fait n’importe quoi :.« Il y a un plaisir tranquille de se conforter jour après jour à l’idée que rien ne change et que nous ne changeons pas non plus. A force, on peut s’aventurer à croire à un genre d’immortalité du quotidien. Si rien n’arrive rien de mal ne peut arriver. Calcul élémentaire. »
.
Et à propos de Jeff, un banal qui a l’inconvénient de porter une tête d’assassin : « Mais l’homme est ainsi fait : à peine a-t-il constaté un phénomène qu’il éprouve le besoin de vérifier s’il est reproductible. »
.
Ce qui nourrit le malentendu et les méprises, et permet de faire bien des histoires à partir de rien qui est le commencement de tout…Avec ses évidences - par exemple, Guy Vouine, l’homme mou (à ne pas confondre avec élastique ou tendre ou flexible) ne peut épouser qu’une fille bonne pâte et répondant au sobriquet de Moumoune - le quotidien nous mène au bout du monde sur le trottoir d’en face. Il procède par décalages afin d’être tout ce qu’on veut sans qu’on s’y attende, et on ne veut surtout pas s’y attendre. Pour peu qu’on aime, comme Nadège, les comptes qui tombent juste, même si on paie l’addition.
.
A la suite de Marcel Aymé, et de son Dutilleul-Garou Garou qui traverse les murs, Franz Bartelt acclimate volontiers l’invraisemblable. La platitude des horizons sans horizon, il la met au service d’un univers parallèle où toutes les aventures imaginaires et inimaginables ne dérobent pas au jeu des mots. Car le miracle est de ce monde ou il n’est pas. Puisque le réel n’a pas de limite…
.
Ainsi Manon, qui toute impulsive d’une jeunesse fringante s’était fait tatouer sur le pubis « Date limite de consommation » suivi du jour de son cinquantième anniversaire, quand vient le moment fatidique, veut succomber une dernière fois à la folie vénérienne, et drague Sébastien à la terrasse d’un café, pour découvrir hagarde que son amant porte une inscription similaire, mais avec la date de la veille ! « Je fais plus que mon poids… »
.
Toute une destinée humaine tient à ce simple constat. Protone, contre son apparence colossale, ne pèse que 20 kilos, l’aiguille de la balance à l’appui. Car il est creux : Et il s’en trouve assez content : il vit de paris contre qui devinera le bon chiffre, avec une marge de 50 ; et il gagne à coup sûr. Puis un gars énervé, outrageusement curieux, finira par l’éventrer, il voulait avoir le fin mot du mystère…
.
Ce miroir que la littérature promènerait, selon Stendhal, le long de nos vies, il faut lui accorder d’être de fantaisie, déformant comme à la Foire du Trône (qui ne mérite plus de se nommer ainsi, dès lors qu’il a quitté le Cours de Vincennes pour le bois et la pelouse de Reuilly), de se payer nos têtes et une partie gratuite, pour que les éclats de verre soient des éclats de rire…
.

Dans Pleut-il ?, un recueil bigarré, à la vive extravagance, Franz Bartelt apporte quelques aperçus sur son art littéraire :
.
« Ce qu’on écrit n’est valable qu’à l’instant même où on l’écrit. Avant, il n’existe pas. Il n’y a pas un réservoir quelque part, hors de soi, où attendrait ce qui doit ou ce qui peut être écrit, quelque chose comme les limbes de l’informulé. Une fois écrit, ce qu’on écrit n’existe plus. »
.
« Chaque mot se tend vers le blanc de la page. Non pour occuper un espace sur le territoire qu’il piétine en passant, mais pour épargner à son auteur cette chute dans le gouffre qui s’ouvre en lui.Soyons sincère : on écrit dans l’effroi ; Pas un mot qui ne soit un cri, un gémissement, une plainte. L’écriture n’est qu’un essoufflement, dont le moins qu’on puisse en dire est qu’il n’est pas interminable. »
.
« Le mot n’est pas la chose. Il n’est même pas l’ombre de la chose. Il n’entre pas dans la composition de la vérité, ni même dans celle de la réalité. Il n’est qu’une facilité qu’on s’accorde entre bavards pour faire du bruit en y mettant un fond d’intelligence et de mémoire. »
.
Et le comment du pourquoi serait probablement ce « J’ai toujours cultivé l’ennui » : « Si l’ennui n’était pas une source de plaisir, les gens ne seraient pas aussi nombreux à s’ennuyer. Finalement, on s’ennuie pour se distraire. Parce que c’est un état agréable, au fond. Et vaguement métaphysique. » Personnellement, ces temps-ci, je ne rencontre à peu près personne qui s’en revendique, de l’ennui… C’est devenu un plaisir rare, peu adapté à notre ordre démocratique de producteurs reproducteurs. Ce sont les « rois » qui s’ennuient. Les « gens », eux, à notre époque festive, ils n’ont pas le temps, ils ne disposent plus d’une telle grâce, ils ont toujours autre chose à faire…
.
Franz Bartelt est un donc facétieux. La vie, c’est « plutôt le dimanche » qu’elle suit sa meilleure pente. On s’y laisse prendre à la légère et sans rancune : « Il y a quand même, dans ce monde rationnel et cartésien, des femmes déraisonnables. » Et ouvrons les yeux « le paradis terrestre ne peut pas être plus serein que le Semois dans ces instants d’après le déluge. Si j’avais été seul, je me serais assis sur le banc qui se trouve là et j’aurais attendu la nuit, cette nuit qui semble monter du fond de l’eau, qui déborde de la rivière, envahit doucement le peu de terre enclos dans le méandre, rejoint cette nuit perpétuelle qu’on aperçoit au pied des sapinières et se lance avec nonchalance à l’assaut de la montagne… »
.
Il faut encore s’émouvoir des amours du gros Max gourmand des millefeuilles de Gertrude la boulangère, enfin pas seulement des millefeuilles… Une extatique passion dévore les tourtereaux et le plus normalement du monde elle s’achève par une noyade dans la Meuse, à cause d’un eczéma de la paume, dû à une allergie au stylo feutre : c’est au creux de sa main, à l’abri du mari et de la clientèle, que Gertrude cachait ses messages complices !
.
D’importantes considérations sur les gaufres nous sont délivrées : « Existe-il une denrée plus géométriquement stupide qu’une gaufre ? » Pourtant : « Cela dit, la gaufre n’est pas bête. N’est bête, en effet, que ce qui étant conçu pour être intelligent se révèle, à l’usage, incapable de l’être. » C’est un sort cruel, pour la gaufre, que plaire « au plus grand nombre, » et de ne pas pouvoir être « un sujet fédérateur. » Alors : « On fait avec, sans plus de soucis qu’on aurait de plaisir à faire sans. »
.
Enfin une parole de vérité nous est tenue sur ces projections éducatives, au début des années 60, du fameux film de Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du silence (et mon Dieu, il ne semble pas les choses se soient pas vraiment arrangées, aujourd’hui, avec Nicolas Hulot à la manœuvre, le pire étant généralement certain dans la promotion des bonnes causes) :
.
« Pendant quatre ans, il a fallu subir cette atrocité de voir, une heure et demi durant, des poissons heureux une fois pour toutes évoluer devant une assistance d’enfants qui souffraient dans le noir, et pas pour la dernière fois, hélas, hélas !… un cauchemar aquatique et sans cesse recommencé, comme la mer du même nom. »
On mesure, à la situation écologique actuelle, combien ce genre d’initiatives aura éveillé les consciences et préservé les fonds marins de la planète…
.
A présent, un petit dialogue nous éclaire magistralement sur un des aspects de la devise républicaine : « L’égalité des droits établit la réciprocité. Quand le Blanc voit le Noir blanc, le Noir voit le Blanc noir. C’est son droit. J’irai même plus loin : rien n’interdit au Blanc blanc qui voit le Noir noir de voir noir le Blanc blanc qui voit le Noir blanc. »
.
Ce n’est pas une prestigieuse dynastie régnante qui intéressera Franz Bartelt, évidemment. A travers une longue nouvelle - dont je me demande si elle ne conviendrait pas à une adaptation théâtrale ? - nous faisons connaissance avec les Porquet : Cyrille, Emile, et surtout Basile, l’ultime avatar d’une lignée qui de père en fils se voue à la fabrication et au commerce de la corde à nœuds. Certes, nous n’arrivons pas au meilleur moment, celui de la splendeur d’une maison jadis et naguère florissante, nous tombons mal, au pire, quand l’abîme s’ouvre. Car n’est-il pas certain que notre époque ne montre aucun souci de ce qui fut longtemps un des ornements du faste de nos stades, casernes ou écoles, sous les portiques ? Et ne disons rien de feue la marine à voile : les haubans ont péri rongés par le sel et l’oubli ! Toujours vient le Progrès et son cortège de désaffections, inexorable, impavide…
.
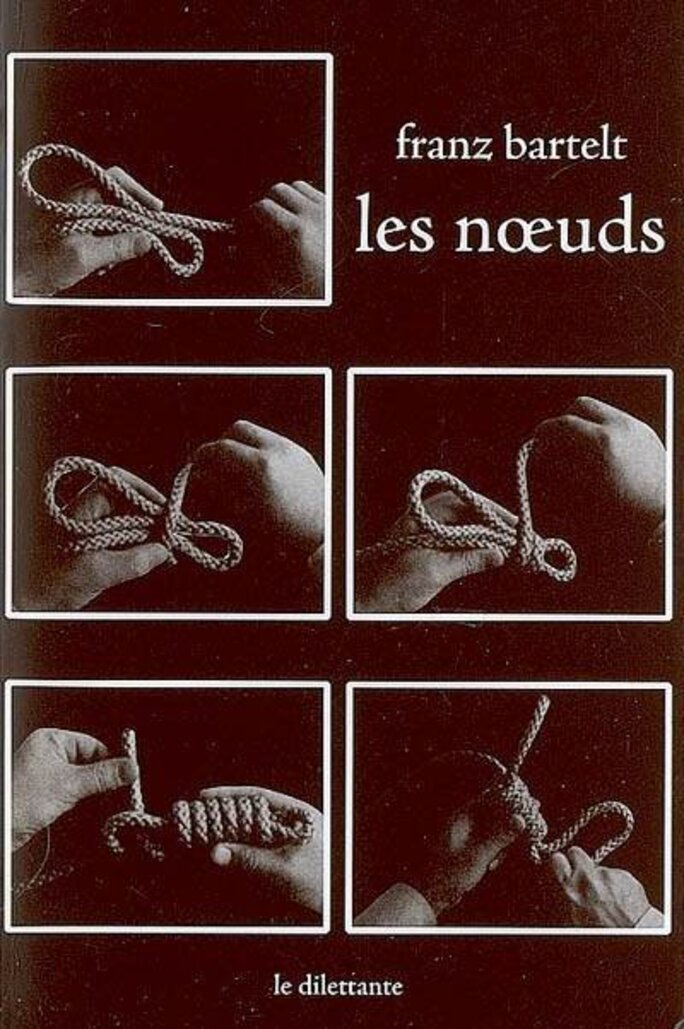
Agrandissement : Illustration 4
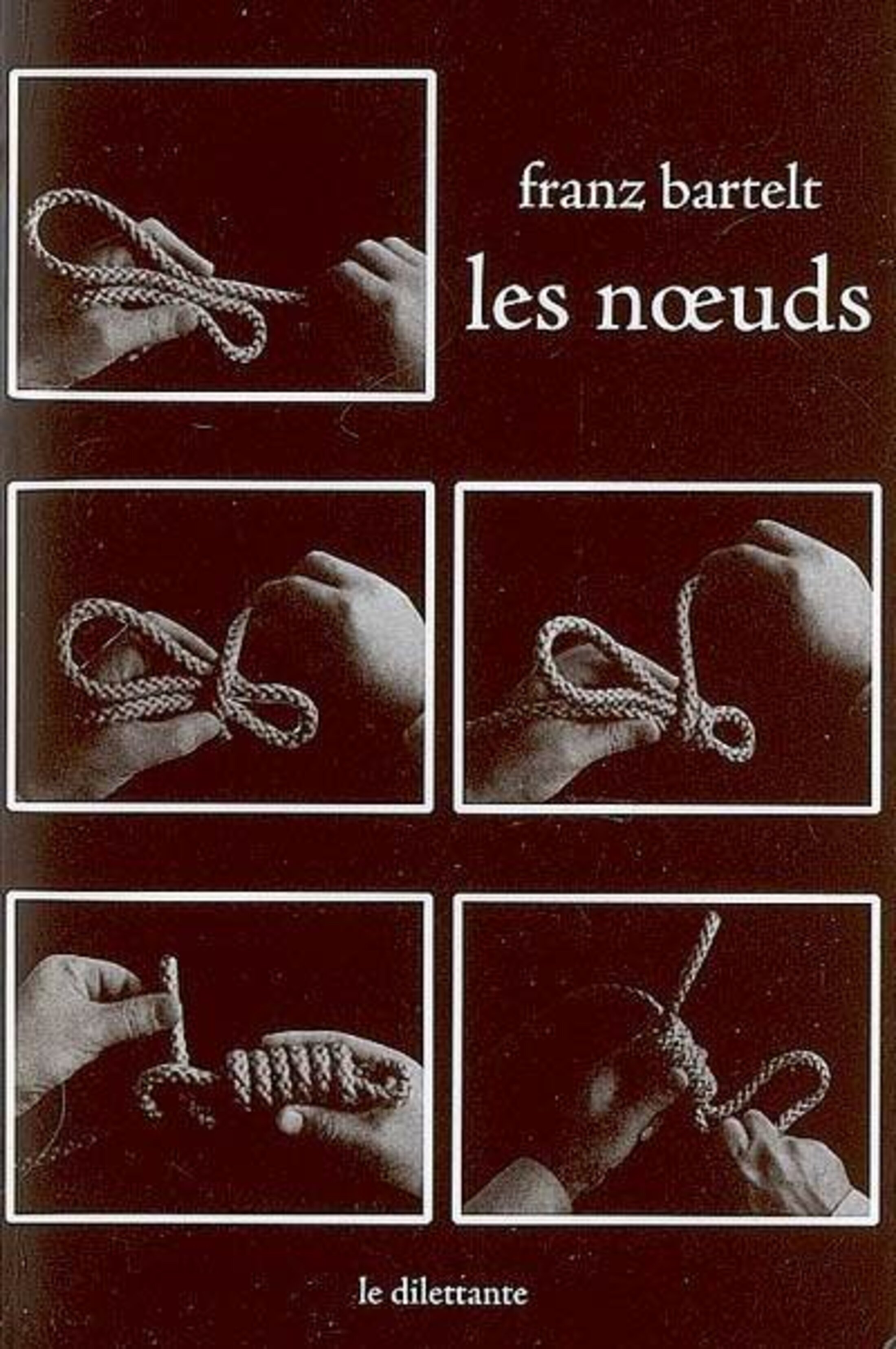
Il y a bien, forcément, le drame humain. Il n’épargne pas l’univers des cordages à nœuds. C’est même tout le contraire. Mais, avouons-le, il lui manque les couleurs « flashantes » qui font la beauté du spectacle et le passage à la télévision. Pourtant le nœud porte à d’immémoriales réflexions : Alexandre de Macédoine, en sa gloire naissante, ne parvint pas lui-même à en démêler la version gordienne et dû se résoudre à trancher net - De plus, c’est le cas de le dire, dans ce genre d’affaire un malheur n’est jamais seul. Et Basile Porquet, se voit balloté entre la déroute économique et le désastre sexuel : un âge solide le laisse ignorant de l’amour physiquement. D’où la fixation délirante qu’il nourrit à l’endroit (et à l’envers !) des formes extrapolées de l’indécise épouse du voisin chômeur! Je laisse chacun deviner s’il y a la moindre chance d’une fin heureuse à pareille histoire. Les nœuds nous tiennent, les nœuds nous lâchent, comme le cœur…
.
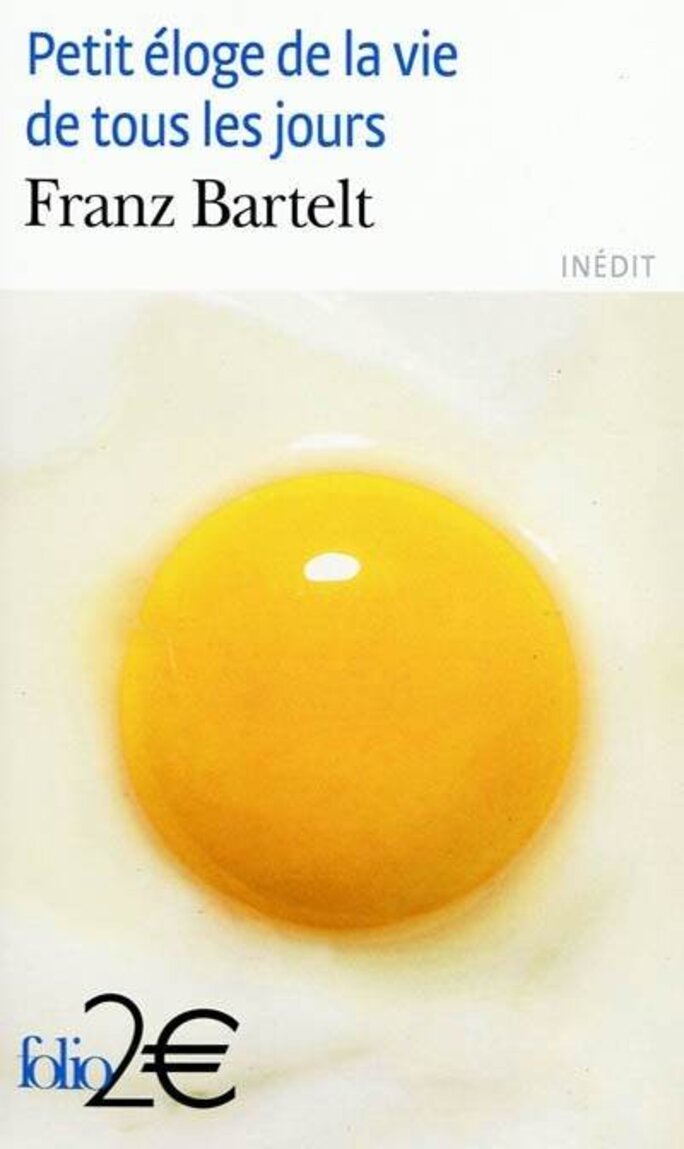
Agrandissement : Illustration 5
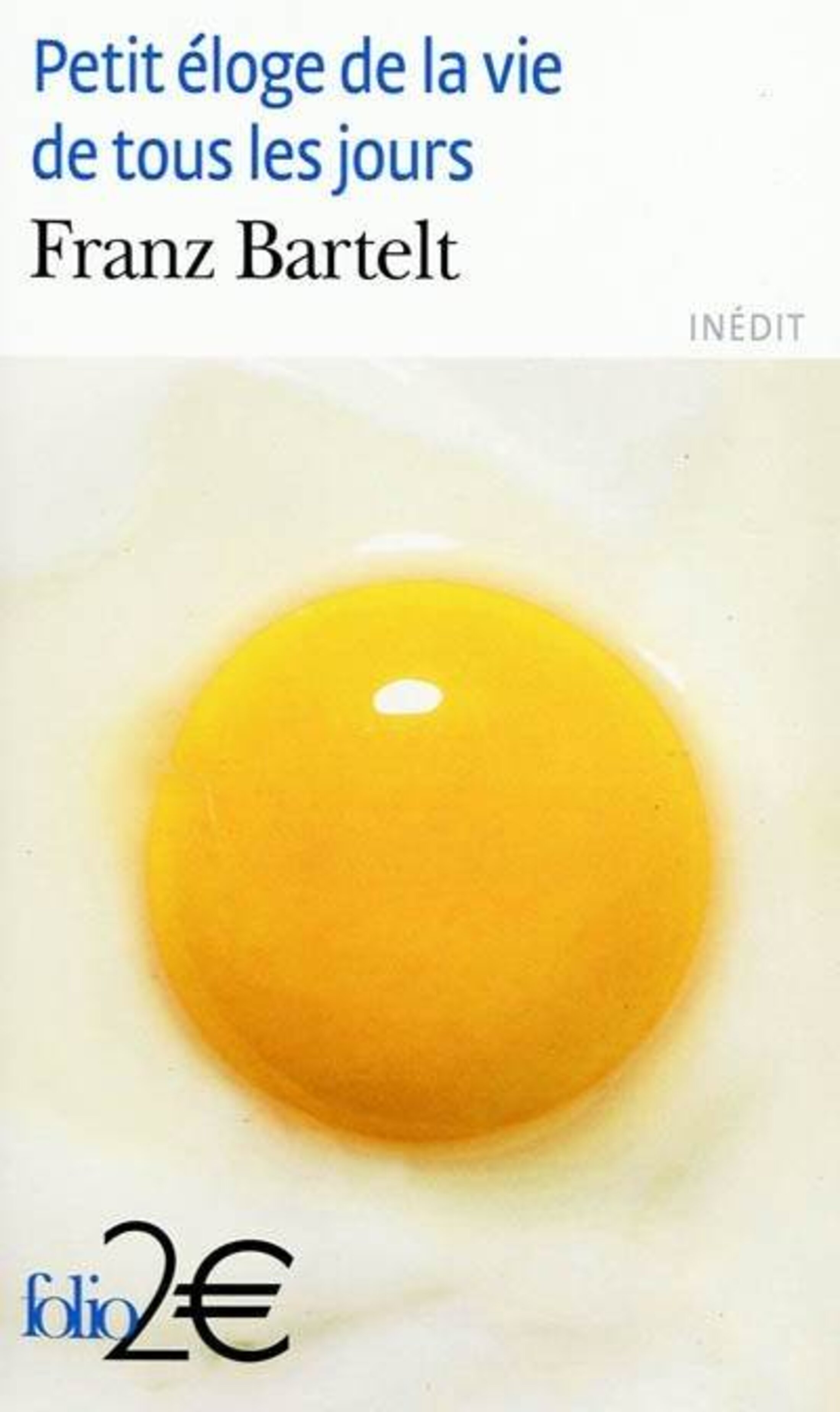
Et puis - nouveauté dans une collection d’inédits, chez Folio, une vingtaine de titres, déjà, sous la signature d’écrivains de l’intérêt et de la valeur de Régine Detambel (la peau), Stéphane Audeguy (la douceur), Richard Millet (la solitude), Nathalie Kuperman (la haine), Elisabeth Barillé (le sensible) ou Brina Svit (la rupture).. . Collection qui renoue avec l’origine même du Livre de poche : la littérature de grande qualité à petit prix (2€ en l’occurrence) - paraît maintenant, je m’aperçois que ça remonte à septembre, les mois filent, ce Petit éloge de la vie de tous les jours.
.
« L’écriture qui est une manière de s’approcher pour regarder, et de regarder pour voir, deviner sans même pouvoir s’en faire une idée toutes les complications que recèlent les choses les plus élémentaires. »
.
Et c’est comme ça que nous ne saurons jamais qui des vaches de Lafrancheville ou d’Aubenton « en connaissent le plus» et que nous cherchons encore, ce qui à défaut d’être un but valable dans la vie, en donne un excellent à la promenade ! En revanche, nous quelques certitudes restent à notre portée : « à la différence de la pomme de terre, qui peut attendre, la betterave ne respecte pas le repos dominical. » Pour le ramassage.
.
D’ailleurs, on ne se méfiera jamais suffisamment : « Quelqu’un a dit que le café était imbuvable. C’était le premier paradoxe de la journée, car pour prétendre avec quelques crédits qu’un café est imbuvable, il faut l’avoir bu. Le simple fait de l’avoir bu fonde sa capacité à être bu. Et s’il est bu, il n’est pas imbuvable. »Il y a le jour d’après les vacances, le premier, le lendemain du retour si on veut être précis et redondant : « une véritable période d’éloquence ». Et celui où il n’y avait rien de mieux à faire, qu’envisager les différentes appellations du degré de cuisson du steak au buffet d’une gare, sur la frontière franco-belge. Celui où Sedan à gagné 5-1 contre le Paris-Saint-Germain. Sans oublier celui, tout bête, des morts également tout bêtes, et des chrysanthèmes qui ne le sont pas moins. Ou le jour générique, le jour de l’attente, qui est le vrai de vrai, le jour justement de tous les jours : « On ne se trouve pas dans le même état d’esprit en attendant son tour chez l’épicier qu’en attendant sa propre mort. Le mieux c’est d’attendre la pluie. Attendre la pluie ne déçoit pas. »
.
En compagnie de Franz Bartelt, on ne croise que les pauvres mortels que nous sommes tant bien que mal, toujours tentés de jouer au plus malin, d’en savoir plus long que leur idées courtes ; condamnés à l’égarement et dépourvus de remède contre la bêtise et la mort, comme le chantent moqueuses les Muses de l’antique Parnasse et le merle de Jean-Baptiste Clément. De pauvres mortels se disant qu’un destin si pesant, il vaut mieux ne pas trop s’y fier, une poignée de sable que le vent balaie quand il veut comme il veut ; ne pas y attacher trop d’importance ni des regrets, mais ne pas en perdre une miette.
.
« Ici, l’homme se suffit. Il est vivant, aucune beauté spéciale ne le sollicite, il n’attend pas grand-chose du ciel, et rien du gouvernement. » C’est donc, pour Franz Bartelt, une chance que d’habiter une de ces contrées où « on ne se déplace pas d’un musée incontournable à un panorama sublime », où chaque vie infime est un roman comme chaque jour du calendrier un petit coffre à ouvrir, avec une friandise ou une rose fanée ou vieux clou rouillé ou du vide. Un coin d’ordinaire, une cambuse sous les saisons : « Il neige moins qu’ailleurs. Il fait moins froid qu’ailleurs. Il y fait moins chaud aussi. On y voit moins loin. » Un goût du temps qui passe à l’instant où il passe et ne repassera pas.
.
C’est bien pour quelque chose si « dans les mythologies, il ne pleut pas souvent. Les Dieux n’aiment pas se mouiller. La pluie est une affaire d’homme modeste. Dans les pays où il pleut, on s’amuse beaucoup ; la parole y est simple, légère, sans ambiguïté ; l’eau du ciel refroidit les fanatismes religieux. Les villes saintes sont toujours au soleil. Les villes saintes sont par excellence les lieux de la tragédie humaine. On croit y trouver un Dieu, on n’y trouve que des princes qui se sont approprié le pouvoir de Dieu. On les voit et on s’en retourne en affirmant qu’on a vu Dieu, pour ne pas s’avouer qu’on a fait le voyage pour rien. » La pluie et son odeur de grand chemin frontalier, il convenait de les saluer, c’est le mieux que puisse faire un éloge de la vie de tous les jours, le final rêvé qui fait renaître. Et pas uniquement sous le ciel des Ardennes. De toute façon « le problème n’a jamais été d’aller quelque part, mais seulement d’aller aussi loin que possible. L’immensité de l’univers ne permet vraiment pas de choisir son adresse. ».
Kairos
.
Franz Bartelt :Petit éloge de la vie de tous les jours (Folio/Gallimard 4954, 2009)Le bar des habitudes (Folio/Gallimard 4626, 2007)Pleut-il ? (Gallimard, 2007)Les Nœuds (Le Dilettante, 2008)Et parmi une trentaine d’ouvrages :Simple (Mercure de France Galant, 1999)Les bottes rouges (Gallimard, 2000)Le jardin du Bossu (Folio/Gallimard policier 434, 2004)Plutôt le dimanche (Labor, 2004)
La Belle Maison (Le Dilettante, 2007)



