
Agrandissement : Illustration 1

C’est actuellement l’anniversaire de cet arrêt qui a complètement transformé et révolutionné la composition des équipes de sports collectifs, devenues depuis cosmopolites. Et consacré la mondialisation des Équipes européennes de sports collectifs.
L’élargissement des possibilités de recrutement des clubs
Avec l'arrêt Malaja accordant de nouveaux droits aux sportifs, les lignes Maginot du sport ont « explosé ». Les possibilités de recrutement de joueurs étrangers par les clubs en Europe ont augmenté très sensiblement en application des Accords européens, véritables Traités internationaux, signés par l’Union européenne avec des Etats tiers (Europe de l’Est, Maghreb, accord de Cotonou avec la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique…).
Le Conseil d’Etat en rendant applicable l’accord d’association signé entre l’Union européenne et la Pologne édictant l’interdiction de la discrimination en raison de la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, est à l’origine d’une innovation dont les clubs vont ensuite profiter.
Ainsi, l'arrêt Malaja, faisant "jurisprudence", va considérablement transformer le paysage sportif, ouvrant en grand la porte de la mondialisation pour les joueurs étrangers qui pendant longtemps ont été soumis à des restrictions dans les clubs européens.
Des stars sud-africaines du rugby en France
Le rugby est entré de plein pied sur la scène mondiale grâce à l’arrêt Malaja et quelle entrée mondiale ! L’accord de Cotonou a permis l’arrivée remarquée des joueurs du Pacifique (Fidji, Samoa...) et également des joueurs sud-africains qui ont été fort nombreux à être recrutés par les clubs. Qui n’a pas entendu parler des grandes stars de l’Afrique du Sud dans le rugby anglais et français ? L’arrivée de Springboks a donné à la fois une visibilité et également une audience, toutes deux inédites et exceptionnnelles à la discipline.
Le capitaine de l’Afrique du Sud championne du monde en titre Siya Kolisi s'est engagé avec le Racing 92, c'est une sacrée nouvelle pour le rugby français. D'autres joueurs sud-africains vont sans doute l'imiter dans les mois à venir.
Dix joueurs étrangers voire onze au coup d’envoi de matches de football
Vingt ans après, la victoire pour les droits des sportifs est réelle puisqu’ à la politique des quotas des joueurs étrangers a succédé la liberté de circulation et d’embauche des sportifs qui peuvent mettre leurs talents au service des clubs européens. C’est l’apport de l’arrêt Malaja qui fait suite à la secousse de l’arrêt Bosman (1995) qui concernait seulement les joueurs communautaires.
De nombreux clubs de l’Union européenne ont bénéficié de l’application de l’arrêt Malaja et donc des accords européens puisqu'à l'époque du prononcé le 30 décembre 2002, le nombre d'Etats membres de l'Union européenne était moindre qu'aujourd'hui et des Etats signataires des accords n’étaient pas encore membres de l’UE (15 Etats seulement étaient membres de l’Union européenne à l’époque ; aujourd’hui, 26).
Les clubs européens comptent désormais de très nombreux joueurs étrangers quel que soit la discipline concernée et il est arrivé à certains clubs de football de débuter une rencontre avec dix voire même onze joueurs étrangers au coup d'envoi, ce qui était impensable il y a une trentaine d'années. La grogne est grande dans certains Championnats où certains jugent que la présence des joueurs étrangers est excessive mais la mondialisation est là, elle est irréversible, l'arrêt Malaja y a nettement contribué.
L’arrivée de la diaspora africaine dans le foot
Avec l’application des accords avec le Maghreb et ceux de Cotonou, les sélections nationales bénéficient de l’apport de leurs joueurs nationaux venus jouer en grand nombre en Europe. Leurs joueurs exerçant en Europe, constituent l’ossature de différentes équipes nationales
L’illustration la plus probante est celle du Maroc. En effet, lorsque l’équipe nationale du Maroc a atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde 1986, le nombre de joueurs évoluant en Europe était de cinq sur un effectif de 22 joueurs sélectionnés, soit une très faible proportion, alors que lors de son premier match contre la Croatie lors de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur du Maroc a aligné au coup d'envoi onze joueurs évoluant en Europe et plus précisément dans sept Championnats européens différents (Espagne, Allemagne, Angleterre, France, Italie, Belgique, Turquie). L’arrêt Malaja est passé par là…
Quelques mois avant le Mondial 2022, le Sénégal était « européen » en remportant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec un onze de départ 100% expatrié en Europe et n'oublions pas la sélection d'Algérie, gagnante de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec au coup d'envoi sept joueurs évoluant en Europe dans le onze de départ.
Quant aux joueurs de l’Europe de l’Est issus des pays signataires des accords, comme la Pologne, ils sont également nombreux en Europe de l’Ouest et sont considérés comme des joueurs communautaires ces dernières années avec l’adhésion de leurs pays dans l’UE quelques années après, bénéficiant ainsi de la liberté de circulation au sein de l’UE.
Comment en est-on arrivé là ?
À l’origine de la procédure, Lilia Malaja perd son procès à Strasbourg, capitale de l’Europe… mais gagne à Nancy et au Conseil d’Etat.
Le règlement de la Ligue féminine de basket-ball était le cœur du conflit. Il limitait à deux le nombre des joueuses extra-communautaires par club, c’est-à-dire non ressortissantes de l’Union européenne, qui à cette époque comptait 15 pays. La basketteuse polonaise Lilia Malaja est recrutée par le RC Strasbourg basket pro féminin mais en application des règlements, elle est l’étrangère de trop, le club ayant déjà deux joueuses non-communautaires. L’agent de la basketteuse François Torres et le président du club Patrick Kramer nous demandent d’attaquer l’interdiction de jeu de Lilia Malaja.
Avocat à Marseille, nous défendions des sportifs notamment des footballeurs sous contrat avec l’agent de joueurs Pape Diouf. Nous avions découvert l’existence des accords d’association et de coopération signés par l’Union européenne et des Etats tiers en préparant une thèse de doctorat en droit sur le thème du Sport et de l’Europe, soutenue en décembre 2000 à l’Université de Nice. L’Union européenne était engagée avec une centaine d’Etats tiers, accords avec les Etats d’Europe de l’Est, Maghreb, accord de Cotonou avec la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique.
Des accords méconnus donc non appliqués
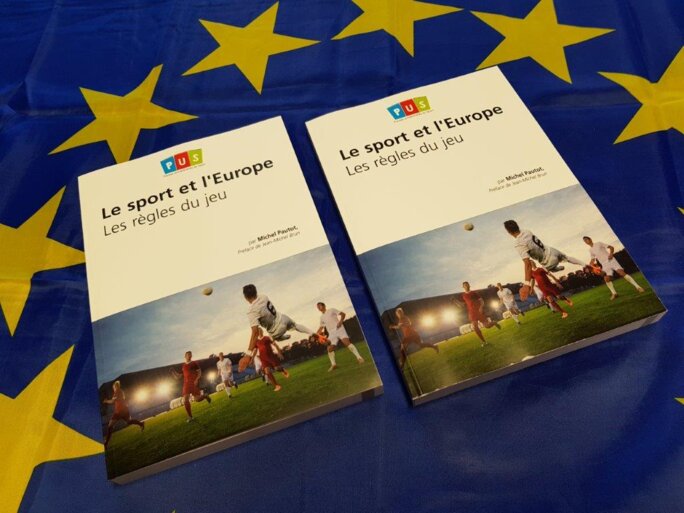
Agrandissement : Illustration 2

Lors du procès, ces accords étaient assez méconnus, notamment des dirigeants sportifs. Devant la conférence des conciliateurs du Comité national olympique sportif français, préalable obligatoire avant la saisine du tribunal administratif, nous avons soutenu le droit de Lilia Malaja de jouer en qualité de joueuse communautaire, c’est-à-dire sans restriction, en application des dispositions de l’accord d’association avec la Pologne édictant qu’il ne pouvait pas y avoir de discrimination en raison de la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail. Lilia Malaja disposait d’un titre de séjour régulier et d’un contrat de travail et donc, elle devait jouer. Nous soutenions, à bon droit, la supériorité des dispositions d’un traité international sur la loi interne, et donc sur les règlements sportifs. Le conciliateur du CNOSF rendait un avis favorable à nos prétentions le 7 octobre 1998. La Fédération faisait opposition, nous obligeant à saisir le tribunal administratif de Strasbourg qui, à la surprise générale, rejettera notre recours le 27 Janvier 1999. La révolution du sport à Strasbourg n’a pas lieu. Strasbourg, ville européenne s’il en est… Lors des audiences de Strasbourg, Lilia Malaja était présente, accompagnée de toutes ses coéquipières, venues la soutenir.
Le 3 février 2000, la Cour administrative d’appel de Nancy juge « illégale » l’interdiction de jouer faite à Lilia Malaja par la FFBB et enfin, le 30 décembre 2002, le Conseil d’État tranche définitivement le litige en confirmant l’arrêt du 3 février 2000 de la cour administrative d’appel de Nancy. Lilia Malaja a définitivement gagné et l’arrêt a été confirmé postérieurement par la Cour de Justice dans les arrêts Kolpak, Simutenkov, Khaveci. Vingt années après, les portes de la mondialisation sont grandes ouvertes…
* Michel Pautot,
Avocat au barreau de Marseille, docteur en droit
Auteur de l’ouvrage « Le sport et l’Europe »
Avocat de Lilia Malaja



