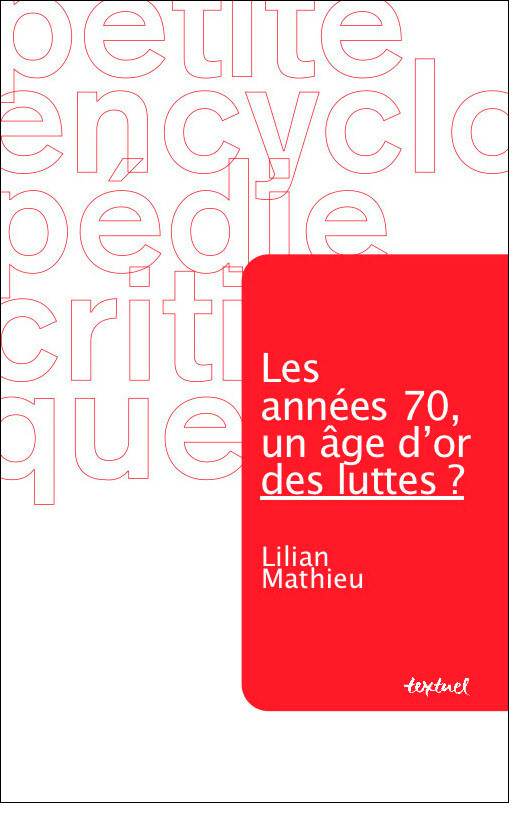
Sociologue des mouvements sociaux au CNRS, Lilian Mathieu présente son livre Les années 70, un âge d'or des luttes ?, le troisième des quatre premiers titres de la collection « Petite Encyclopédie Critique » des éditions Textuel...
*************************************************
La période qui s'ouvre avec Mai 68 et s'achève le 10 mai 1981 avec la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle apparaît rétrospectivement comme un véritable âge d'or des luttes, tant elle fut riche en épisodes protestataires. Difficile en effet d'aborder cette séquence historique sans évoquer les multiples mobilisations qui l'ont rythmée et marquée, telle celle des lycéens contre la loi Debré, la lutte féministe pour la légalisation de l'avortement, le combat des homosexuels pour ne plus être considérés comme un « douloureux problème », l'occupation du camp du Larzac, l'expérience autogestionnaire de Lip, la multiplication des séquestrations de dirigeants d'entreprises par leurs salariés, les grèves de la faim des sans-papiers, le renouveau basque, breton ou occitan contre l'État centralisateur ou encore - la liste est loin d'être exhaustive - le boycott du veau aux hormones et le refus des implantations nucléaires de Creys-Malville ou de Plogoff.
Mais si la mémoire collective se souvient ainsi des années 70 comme d'une période d'intense effervescence contestataire, comme d'un temps de revendication permanente et de politisation tous azimuts, c'est aussi par contraste avec la décennie qui l'a suivie et qui se caractériserait à l'inverse par l'atonie militante et le repli frileux sur la sphère privée. Les années 80 seraient ainsi celles de la résignation contre l'espoir, de la médiocrité triomphante contre la créativité débridée, de l'individualisme égoïste contre l'esprit du collectif - bref, le moment de la trahison de tous les idéaux et espérances portés par les années 70. Nombreux sont les militants qui, ayant fait leurs premières armes à cette époque, confortent cette image en regrettant aujourd'hui ce qui leur apparaît comme une période faste où l'engagement aurait été plus intense et déterminé, le sens du collectif plus affirmé, la combativité plus âpre. L'ironie veut que leur nostalgie d'un passé à leurs yeux révolu rejoigne l'entreprise de disqualification de l'esprit frondeur des années 68 à laquelle se livrent professionnels de la politique et idéologues conservateurs : clamer la nécessité de « liquider » Mai et son héritage, c'est tenter de conjurer le spectre d'une humeur contestataire qui était parvenue, plusieurs années durant, à faire trembler certaines des assises les plus solides du monde social, à remettre en cause les rapports de domination les plus institués, et dont ils redoutent plus que tout la possible renaissance.
Célébrées, dénigrées ou tournées en dérision, les années 70 apparaissent souvent mystérieuses à celles et ceux qui ne les ont pas connues et qui nourrissent à leur égard une certaine ambivalence. La distance temporelle comme les acquis de la recherche historienne ou sociologique sur les mouvements sociaux de l'époque permettent aujourd'hui d'aborder cette séquence avec davantage de lucidité et de sérénité, et c'est ce qu'entreprend l'ouvrage. Son but n'est certainement pas de célébrer les mouvements des années 70 en les idéalisant, mais d'en dresser un panorama le plus complet et le plus fidèle possible afin que puisse en être établi aujourd'hui un bilan critique. Comme tout héritage, celui que les militants contemporains peuvent retirer de cette décennie de lutte se doit d'être sélectif, à même de tirer les leçons de ses réussites comme de ses échecs, de ses outrances comme de ses naïvetés, de ses audaces comme de ses renoncements. À ce titre, l'ouvrage s'adresse en priorité aux jeunes générations militantes afin de les appuyer dans leur légitime droit d'inventaire des formes et des enjeux de luttes que leurs aînés leur ont légués.
Cet héritage et ce bilan critique s'imposent avec d'autant plus d'urgence que les combats des années 70, loin d'appartenir à un passé définitivement révolu, sont en réalité restés d'une brûlante actualité. La liste des mouvements évoqués dans le livre reproduit, à peine transformés, les enjeux des luttes du présent : emploi, conditions de travail et pouvoir d'achat, immigration et antiracisme, discriminations sexistes ou homophobes, droits des minorités, situation des lycées et des universités, refus de la guerre, écologie, agriculture, nucléaire, santé, prisons... Les acteurs des luttes sont aussi, dans une large mesure, restés les mêmes. Acteurs collectifs en premier lieu, puisque bien des organisations à la pointe des mobilisations actuelles sont nées ou issues de la vague post-soixante-huitarde, que l'on pense par exemple au GISTI, au Syndicat de la magistrature ou encore à la Confédération paysanne. Mais aussi acteurs individuels, puisque bon nombre d'animateurs des mouvements d'aujourd'hui, d'Attac au Réseau éducation sans frontière, du Collectif national droit des femmes aux Faucheurs volontaires d'OGM, se sont formés dans et par leur participation aux luttes des années 70.
C'est à ces acteurs également qu'est destiné l'ouvrage, tant ceux-ci ont du mal à se reconnaître dans le portrait couramment dressé de leurs combats passés. À l'encontre de ceux qui, au sein même des sciences sociales et pour mieux prophétiser de la fin des luttes ouvrières, ne retiennent d'une décennie de lutte que les enjeux « identitaires » ou « post-matérialistes » des mouvements féministes, homosexuels, régionalistes ou écologistes, il est important de rappeler que la combativité sociale eut les entreprises pour principal terrain d'expression, et que le monde du travail, dans la sidérurgie comme ailleurs, a ardemment lutté contre les restructurations industrielles et le chômage de masse. Il est important de rappeler que les immigrés se rebellèrent contre le statut de main d'œuvre corvéable à merci que leur réservaient tant l'État que le patronat, et surent faire valoir leur droit à la parole et à la dignité. Il est important, enfin, de rappeler contre la vaste entreprise de culpabilisation menée par les idéologues contemporains que ce ne sont pas les supposés laxisme pédagogique ou relâchement des mœurs issus de la critique anti-autoritaire soixante-huitarde qui sont les responsables de tous les maux actuels. C'est au contraire la disqualification des idéaux égalitaires et libertaires de Mai, de longue date victimes d'une contre-attaque réactionnaire, qui, via exaltation de l'esprit prédateur néolibéral et du tout-répressif, plonge chaque jour un peu plus notre société dans le marasme et la résignation.
Lilian Mathieu est l'auteur de Les années 70, âge d'or des luttes ? (éditions Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 144 pages, 9,90 euros, février 2010). Il est sociologue, chargé de recherche au CNRS, spécialisé dans l'analyse des mouvements sociaux comme de la prostitution. Il enseigne bénévolement dans le cadre de l'Université Populaire de Lyon, participe à l'animation de la revue Contretemps web et est membre du Nouveau Parti Anticapitaliste. Il co-dirige la collection « Petite Encyclopédie Critique ».
Pour faire venir l'auteur pour un débat (dans une librairie, un cadre militant ou autre), contacter Eve Bourgois aux éditions Textuel <eve.bourgois@editionstextuel.com>.



