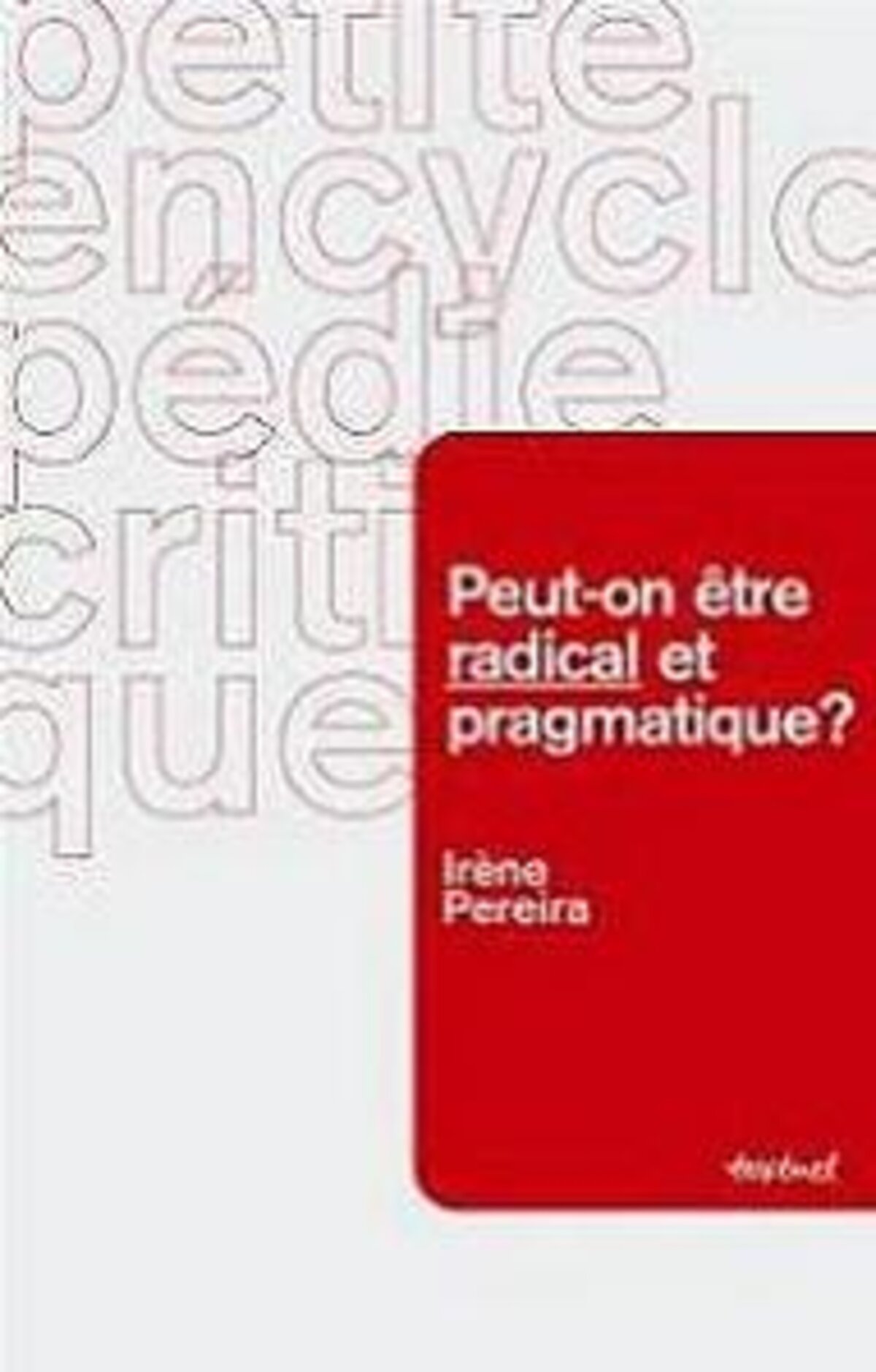
*************************************************
Dans le cadre de la collection « Petite encyclopédie critique », publiée par les éditions Textuel, on m'a demander de « disserter » sur ce problème: l'action militante contestataire : peut-elle être à la fois radicale et pragmatique ?
Dans le prolongement de ma thèse, dirigée par Luc Boltanski, sur l'esprit de la contestation actuelle, née d'une réflexion sur mon expérience militante, j'ai essayé d'analyser cette question.
L'esprit contestataire des mouvements sociaux liés à la gauche radicale actuelle est-il plutôt radical ou pragmatique ?
Lorsque l'on entend le président Nicolas Sarkozy dire de Sud Rail, suite à une grève dans la gare Saint Lazare en janvier 2009, qu'il s'agit « d'un syndicat irresponsable [qui] casse le service public et bafoue l'intérêt des usagers », on pourrait penser que la radicalité est du côté de la gauche contestataire et donc que le pragmatisme se situerait du côté du gouvernement.
Pourtant plusieurs études sociologiques menées sur le militantisme actuel (par exemple par Jacques Ion) ou sur le syndicalisme de Sud PTT (Ivan Sainsaulieu), ont insisté sur le caractère pragmatique du militantisme contemporain.
Ce pragmatisme est opposé par ces sociologues au militantisme léniniste (maoïste, trotskiste, stalinien) qui a dominé la gauche radicale entre les années 1950 et la fin des années 1970. Celui-ci apparaissait comme dogmatique et idéologique: l'action militante était prédéterminée par des principes théoriques élaborés indépendamment de la situation concrète.
Ce qui caractérise le pragmatisme du militantisme actuel, c'est la mise en avant d'une action visant une recherche d'efficacité concrète immédiate. Ce point est en particulier une spécificité du militantisme associatif dans le renouveau contestataire qui est apparu au début des années 1990. Par exemple, l'association Droit au logement lutte en réquisitionnant des logements vides et en y logeant des familles immédiatement.
Le pragmatisme ne se situe-t-il pas du côté de ceux qui s'adaptent à l'économie libérale ? Les politiques gouvernementales actuelles ne sont-elles pas plus pragmatiques que ceux qui s'y opposent ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les militants de la gauche radicale se revendiquent dans leur textes ou dans leur discours comme pragmatiques.
Il existe un sens vulgaire de mot « pragmatique »: être pragmatique, ce serait agir en ne se souciant que de la réussite de son action en s'adaptant au système tel qu'il est sans songer à le transformer.
Pourtant, au sens philosophique de ce terme, le pragmatisme que revendiquent les militants de la gauche radicale me paraît justifié. En effet, le pragmatisme est un courant de la philosophie américaine dont l'un des représentants est John Dewey (1859-1952). Pour ce philosophe, le pragmatisme suppose une continuité entre les moyens et les fins, le pragmatisme est aussi une démarche profondément démocratique. La démocratie comme il l'explique dans son ouvrage Démocratie et éducation (1916), suppose une remise en cause des inégalités sociales: inégalité entre riches et pauvres, entre gouvernés et gouvernants...La démocratie comme méthode implique une participation directe des citoyens aux décisions politiques. C'est ce que John Dewey appelle, dans Le public et ses problèmes (1927), le « self-gouvernement ».
Par conséquent, pour ce philosophe, une politique qui ne se donne par pour objectif la remise en cause des inégalités sociales et qui n'utilise par des méthodes profondément démocratiques de participation directe des citoyens, n'est pas pragmatique.
Les organisations militantes du renouveau contestataire se caractérisent en particulier par leur volonté d'agir en vue d'une société plus démocratique en privilégiant elles-mêmes des modes d'organisation qui mettent en avant la démocratie directe.
Les mouvements sociaux actuels sont-ils radicaux ?
Au sens étymologique, être radical, cela signifie revenir à la racine des problèmes. Or les mouvements actuels (altermondialisme, antilibéralisme...) me paraissent bien souvent ne pas être suffisamment radicaux.
Depuis Rousseau, dans Le discours sur l'inégalité (1755), mais aussi chez Proudhon ou Marx, la radicalité de l'analyse de l'inégalité sociale a consisté à remonter à sa racine, à savoir la propriété privée. Or les mouvements actuels que j'ai cité, bien souvent, ne font pas remonter leurs analyses et leurs revendications à la racine de l'inégalité sociale. Ils ne vont pas jusqu'à revendiquer l'abolition de la propriété privée des moyens de production.
Etre radical aujourd'hui cela se réduit-il à remettre en cause la propriété privée des moyens de production ?
Á partir des années 1970, d'autres mouvements que le mouvement ouvrier ont affirmé leur prétention à une radicalité révolutionnaire : mouvement féministe, mouvement écologiste...Cela signifie que la radicalité aujourd'hui ne peut se réduire à l'abolition de la propriété privée des moyens de production et donc à la remise en cause du capitalisme. Il s'agit aussi de transformer nos manières de produire et de consommer, mais aussi la répartition du soin des enfants et du travail ménager. De manière générale, la radicalité suppose la remise en cause de toutes les formes d'exploitation économique. Mais la critique de l'exploitation économique ne se réduit pas à la critique du capitalisme, mais doit prendre en compte aussi le patriarcat, l'exploitation de la nature et du vivant, ainsi que l'exploitation économique raciste.
Mais la radicalité implique aussi la transformation de l'ensemble du système social, c'est pourquoi la radicalité ne doit pas porter uniquement sur une critique économique, mais également politique et culturelle.
Cela signifie-t-il que radicalité et pragmatisme s'opposent nécessairement ?
Non, il me semble au contraire que le pragmatisme lorsqu'il est exprimé dans toute sa cohérence suppose une radicalité. En effet, puisque le pragmatisme implique une continuité entre les fins et les moyens, alors les moyens, c'est à dire par exemple les revendications immédiates, doivent être en continuité avec les fins, c'est à dire le projet de société que nous désirons mettre en place. Or, si le pragmatisme se donne pour objectif une société radicalement démocratique, c'est à dire où l'inégalité économique a disparue et où les citoyens participent directement aux prises de décision, alors les revendications immédiates doivent être en continuité avec ce projet. C'est ce projet de société qui doit les orienter.
Il y a à mon avis un courant politique qui a pu incarner à un moment l'articulation du pragmatisme et de la radicalité, c'est le syndicalisme révolutionnaire. En effet, celui-ci se fixe une double besogne dans la Charte d'Amiens en 1906: l'amélioration des conditions immédiates des travailleurs et la préparation de l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation des capitalistes.
Or il existe un lien historique entre le pragmatisme philosophique et le syndicalisme révolutionnaire comme le montre par exemple Georges Sorel en affirmant que le projet que se donne pour objectif les syndicalistes révolutionnaires, la grève générale insurrectionnelle, est un instrument pour l'action immédiate. Car dans chaque grève partielle pour une amélioration immédiate, les syndicalistes révolutionnaires s'exercent à la réalisation de ce projet.
Aujourd'hui, les syndicats SUD peuvent apparaître par nombre d'aspects comme les héritiers de ce syndicalisme. Néanmoins, il leur manque d'avoir un projet de société alternatif au capitalisme, à l'Etat, au patriarcat, au racisme, comme celui qu'esquissait la Charte d'Amiens et que décrivent Emile Pataud et Emile Pouget dans leur roman d'anticipation sociale de 1909, Comment ferons nous la révolution ?
En quoi les anarchistes peuvent être considérés, comme les syndicalistes révolutionnaires, comme pragmatiques et radicaux ?
Les anarchistes ont inspiré le syndicalisme révolutionnaire en mettant à la base de la pratique militante non pas la théorie révolutionnaire, mais l'action directe. Cette importance de l'action par rapport à la pensée est une caractéristique de la philosophie pragmatiste. Ainsi le penseur anarchiste Pierre Joseph Proudhon affirme que « la pensée naît de l'action » et qu' « elle doit revenir à l'action ».
La forme d'action par excellence des syndicalistes révolutionnaires, comme des anarchistes, est l'action directe ? Qu'est ce que cela veut dire ? Est-ce synonyme d'attentat, de terrorisme ?
Les anarchistes ont pu pratiquer durant la fin du XIXe siècle des attentats. Cette stratégie a été appelée la propagande par le fait. Néanmoins la propagande par le fait ne se réduit pas aux attentats, écrire un article ou vivre en anarchiste sont aussi des formes de propagande par le fait.
Pour autant, on peut douter que la vague d'attentats anarchistes fut du terrorisme. En effet, le terrorisme suppose des actions aveugles qui visent à semer la terreur parmi la population civile. Or le chercheur Uri Eizenzweig, dans Fictions de l'anarchisme, a montré que la terreur qui a traversé la société civile a davantage été provoquée par la campagne de presse anti-anarchiste que par les attentats ciblés de ces derniers.
Néanmoins, la stratégie de la propagande par le fait fut un échec. Elle intensifia la répression contre les anarchistes et éloigna ceux-ci des masses qu'ils souhaitaient conquérir à leurs idées. Cela conduisit bon nombre d'anarchistes, à l'image de Fernand Pelloutier, à s'investir dans le syndicalisme.
L'action directe pour les syndicalistes révolutionnaires peut désigner des formes d'action légales ou illégales, violentes ou non violentes, mais qui ont pour particularité de ne pas faire appel à l'intervention des représentants politiques. De fait, une action de désobéissance civile non-violente constitue une action directe. Pour les syndicalistes révolutionnaires, la principale forme d'action directe était la grève. Or depuis la loi Olivier en 1864, il s'agissait d'une forme d'action légale, même si à l'époque le fait d'avoir recours à la grève pouvait entraîner une répression sanglante comme l'illustre par exemple le massacre de Fourmies en 1881.
Irène Pereira est l‘auteure de Peut-on être radical et pragmatique ? (éditions Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 144 pages, 9,90 euros, février 2010). C'est une jeune chercheuse, qui a soutenu sa thèse de sociologie sous la direction de Luc Boltanski en juin 2009 à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle est également militante de SUD-Culture Solidaires et de l'organisation politique Alternative Libertaire.
Pour faire venir l'auteure pour un débat (dans une librairie, un cadre militant ou autre), contacter Eve Bourgois aux éditions Textuel <eve.bourgois@editionstextuel.com>.



