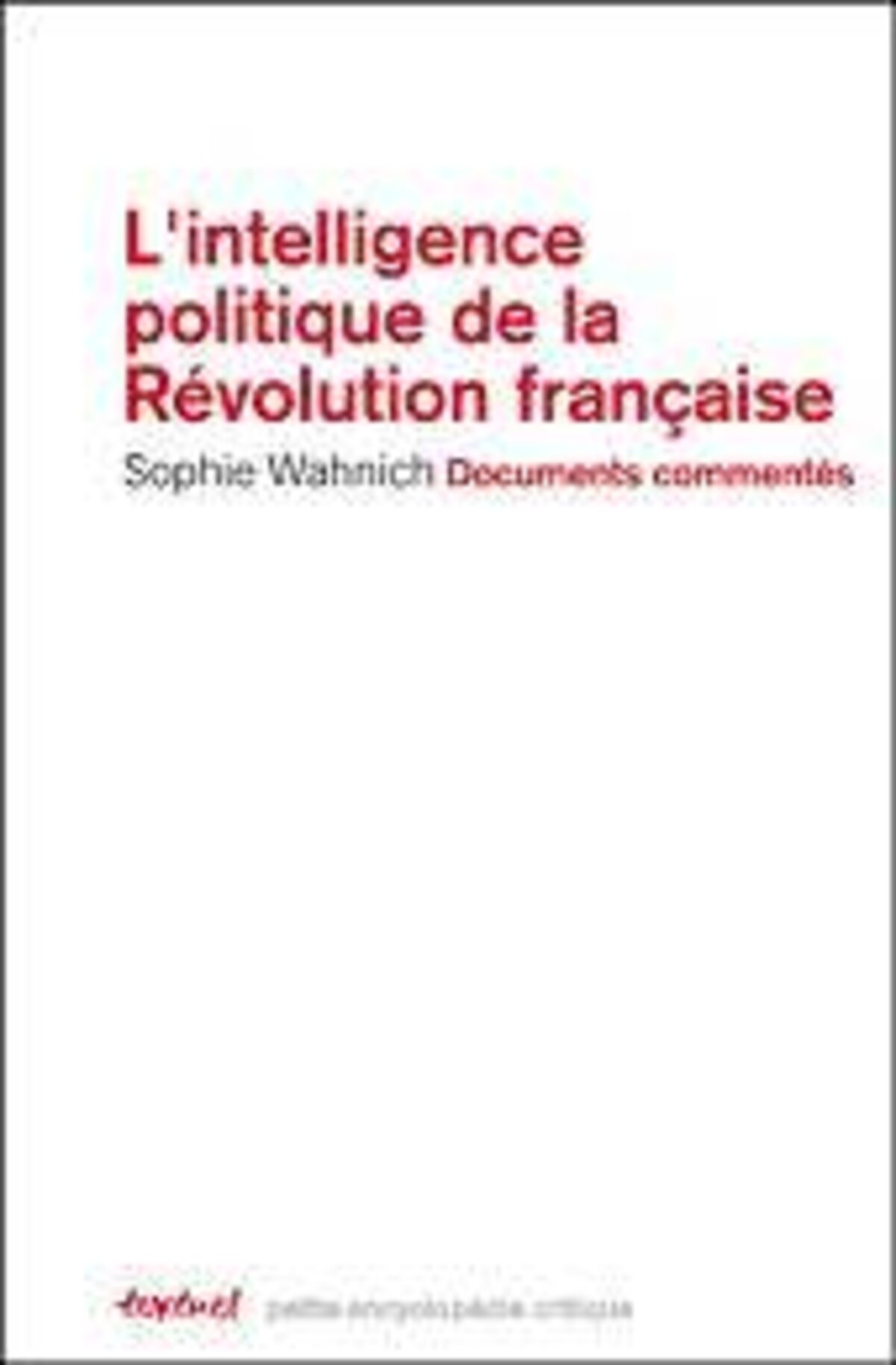
L’historienne Sophie Wahnich est l’auteure de L’intelligence politique de la Révolution française. Documents commentés, un nouveau titre de la collection « Petite Encyclopédie Critique » des éditions Textuel…
*****************************************************
* Quelques extraits de l’introduction de cette anthologie commentée de textes écrits au cours de la Révolution française…
Ce volume n’a pas pour ambition de raconter par les textes l’histoire de la Révolution française. Il souhaite plutôt, sur des questions actuelles, mettre à disposition du public « l’intelligence politique de la Révolution française ». Cette intelligence faite de principes, d’arguments, de convictions, d’une faculté de juger qui passe souvent par le sensible est alors à la fois ferme et diffuse. Il y a certes les grands ténors, grands orateurs des assemblées et des clubs qui auront ici la part belle, mais aussi de grands journalistes, et toute une myriade de porte-parole qui débattent localement et envoient des adresses, des pétitions, des couplets, des poèmes à l’Assemblée, « sanctuaire de la fabrique des lois ». Ces textes permettent souvent de dire l’assentiment ou l’accord avec ce qui s’élabore souverainement, parfois la déception ou le ressentiment. C’est cette variété des manières d’intervenir dans le débat public qu’il nous a également paru utile de montrer, à l’heure où cette multiplicité existe à nouveau dans l’espace virtuel, mais sans connaître d’institutionnalisation dans la vie politique réelle, celle qui conduit effectivement à la fabrique des lois et qui permettait à chacun d’avoir vraiment son mot à dire dans l’élaboration des débats publics et des lois.
La période révolutionnaire est à cet égard à la fois un réservoir d’arguments et de pratiques politiques au sein duquel il est possible de puiser non pas des modèles, bien que souvent l’inventivité de ces hommes et femmes nous subjugue, mais des lumières pour éclairer nos manières d’agir en politique.
[…]
Parmi les questions actuelles qui nous paraissent importantes et qui résonnent avec la Révolution, nous avons choisi celles qui nous semblent cruciales pour notre devenir commun, même si les mots en usage aujourd’hui ne sont pas exactement les mêmes qu’au XVIIIème siècle.
Nous avons décidé de reprendre le dossier à la racine, celle des principes. Est-il possible d’opposer encore aujourd’hui la liberté et l’égalité, de faire de l’une la compagne du libéralisme économique et politique et de l’autre la compagne des régimes contraignants voire totalitaires ? Qu’est-ce qu’être libre ? En quoi l’égalité est-t-elle incluse dans une certaine définition de la liberté qui ne peut pas ne pas être réciproque ? Quelles sont les institutions qui mettent en danger la liberté politique et celles qui la soutiennent ? Voici les questions auxquelles nous essayons de répondre dans le premier chapitre.
Dans le second chapitre, nous avons pris à bras le corps la question de l’égalité politique et sociale et des mécanismes d’inclusion et d’exclusion au sein de la cité révolutionnaire. Les butées révolutionnaires sont ici souvent encore les nôtres, mais la perspicacité de la critique est alors aiguë. Nous l’avons privilégiée qu’il s’agisse de lutter contre des préjugés ou de simples excès de prudence. Mais nous n’avons pas négligé pour autant la grande conquête que constitue l’abolition de l’esclavage.
Le troisième chapitre tente de réfléchir la question de la violence qui circule dans un moment révolutionnaire. Qui la souhaite ? Qui la refuse ? Qui l’active ? Qui la retient ? Où se loge-t-elle ? Quand es-telle inévitable voire nécessaire ? Le peuple a souvent été accusé d’être violent. Dans ce petit dossier nous avons voulu montrer comment il avait surtout été violenté, en particulier par la liberté illimitée du commerce et les outils fabriqués pour la protéger au détriment de la liberté politique. Nous revenons in fine sur le faire mourir souverain, non pour désactiver l’effroi qu’il suscite mais pour comprendre comment « un peuple sensible et bon » peut être acculé à ce mode de résolution des conflits.
Enfin, le quatrième chapitre revient sur la question religieuse, une question difficile qui n’a jamais cessé d’être débattue par les révolutionnaires qui se sont pour certains méfiés des évidences éradicatrices et constamment appuyés sur la liberté de conscience pour lutter contre deux dangers majeurs : une société dénuée de foi, c’est-à-dire trop facilement en proie au découragement, une société adossée à une religion révélée nationale qui donnerait à cette dernière un pouvoir exorbitant. Ce que nous appelons laïcité est alors indissociable de la notion de religion civile qui est devenue pour nous obscure. Nous aurons tenté au moins de la clarifier. […]
* Sommaire du livre :
Introduction : La Révolution est un laboratoire politique
Partie I : De la liberté politique
1 – Principes
2 – L’espace public démocratique
3 - Des dangers de la puissance publique en général et du pouvoir exécutif en particulier
Partie II : Egalité, inclusion et exclusion politique et sociale
1 – Les femmes dans la cité
2 – Les domestiques
3 - L’inclusion des bourreaux, des comédiens, des juifs et des protestants
4 – L’abolition de l’esclavage
5 – Les étrangers dans la cité
Partie III : Violence et retenue de la violence
1 – L’émeute populaire, la loi martiale
2 – Libéralisme économique et critique libérale du libéralisme
3 – Retenir la violence/faire mourir
Partie IV : Liberté de conscience, conscience publique et laïcité
1 - Contre la déclaration d’une religion nationale
2 - Une rigueur anticléricale à contrôler
3 - Devenir homme, religion civile, religion des devoirs de l’homme ?
****************************************
Sophie Wahnich est historienne et directrice de recherche au CNRS. Elle est l’auteure de L’intelligence politique de la Révolution française. Documents commentés (192 pages, 16 euros, février 2013). Elle a aussi publié, entre autres : L’Impossible Citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française (Albin Michel, 1997, réédition 2010) et La Longue Patience du peuple. 1792. Naissance de la République (Payot, collection « Critique de la politique », 2008). Elle intervient dans le film documentaire de Thomas Lacoste, Notre Monde, sorti le 13 mars 2013.



