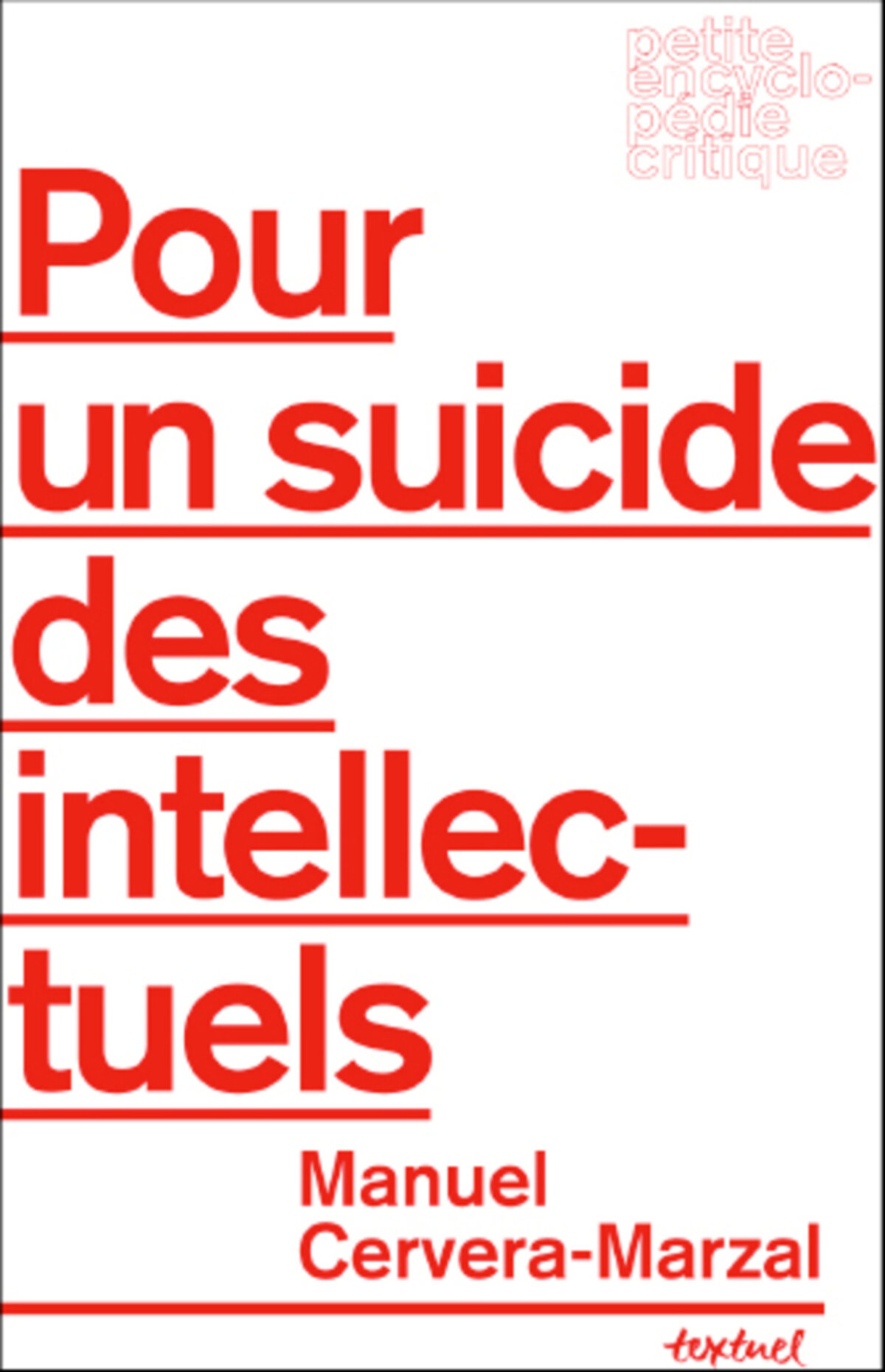
Agrandissement : Illustration 1
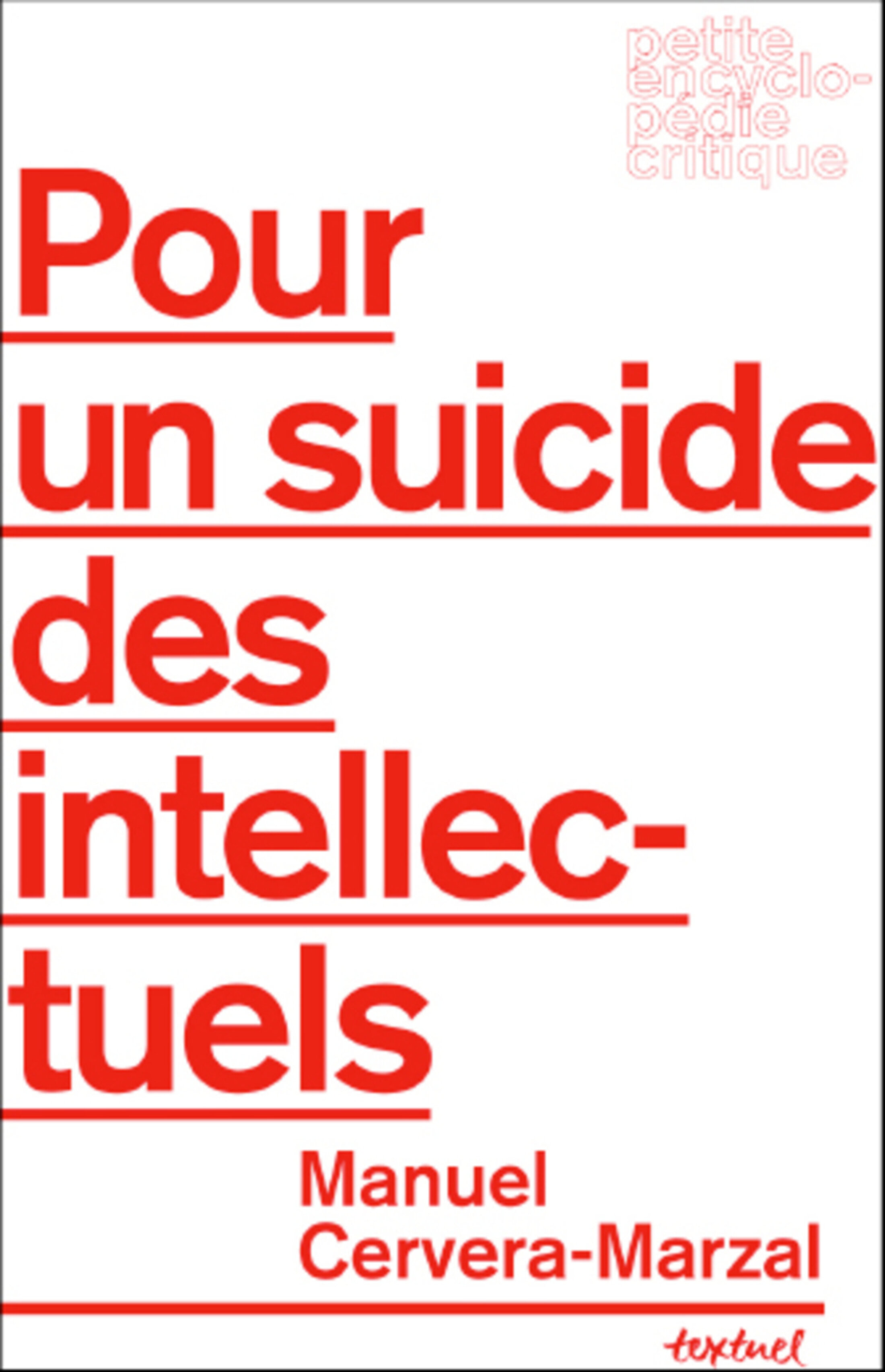
Cet ouvrage part d’un constat – l’espace médiatique est actuellement saturé par des intellectuels néoconservateurs – et essaie d’apporter une réponse originale à une question aussi vieille que la catégorie des intellectuels : quel rôle peuvent-ils jouer dans la marche du monde ? Poser la question, c’est déjà en partie y répondre : les intellectuels n’ont pas à se tenir à l’écart des soubresauts de leur époque. Ils ont une responsabilité dans la situation actuelle. D’abord parce qu’ils sont responsables de ce qu’ils font – ceux qui alimentent les préjugés islamophobes et/ou antisémites dans une époque aussi trouble que la nôtre devront en rendre compte – mais, aussi et surtout, parce qu’ils sont responsables de ce qu’ils laissent faire, de toutes les injustices face auxquelles ils ferment les yeux. Nombre d’intellectuels restent prisonniers d’une sorte de purisme qui les conduit à célébrer pleutrement « l’art pour l’art », la « neutralité » des sciences sociales ou l’objectivité « factuelle » des journalistes. Cette posture repose sur l’idée que s’engager pour une cause entacherait forcément la pureté du travail journalistique, artistique ou scientifique. C’est de cet apolitisme qu’il convient de se défaire si l’on souhaite, comme je le crois urgent, réconcilier les idées et l’action.
Mais la proposition centrale de ce livre va plus loin. Ce que j’invite à abolir c’est, en définitive, la catégorie même des intellectuels, en tant que catégorie sociale séparée du reste de la population. Qui sont les intellectuels ? Des gens payés pour produire des idées. Des gens rémunérés pour réfléchir, penser, chercher, enquêter, lire, écrire, informer, prodiguer, raconter, émerveiller, élucider, etc. Concrètement : des artistes, des journalistes, des chercheurs, des écrivains, des enseignants, etc. Evidemment, les frontières externes de ce groupe sont poreuses, et ses différences internes sont nombreuses : quoi de commun entre des intellectuels médiatiques comme Onfray et Finkielkraut et les dizaines de milliers d’intellectuels précaires sans qui l’université et la presse françaises seraient immédiatement paralysées ? Quoi de commun entre les vitupérations nauséabondes d’un Eric Zemmour et la quête d’émancipation d’un Jacques Rancière ? En dépit de ces différences, on peut grosso modo s’accorder sur le fait qu’un intellectuel est une personne rémunérée pour produire les idées. Cela ne signifie aucunement que les intellectuels aient le monopole de l’intelligence, ni qu’ils produisent réellement des idées. Simplement, on les paie pour qu’ils fassent fonctionner les cerveaux. Mais, comme on sait, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés…
Ainsi définie, la catégorie des intellectuels jouit de certains privilèges relatifs : leurs activités sont généralement mieux rémunérées, mieux valorisées et plus épanouissantes que celles des travailleurs qui fabriquent nos grille-pains, ramassent nos ordures, bâtissent nos logements et nettoient les bureaux. Or, cela n’est plus à démontrer, on est rarement éboueurs ou ouvriers du bâtiment par libre choix. Notre société, structurellement inégalitaire, assigne toute une partie de la population au « sale boulot » et réserve les fonctions les plus enviées – parmi lesquelles j’inclus les professions intellectuels – à un petit nombre de privilégiés (eux-mêmes parfois férocement exploités par des groupes encore plus privilégiés, comme en témoigne le cas des intellectuels précaires mentionné précédemment). La donne est finalement assez simple : dans cette société profondément hiérarchisée, les intellectuels constituent la fraction dominée de la classe dominante. Ils sont vers le haut de la pyramide mais, sauf pour les mieux lotis d’entre eux, plutôt vers le bas de la moitié haute. Le sommet de la pyramide est trusté par les élites économiques et politiques (les mêmes, de plus en plus souvent) et non par les élites intellectuelles.
Dans ces conditions, je plaide pour un suicide des intellectuels, qui n’est rien d’autre que l’abolition complète de la pyramide sociale et, par conséquent, la disparition des intellectuels en tant que catégorie séparée du reste de la population. Le suicide des intellectuels, ce n’est pas le nivellement pas le bas (retirer aux intellectuels d’aujourd’hui le confort dont ils jouissent) mais, au contraire, la démocratisation radicale de cette catégorie, afin que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent enfin s’introduire au banquet des festivités de la pensée. Lorsque nous serons tous des intellectuels alors, par définition, il n’y aura plus d’intellectuels. Ils seront morts en tant que groupe spécifique.
**************************
* Deux vidéos de présentation du livre :
- une présentation d’environ 10 secondes :
- un entretien d’environ 2 mn :
Sommaire de Pour un suicide des intellectuels par Manuel Cervera-Marzal
(Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », février 2016, 144 pages, 14,90 euros)
1. Une vocation critique ?
2. Intellectuel et intelligence : deux questions distinctes
3. Proposition de suicide collectif
4. Les privilèges du métier
5. Les a-tellectuels
6. Le fantasme de têtes sans corps et de corps sans tête
7. Les dominants sont aussi victimes de leur domination
8. Le sale boulot est une construction sociale
9. La précarité comme ferment de radicalité…ou de ressentiment conservateur
10. Démocratiser la profession intellectuelle
11. De quel côté sommes-nous ?
12. L’engagement éthique et politique des intellectuels
13. La potentialité subversive des livres
14. Emprunter la langue de l’ennemi
15. Le roman démocratique
16. La théorie critique
17. Les vertus du global face aux dangers d’une pensée morcelée
18. L’intellectuel collectif ou la mutualisation des savoirs
19. L’intellectuel apatride contre l’intellectuel spécifique
20. Le dilemme de l’intellectuel : ne pas parler au nom des autres mais ne pas non plus rester muet devant les oppressions
21. Ecoute-t-on réellement les intellectuels ?
22. L’équilibre précaire entre engagement et distanciation
23. Dire la vérité au pouvoir ?
24. L’effet contreproductif du déconstructivisme épistémologique
25. Le problématique statut politique de la vérité
26. Les tribulations de l’intellectuel utopique
**********************
Manuel Cevera-Marzal est docteur en science politique. Il est attaché d’enseignement et de recherche à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. À 28 ans, ce jeune chercheur aura très bientôt publié 7 ouvrages, dont Gandhi. Politique de la non-violence (Michalon, collection « Le bien commun », 2015), Désobéir en démocratie. La pensée désobéissante de Thoreau à Martin Luther King (Aux forges de Vulcain, 2013), Pour un suicide des intellectuels (Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », février 2016), dont il parle ci-dessus, et quelques semaines après Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ? (Le Bord de l’eau, collection « La Bibliothèque du MAUSS », à paraître en avril 2016).



