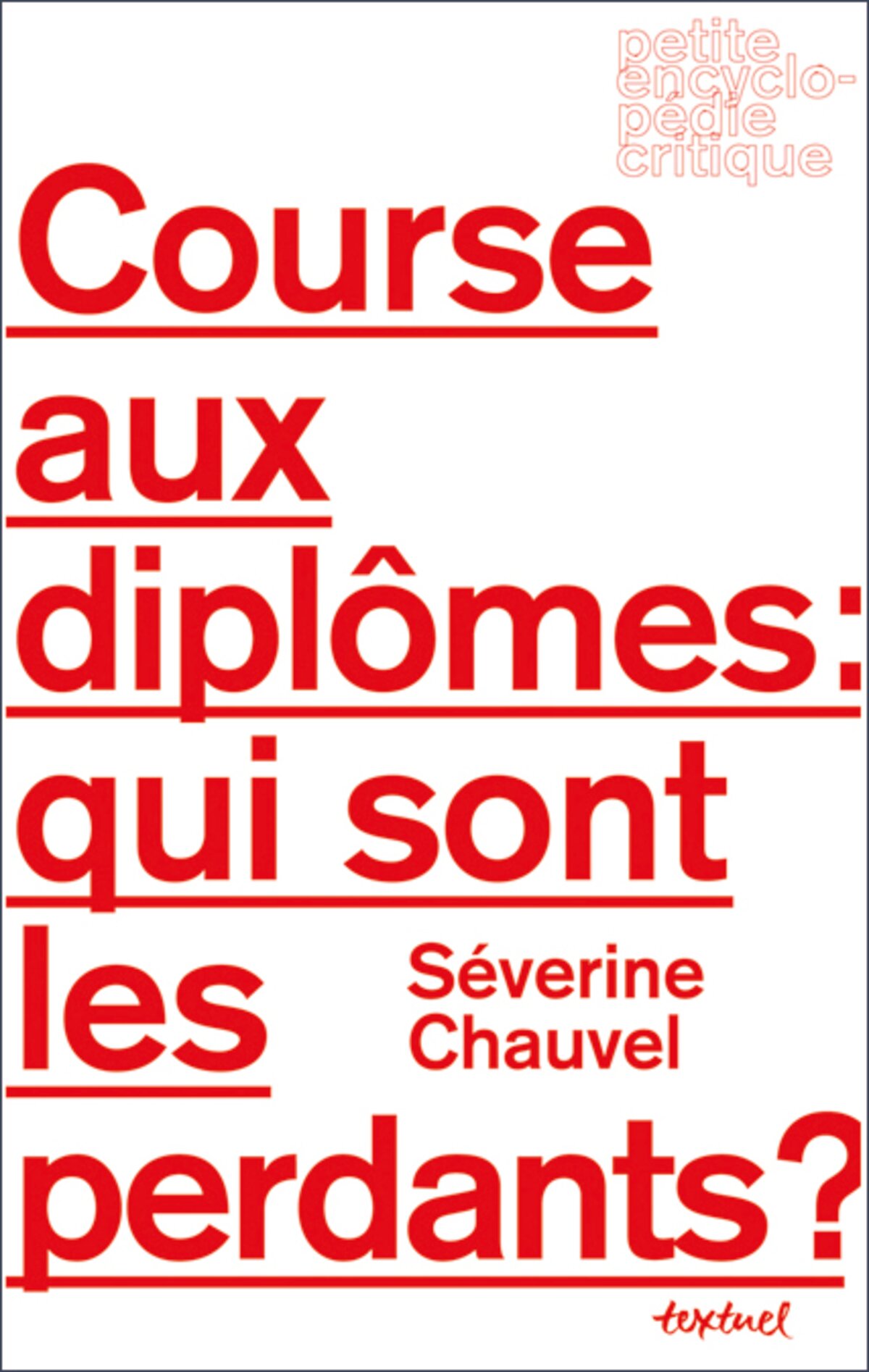
Agrandissement : Illustration 1
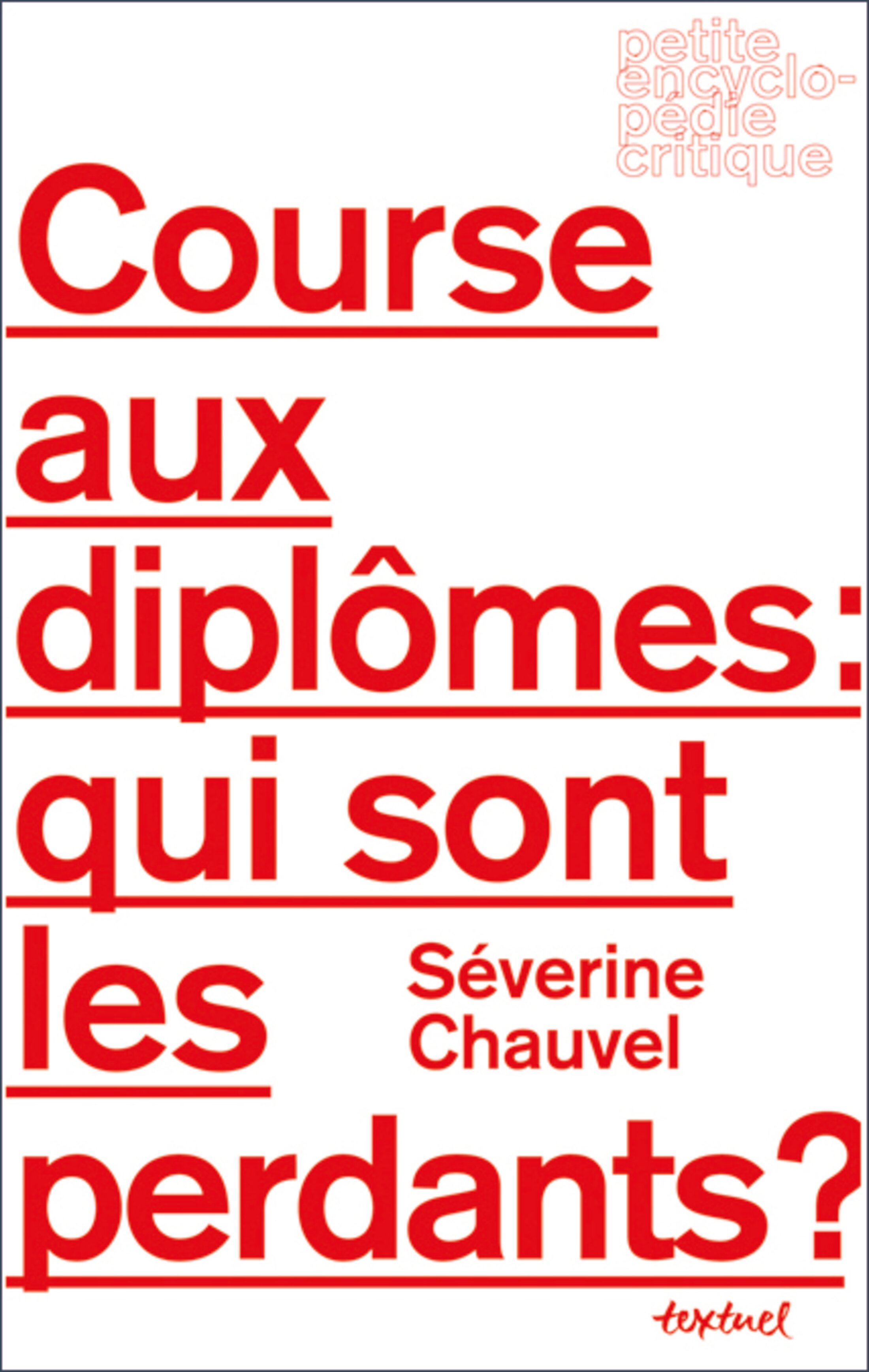
Les propositions du programme de Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 2017, poursuivent la politique de hausse du niveau d’éducation débutée il y a trente ans en France et en Europe sans en questionner les fondements. Celle-ci s’accompagne d’une politique de lutte contre les inégalités à l'école à travers deux thèmes phares : la création de postes d’enseignant-e-s dans l’Éducation nationale et la lutte pour une plus grande mixité sociale et scolaire des établissements. Si la question de l’offre scolaire et des conditions de scolarisation est décisive pour le succès de cette lutte, elle est insuffisante. Quant à la question de la mixité au sein des établissements, elle reste floue et renvoie la responsabilité des inégalités aux comportements des familles. Concernant l’enseignement supérieur, il s’agit de poursuivre les politiques engagées par Geneviève Fioraso avec le développement d’universités dites de proximité.
Dès 1985, des objectifs chiffrés étaient affichés avec le célèbre mot d’ordre « 80% d’une génération au niveau du baccalauréat », lancé par le ministre de l’Education nationale de l’époque, Jean-Pierre Chevènement. Entre 1985 et 2015, la multiplication par deux et demi du taux de bacheliers pour une génération (qui passe de 29 % à 77 %) a, par la suite, intensifié la concurrence entre les individus en matière d'accès aux meilleurs titres scolaires. En effet, diplômer le maximum d’individus, loin de fabriquer des égaux, a généré de nouvelles normes de sélections et de hiérarchies scolaires. Cette compétition se nourrit des aspirations à la fois des enfants de milieux populaires pour accéder à une meilleure position sociale que leurs parents et des visées démocratiques des décideurs politiques. Les familles de milieux populaires ont pris au sérieux l’idéologie méritocratique de l’école et reconnaissent le rôle de plus en plus déterminant des titres scolaires en matière d'accès à l'emploi. Mais ces aspirations se heurtent à un paradoxe car l’augmentation du nombre de diplômés s’inscrit in fine dans une hiérarchisation des filières qui renforce les inégalités entre les élèves. Les diplômes sont ainsi à la fois désirés et accusés d’être des miroirs aux alouettes. Ils apparaissent comme un sésame indispensable pour accéder au marché du travail mais ils ne garantissent pas de trouver un emploi.
Dans un contexte marqué par l'accroissement du nombre de diplômé-e-s, les enfants de familles culturellement favorisées finissent toujours par s’en sortir mieux que les autres. C’est la possession d’autres ressources comme les capitaux culturels (connaissances, diplômes des parents, « bonnes manières »), sociaux (les réseaux de relation) et économiques (patrimoine, revenus) qui fait la différence entre diplômés. L’héritage culturel familial reste déterminant. Représenter le diplôme comme la clef de l’accès à l’emploi conduit à faire croire que cet accès récompense les efforts personnels de chacun selon son mérite. Or l’augmentation du niveau d’éducation ne permet pas une véritable démocratisation car elle postule que les étudiant-e-s partent à égalité et agissent ensuite comme des entrepreneurs de leur avenir professionnel. Cela conduit à nier l’impact des rapports de pouvoir et les effets des discriminations pendant la scolarité et sur le marché du travail. Les diplômes, qui sanctionnent un niveau d’étude et une spécialité, marquent par ailleurs durablement les individus. Une fois engagé dans une filière, dans une école, ou vers un diplôme, il reste en France difficile d’en changer.
Comment appréhender les logiques de sélections des élèves tout au long de leur parcours scolaire ? Le nouveau documentaire de Claire Simon, intitulé Le concours (sorti en salle le 8 février), qui donne à voir les auditions des élèves de l’école de cinéma la Fémis et la délibération des jurys, est passionnant à cet égard. Au sein de la « jeunesse dorée », les évaluations dont font l’objet les élèves et les critères de sélection au concours jouent parfois sur une connivence de classe comme certains membres du jury le soulignent eux-mêmes. Malgré la conscience du jury de participer à la reproduction sociale, la présentation corporelle des élèves et leur aisance à l’oral font partie prenante des critères de sélection lors de la dernière étape du concours, le « grand oral ». Le film montre sans grande surprise comment les classements scolaires sont des jugements sociaux qui se transforment en « capacités » naturelles. Mais il montre aussi que les dispositifs matériels qui organisent la sélection jouent un rôle dans les décisions finales : ils favorisent plus ou moins les désaccords entre membres du jury et donc les chances accordées aux unes et aux autres pour entrer dans l’élite artistique.
Au final, qui sont les perdants et les perdantes de cette course aux diplômes ? La réponse de Robert Castel est similaire à celle que proposait Pierre Bourdieu il y a trente ans : « en fin de course, les perdants ont beaucoup plus perdu, parce qu’il est plus invalidant d’être sans diplôme ou sous-diplômés aujourd’hui »[1]. Mais il ne faut pas oublier celles et ceux qui sont aujourd’hui diplômé-e-s malgré eux, dans une filière non désirée et dévalorisée, pour répondre à l’injonction politique. Au-delà de ces dernier-e-s les conséquences de ces politiques sont importantes pour l’ensemble des élèves scolarisés. Les apprentissages sont parfois relégués au second plan derrière la recherche d’une certification. En outre, l’Etat exerce de moins en moins de contrôle sur les diplômes, dans la mesure où l'on observe la multiplication d’instituts de formation privés. Les derniers objectifs chiffrés d’allongement des études reposent sur des inconnues. Comment évoluent les aspirations des familles ? Comment ces objectifs sont-ils encadrés ? Comment seront reçus les étudiants plus nombreux dans l’Enseignement supérieur par un service public ouvert à tous ? Autrement dit, comment sortir d’une politique qui prend le diplôme pour un fétiche ?
Les effets délétères de la course aux diplômes peuvent alimenter la réflexion sur les leviers à mobiliser pour ne pas réduire les politiques éducatives à des objectifs quantifiés, et réinscrire ces politiques dans les réalités sociales auxquelles elles s’appliquent. Ces leviers sont de triple nature. Un premier consisterait à proposer aux jeunes à partir de 16 ans, une fois sortis de l’obligation scolaire, une allocation universelle décente pour leur éviter d'être confrontés à des difficultés économiques[2]. Une des raisons principales des arrêts d’études des lycéen-ne-s et des étudiant-e-s est liée à la recherche d’un travail pour subsister. Un second levier serait de favoriser les apprentissages explicites pour que la connaissance des règles du jeu ne soit pas réservée à certain-e-s, tout en garantissant des conditions d’enseignements convenables. Un troisième levier consisterait à proposer des politiques de discrimination positive qui prennent en compte à la fois les individus et les territoires. Cela passe par des formations initiales et continues des enseignant-e-s. Si ce livre pointe les responsabilités des politiques éducatives et de l’institution scolaire dans la production des inégalités, il ne s’agit pas pour autant d’accuser ou de culpabiliser les professionnel-le-s du secteur scolaire : de véritables politiques d’égalité ne pourront s’élaborer qu’au prix de la compréhension de ces mécanismes.
***********
Séverine Chauvel est sociologue, maîtresse de conférences à l’université de Paris-Est-Créteil, membre du LIRTES et co-directrice de l’Observatoire universitaire international d’éducation et de prévention. Elle a notamment publié (avec Fabrice Dhume et Suzanna Dukic) De l’(in)égalité de traitement selon « l’origine » dans l’orientation et les parcours scolaires (La Documentation française, 2011).
Séverine Chauvel, Course aux diplômes, qui sont les perdants ?, Paris, Textuel, coll. « Petite encyclopédie critique », 144 p. 13,90 €.
[1] Robert Castel, La discrimination négative, Seuil, 2007, p. 52.
[2] ACIDES, Arrêtons les frais ! Pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, Paris, éd. Raisons d’agir, 2015.



