Prostitution, quel est le problème ? est la traduction approximative d’une question — what’s wrong with prostitution ? — qui a donné son titre à plusieurs réflexions de philosophes ou sociologues anglo-saxon.ne.s[1]. L’ambition du présent ouvrage rejoint celle de ces textes, à savoir tenter d’identifier ce qui rendrait la prostitution intolérable et ferait de sa disparition un impératif. L’exercice est moins simple qu’il y paraît. Non que les objections à adresser à la prostitution soient difficiles à identifier ; celles-ci sont au contraire nombreuses et souvent convaincantes. Citons-en quelques-unes parmi les plus évidentes. La prostitution est détestable car elle affecte des personnes vulnérables (en majorité des femmes en situation précaire, des migrant.e.s, des membres de groupes stigmatisés, des personnes aux parcours traumatiques, etc.), expose à une multiplicité de périls (stigmatisations, discriminations, agressions, infections sexuellement transmissibles, troubles psychologique, etc.), donne lieu à des formes particulièrement odieuses d’exploitation (proxénétisme, traite des êtres humains, etc.), participe d’une marchandisation de l’humain, relève d’un usage sexuel du corps d’autrui fondé sur la négation du désir de celui ou celle qui vend ses prestations… On aura reconnu dans cette liste le fonds du discours des mouvements favorables à l’abolition de la prostitution et ardents promoteurs de la loi « renforçant la lutte contre le système prostitutionnel » adoptée au printemps dernier.
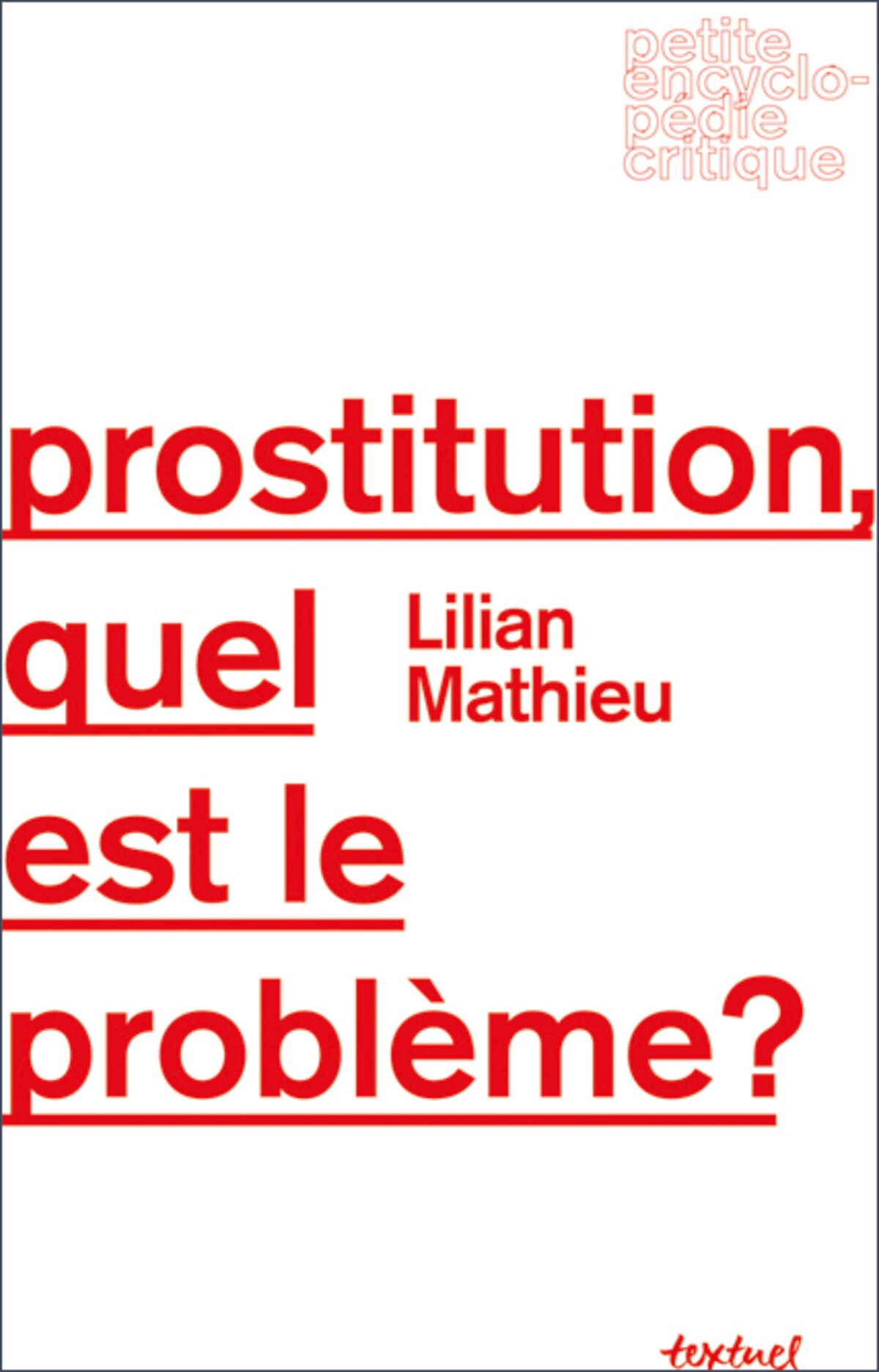
Agrandissement : Illustration 1
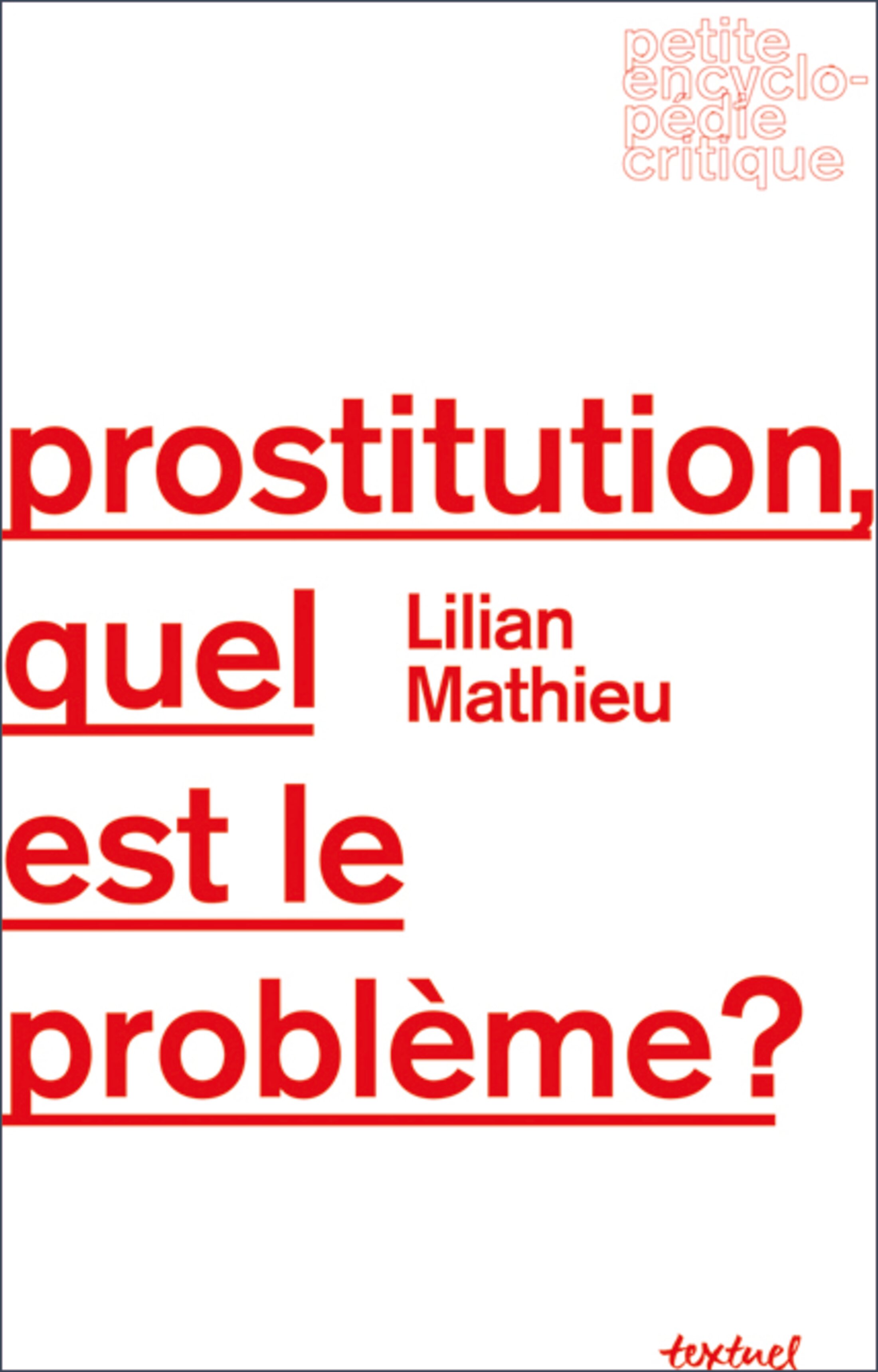
Remarquons tout d’abord que pour être largement admises, ces objections sont assez récentes et témoignent de la diffusion d’une modernité sexuelle à laquelle ont contribué les mobilisations féministes et homosexuelles. De fait, si la prostitution était déjà condamnée au Moyen-âge ou à l’époque victorienne, c’était avec de tous autres arguments, en l’occurrence davantage soucieux de la stabilité de l’ordre hétérosexuel monogame et du maintien des privilèges patriarcaux que de l’exigence contemporaine d’égal épanouissement des partenaires.
Cette relativité historique des arguments opposés à la prostitution n’est pas leur principal problème — on peut considérer qu’il a pu y avoir, au moins sur ce plan, un certain progrès de l’histoire. La difficulté apparaît en revanche dès qu’on les mobilise pour tenter de fonder une spécificité irréductible de la prostitution — i.e. dès qu’on tente de répondre à la question (évidemment piégée) posée dans le titre de l’ouvrage : la prostitution poserait un problème qui lui serait propre et qui légitimerait de lui opposer un refus ferme et définitif.
Poser la question dans ces termes expose à un péril intellectuel particulièrement délicat, celui de l’essentialisme. Chercher la raison ultime sur laquelle fonder une hostilité à la prostitution, c’est en effet présupposer qu’il existerait une essence de la sexualité vénale, un socle commun qui unifierait toutes ses formes historiquement connues par-delà l’extrême diversité de leurs expressions phénoménales, et qui justifierait de les condamner dans leur ensemble. Les impasses de l’essentialisme sont connues en philosophie depuis que Wittgenstein[2] a averti de la vanité de la recherche d’une substance commune derrière l’usage d’un même substantif. L’essentialisme, ici, consisterait à postuler qu’en utilisant le même terme de prostitution, on pourrait assimiler sans plus d’effort la condition contemporaine d’un travesti sans-papier séropositif, qui survit en bradant des fellations en bordure de route départementale, et celle d’une « grande cocotte » du Second Empire ruinant ses amants en se faisant construire un hôtel particulier somptueux en échange d’une intimité dépassant largement la seule sphère sexuelle. On le voit, le retour au « sol raboteux » de la réalité empirique pose d’importants problèmes à l’essentialisme.
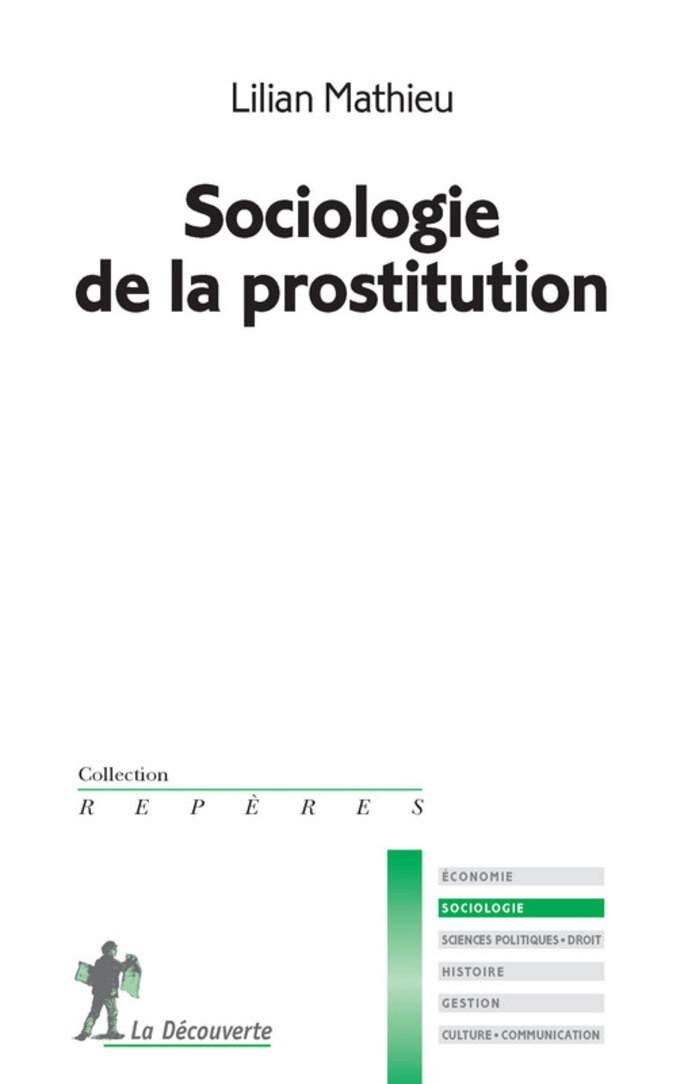
Agrandissement : Illustration 2
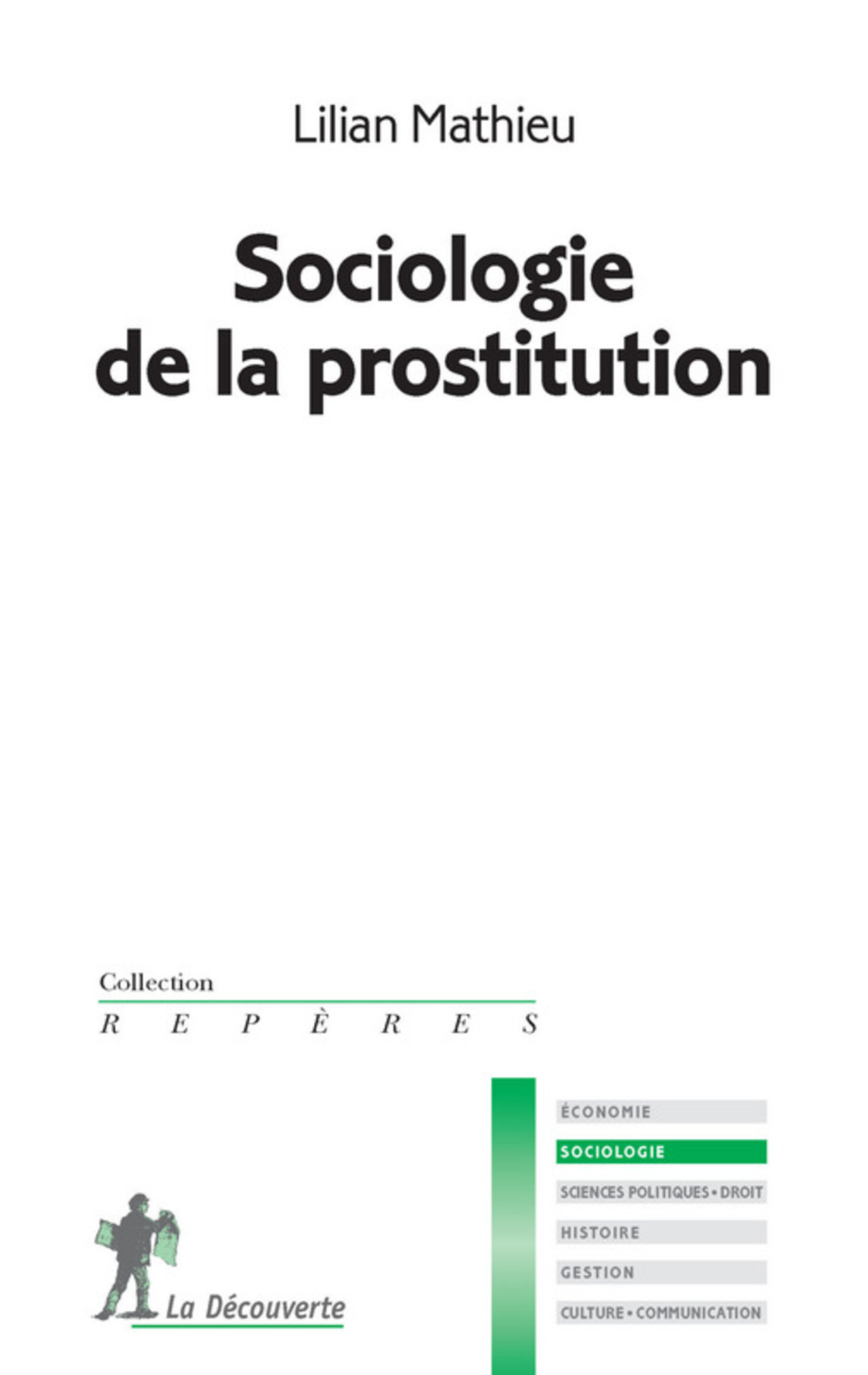
Invoquer une essence de la prostitution est aussi une opération de spécification par différenciation : c’est chercher sa singularité ultime, ce qui la distingue d’autres phénomènes entretenant quelque similarité avec elle et, donc, ce qui fonde l’exceptionnel de son intolérable. Là encore, la difficulté est au rendez-vous car on constate bien vite que les objections adressées à la prostitution atteignent bien au-delà de leur cible. Si la prostitution est critiquable en ce qu’elle nie le désir de l’un des partenaires, il est douteux qu’elle ait le monopole de cette négation et le projet d’abolir les contacts sexuels sans désir réciproque devrait se donner pour priorité l’abolition du couple monogame, où ils sont probablement plus nombreux, avant celle de la prostitution. Même chose s’agissant de la question du consentement, dont il est entendu qu’il ne peut à lui seul légitimer la prostitution — mais pas plus qu’il ne justifie d’autres conduites, qu’elles soient sexuelles, professionnelles ou autres. Se prostituer par nécessité doit être combattu non parce qu’il s’agit d’une vente de services sexuels mais parce que cela relève d’une contrainte imposée par l’absence d’alternative et que cela constitue une atteinte à l’autonomie individuelle. Il est hors de doute que la prostitution puisse être une activité pénible et dangereuse, endossée faute d’alternative, soumise à l’exploitation et structurée par des rapports inégalitaires de sexe, de classe et de race — mais c’est le cas de bon nombre d’activités que des millions de salariés sont contraints à exercer sans pour autant susciter l’indignation des tenants de l’abolition de la prostitution.
Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point, à savoir les rapports entre prostitution et travail. Identité entre les deux plaident les partisans d’une reconnaissance du « travail du sexe » ; altérité radicale selon les tenants de l’abolition de la prostitution, qui l’assimilent plutôt à l’esclavage — en oubliant pour le coup que travail et esclavage peuvent eux aussi entretenir d’étroites proximités (ce dont avaient bien conscience les penseurs socialistes du XIXe siècle). Il n’est de ce point de vue pas sans ironie que la loi « renforçant la lutte contre le système prostitutionnel » ait été promulguée au moment où débutait la discussion du projet de loi El Khomri portant réforme, ou plutôt fragilisation, du droit du travail. Outre la pénalisation des clients des prostituées, cette loi annonce la mise en place de « parcours de sortie de la prostitution ». Sortir de la prostitution, bien sûr, mais pour aller où ? Vers le marché du travail, bien évidemment[3] — ce marché du travail que la même majorité gouvernementale vient d’un peu plus livrer à la domination du patronat.
Telle qu’elle a été invoquée par les promoteurs de la loi contre le « système prostitutionnel », l’irréductible et monstrueuse singularité de la sexualité vénale aboutit à une sorte de « tout sauf la prostitution » qui exige de ne guère se montrer regardant sur la nature des alternatives. De fait, la sommation à se réinsérer instaurée par la loi aboutit à un commandement à accepter les emplois le plus souvent sous-payés, pénibles et disqualifiés que le marché du travail impose aux femmes peu diplômées qui forment le gros des effectifs de la prostitution[4]. Pour les prostituées françaises[5], l’alternative envisagée par les promoteurs de la loi paraît être entre esclavage prostitutionnel et travail plus ou moins forcé. On a connu horizon d’émancipation plus enthousiasmant.
Marx disait dans une note des Manuscrit de 1844 que « la prostitution n’est qu’une expression particulière de la prostitution générale de l’ouvrier ». Il serait temps de redécouvrir que la nécessaire dénonciation des violences et exploitations qui trament l’exercice ordinaire de la prostitution implique aussi d’en faire un opérateur critique, à même d’examiner la légitimité d’autres institutions ou pratiques que le présupposé de son irréductible spécificité laisse ordinairement à l’abri de toute interrogation.
Sommaire
Introduction
Chapitre 1. Une sexualité sans désir est-elle légitime ?
1. Et d’abord, la sexualité est-elle légitime ?
1.1. Hors le mariage, point de salut
1.2. Une violence intrinsèque
2. Pour un pluralisme sexuel
2.1. Tentations puritaines
2.2. Se construire comme sujet par la sexualité
3. Genre et prostitution
3.1. La sexualité contre autre chose qu’elle-même
3.2. Une relation asymétrique
3.3. Le corps, le sexe et le moi
Chapitre 2. Les prostituées peuvent-elles consentir ?
1. Le consentement, clé des possibles
1.1. Un principe juridique
1.2. Un individualisme radical
2. Qui peut consentir ?
2.1. Une dissolution du consentement — et de sa critique
2.2. Consentement et résignation
3. Que sont les prostituées ?
3.1. Une vulnérabilité consubstantielle
3.2. Le penchant paternaliste
Chapitre 3. Peut-on vendre son corps ?
1. Se vendre
1.1. Est-on propriétaire de soi ?
1.2. Le corps et le soi
2. Esclavage et prostitution
3. La prostitution critique du travail
3.1. La lente émancipation de l’esclavage salarial
3.2. Un sale boulot
Conclusion. Pour un désenchantement du sexe
Lilian Mathieu est sociologue, directeur de recherche au CNRS (Centre Max Weber, ENS de Lyon). Spécialiste reconnu de l’étude de la prostitution, il a consacré de nombreux ouvrages à ce sujet, parmi lesquels Mobilisations de prostituées (Belin, 2001), La Condition prostituée (Textuel, 2007), La Fin du tapin. Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution (François Bourin 2014) et Sociologie de la prostitution (La Découverte, 2015).
[1] En l’occurrence Carole Pateman, « What’s Wrong with Prostitution ? », in The Sexual Contract, Stanford University Press, 1988 (tr. fr. Le Contrat sexuel, Paris, La Découverte, 2010) ; Christine Overall, « What’s wrong with prostitution? », Signs, 17 (4), 1992, p. 705-720 ; Igor Primoratz, « What’s wrong with prostitution? », Philosophy, 68, 1993, p. 159-182 ; Elizabeth Bernstein, « What’s wrong with prostitution? What’s right with sex work? », Hasting Women’s Law Journal, 10, 1999, p. 91-117. Ces travaux, qui donnent à la question posée des réponses pour le moins contrastées, sont présentés et discutés dans mon propre ouvrage.
[2] Ludwig Wittgenstein, Le Cahier bleu et le cahier brun, Paris, Gallimard, 1965, p. 45.
[3] En tout cas pour les prostituées françaises puisque c’est le retour au pays qui est posé comme seul horizon à moyen terme pour les étrangères sans-papiers, qui composeraient la majorité des effectifs de la prostitution dans notre pays. Ajoutons que dans leur cas, la « sortie de la prostitution » relève d’une forme de contrainte puisqu’elle conditionne l’obtention d’un titre de séjour temporaire : l’étrangère qui persisterait à se prostituer s’expose à être expulsée en tant que migrante en situation irrégulière. Une telle menace ne pesant pas, par définition, sur les Françaises qui entendraient continuer à se prostituer, le dispositif instaure de fait une préférence nationale en matière d’activité prostitutionnelle.
[4] Une connaissance du monde de la prostitution maintenant longue de vingt-cinq ans m’a permis de reconstituer les parcours de personnes rencontrées comme prostituées mais désormais réinsérées. Plusieurs occupent aujourd’hui des emplois d’aide à domicile auprès de personnes dépendantes. Autrefois en contact avec le sperme de leurs clients, elles s’occupent aujourd’hui de nettoyer l’urine et les selles de celles et ceux dont elles prennent soin, tout en gagnant moins d’argent. Considérer que l’essentiel est qu’elles aient ainsi reconquis leur dignité apparaît une sinistre plaisanterie.
[5]Les autres, on l’a dit, ont implicitement vocation à quitter, de gré ou de force, le territoire national.



