La fatigue, une forme de cet épuisement dont Bataille fait état dans son oeuvre, les conditions du glissement incessant du sens et des sens, font qu'il est impossible, pour moi en tout cas, de fixer ce que je ne saisis que dans un mouvement continuel : je ne peux le comprendre, je ne peux que le suivre, à la trace, et par les traces que font les signes noirs sur la neige que Perceval contemple, et qui porte les trois gouttes de sang.
( La présence ici du Perceval de Chrétien de Troyes, pour incongrue qu'elle paraisse, n'en est pas pour autant déplacée, même si c'est précisément ceci - le déplacement- que cette présence signale, et ce à propos d'auréoles. )
Le mieux est sans doute, afin que le lecteur s'égare avec moi sur la lande où nous entraîne Agamben, de laisser dire ce dernier :
Auréoles
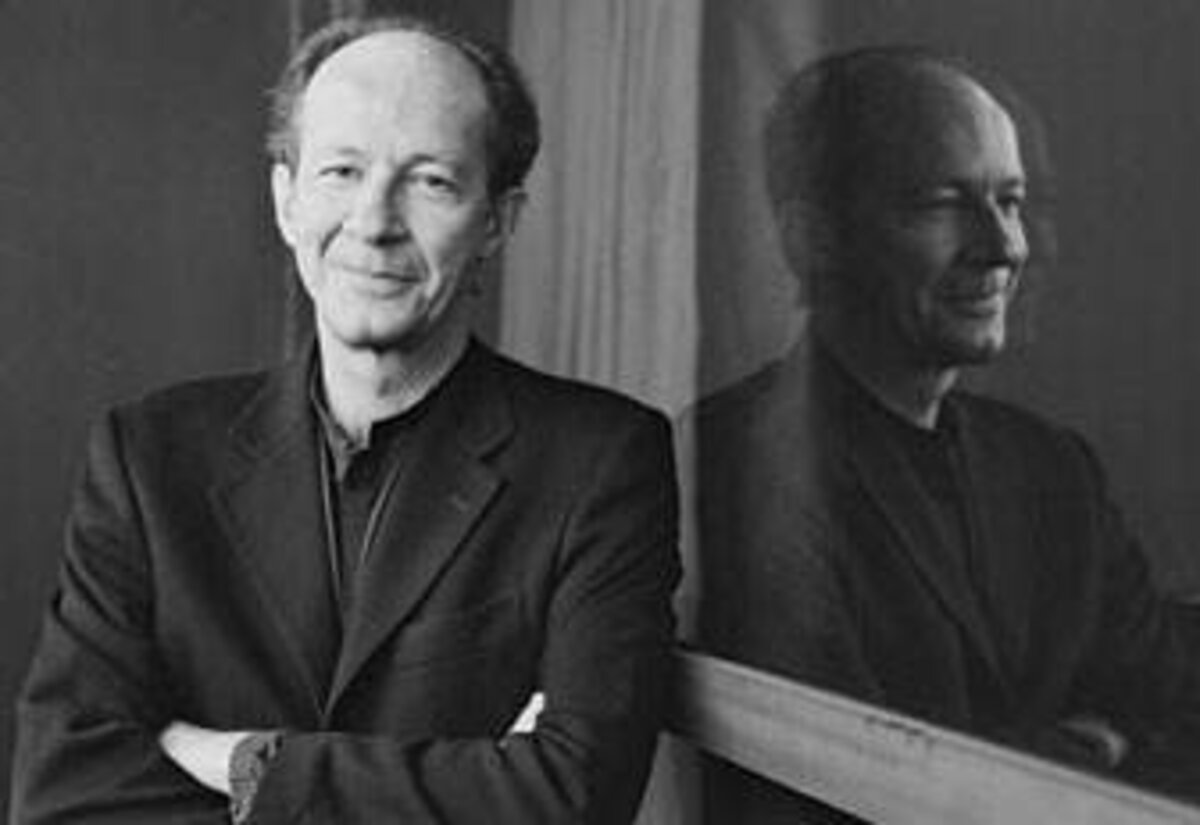
" La parabole sur le régne messianique que Benjamin (qui l'avait entendue de Scholem ) raconta un soir à Bloch et que celui-ci transcrivit dans Spuren est bien connue : "Un rabbin, un vrai cabaliste, dit un jour : Afin d'instaurer le règne de la paix, il n'est nullement besoin de tout détruire et de donner naissance à un monde totalement nouveau ; il suffit de déplacer à peine cette tasse ou cette arbrisseau ou cette pierre, en faisant de même pour toute chose. Mais cet à peine est si difficile à réaliser et il est si difficile de trouver sa mesure qu'en ce qui concerne ce monde les hommes en sont incapables, c'est pourquoi l'avénement du Messie est nécessaire." Dans la version de Benjamin, cette parabole devient : " Les hassidim racontent une histoire sur le monde à venir, qui dit : Là-bas tout sera précisément comme ici. (...) Tout demeurera comme à présent, à peine modifié."
Agamben rapproche cela de l'axiome des logiciens indiens : "Il n' y a pas la moindre différence entre le nirvana et le monde." Et ajoute : "Nouveau, en revanche, est cet infime déplacement, que l'histoire insinue dans le monde messianique. Toutefois, précisément, cet infime déplacement, ce "tout demeurera comme à présent, à peine modifié", est difficile à expliquer."
C'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai conscience de cette autre incongruité qui est de vous évoquer tout cela ici. Ma seule excuse sera que je ne pense à la plage, ici, qu'enfermé dans une chambre, et dans la tranquillité relative d'une ville "abandonnée" par le déplacement de nombre de gens qui ont effectué la migration saisonnière. Ceux qui peuvent, sauve qui peut. On peut dire que cela est dédié à, précisément, ceux qui restent, et effectuent ce mouvement en pensée, dans la tranquillité de l'été, dans une chambre close, à côté, par exemple, de la chambre où les enfants font la sieste, et continuent à lire, obstinément, cette densité fluide d'un texte qui court et fait signe :
"Cette nuance ne peut certes concerner simplement des circonstances réelles, au sens où le nez du bienheureux deviendrait à peine plus court, (...) Cet infime déplacement ne concerne pas l'état des choses, mais à leur périphérie, dans le jeu* entre chaque chose et elle-même. Cela signifie que, si la perfection n'implique pas un changement réel, elle ne saurait être davantage un état de chose éternel, un "c'est ainsi" irrémédiable. La parabole introduit, au contraire, une possibilité là où tout est parfait, un "autrement" là où tout est à jamais fini, et telle est précisément son aporie irréductible. Mais comment penser un "autrement" là où tout est définitivement accompli ?"
Mais l'auréole, pour laquelle Agamben convoque saint Thomas ?
"L'auréole, autrement dit, est l'individuation d'une béatitude, le devenir singulier de ce qui est parfait. Comme chez Duns Scot, cette individuation implique moins l'adjonction d'une nouvelle essence, ou un changement de nature, que l'état ultime de sa singularité ; toutefois, contrairement à ce qui advient chez Duns Scot, la singularité n'est pas ici une détermination extrême de l'être, mais la manière dont ses limites s'effrangent ou s'indéterminent : une individuation paradoxale par indétermination.
En ce sens, l'auréole peut être pensée comme une zone où possibilité et réalité, puissance et acte ne peuvent plus être différenciés. L'être qui est parvenu à sa fin (son individuation*) qui a consommé toutes ses possibilités, reçoit ainsi comme un don une possibilité supplémentaire. Celle-ci est cette potentia permixta actui (ou cet actus permixtus potentiae) que le génie d'un philosophe du XIVème siécle appelle actus confusionis, acte fusionnel, dans la mesure où la forme ou nature spécifique ne se conserve pas en lui, mais se confond et se dissout sans résidu en une nouvelle naissance. Cet imperceptible frémissement du fini, qui en rend les limites indéterminées et lui permet de se confondre, de devenir quelconque, est cet infime déplacement que chaque chose devra accomplir dans le monde messianique. Sa béatitude est celle d'une puissance qui n'advient qu'après l'acte, d'une matière qui ne se trouve pas sous la forme, mais la cerne et la nimbe."
Singularité quelconque, sans qualité particulière : quelque chose de commun, un "commun", comme un pré communal, où Musil, Agamben, Walser, Sholem, Weil et tant d'autres s'embrassent : se comprennent.
Il faut ne pas faire, pour évoquer ici Bartleby que convoque également Agamben, comme moi : n'attendez pas vingt ans pour lire Agamben : La communauté qui vient est déjà là, et advienne que pourra.
"Advienne que pourra" : c'est sans doute aussi ce que se dit Perceval, dans son extrême et quasi barbare jeunesse, quand il enfourche son destrier, se saisit d'une épée dans sa dextre, réunit les rênes dans sa sinistre, et va.
Va jusqu'au jour où il tombe en arrêt devant trois gouttes de sang sur la neige, et écoute enfin ses pensées. Mais ceci est une autre histoire, que l'on dit être la mère de tous les romans, et c'est aussi l'histoire de la rencontre avec un livre : La communauté qui vient, Giorgio Agamben.
Un léger déplacement...
Giorgio Agamben, La Communauté qui vient, Seuil, Librairie du XXIe siècle, 118 p.
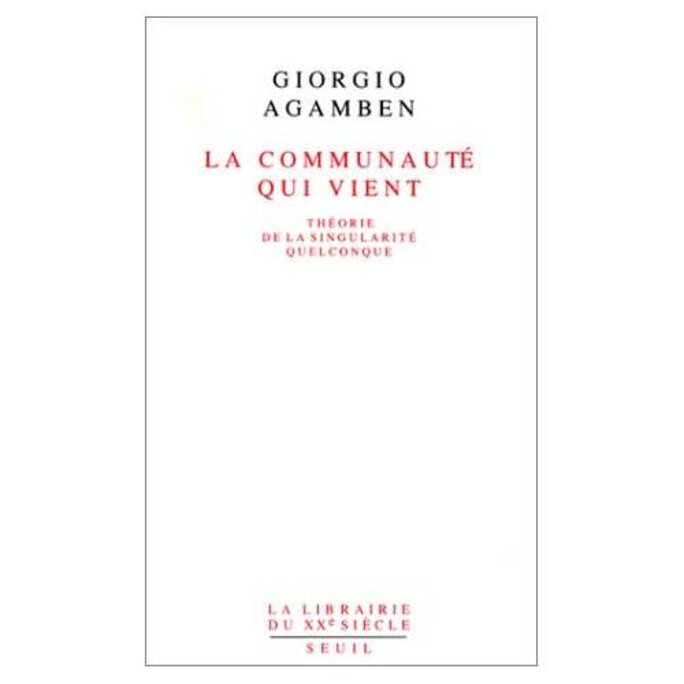
*jeu : je le souligne ainsi, dans le texte, afin que nul ne se méprenne : il s'agit bien du jeu nécessaire pour que les deux pièces d'une mécanique, par exemple puissent fonctionner.
*individuation : j'ai pensé à ce processus que décrit Carl Gustav Jung, et qui lui paraît nécessaire et salutaire. J'y vois un rapport avec tout ce qui est dit par Agamben, et ce que j'ai ajouté avec Chrétien de Troyes. Et où l'on voit que le je est sans doute bel et bien un jeu, aussi. Mais, bien sûr, on peut y voir autre chose.



