L'historien Gilles Candar est président de la Société d'études jaurésiennes. Il occupe actuellement un poste de professeur d'histoire en khâgne (classes préparatoires littéraires) au lycée Montesquieu du Mans (Sarthe).
Il eut jadis une activité militante, à la Ligue des droits de l'homme (président de la section d'Antony), au PCF, puis au PS notamment. Il a été conseiller municipal socialiste d'Antony de 1989 à 1995.
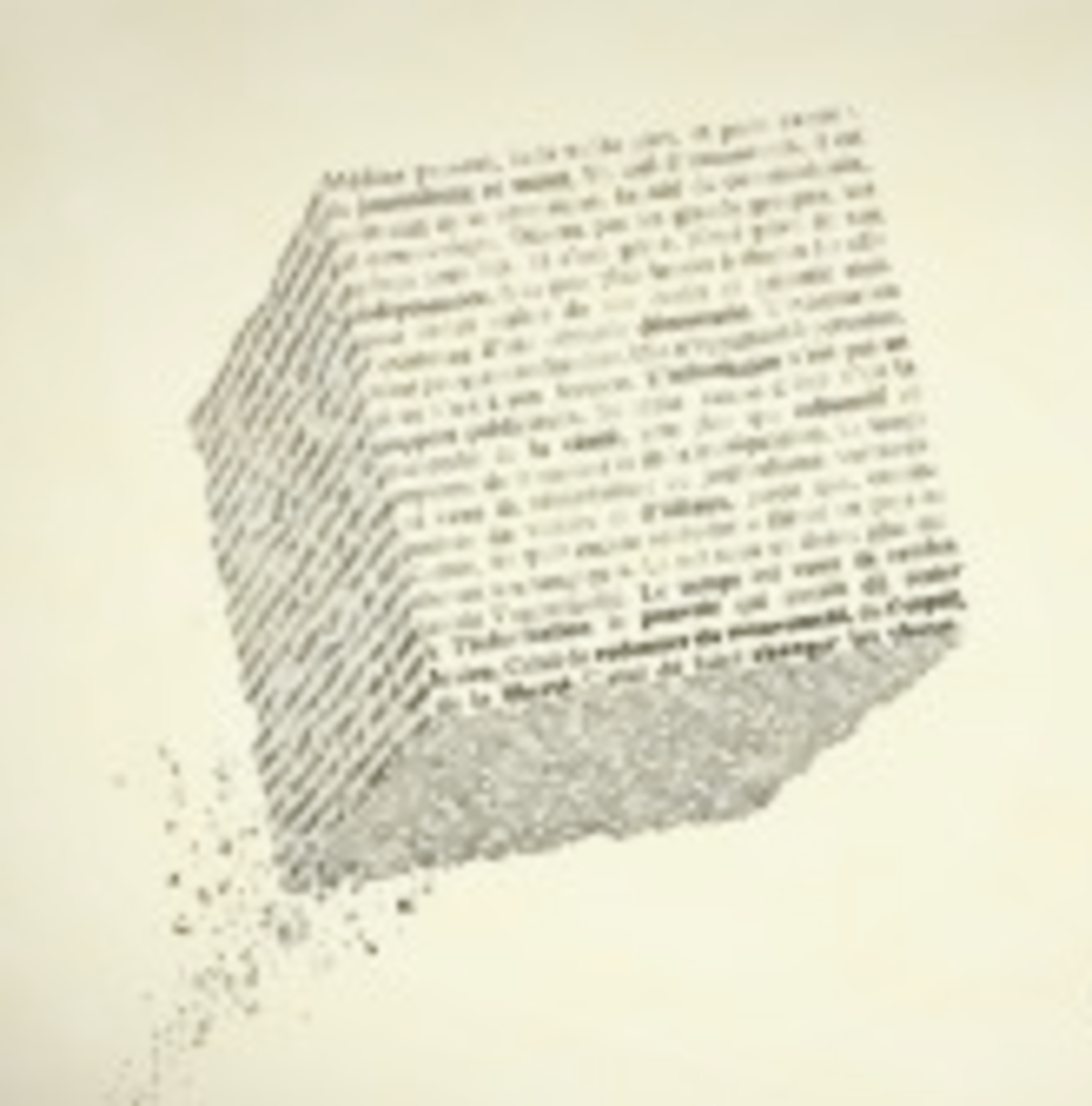
La gauche française en général, et le Parti socialiste en particulier, ne vont pas bien. En même temps, il me semble que les effets de manche sur «les grands cadavres à la renverse» ou «les arbres secs» restent des paroles verbeuses de vieux Messieurs… D’abord, ces difficultés ressortent d’une crise plus large, celle de la gauche européenne (dans les deux Amériques, et dans les pays démocratiques d’Asie ou d’Afrique, la gauche ne vas si mal…), ensuite, ce n’est ni la première, ni la dernière, ni la plus grave des crises. Pas de discrédit moral comme en 1993, pas d’effondrement comme en 1958 ou 1968, etc. Le rapport des forces global reste assez constant, comme le prouvent en France les élections partielles dont se désintéresse désormais la presse nationale (pourquoi?).
Après les européennes, la gauche a remporté la municipalité de Goussainville (Val-d’Oise) et le canton de Belin-Beliet (Gironde): d’accord, de telles informations ne permettent assurément pas de briller en ville… ou sur un blog, mais ce sont des faits, «stupides comme des faits», qui relativisent ce que certaines déclarations récentes ont de trop enflé.
Cela dit, comment faire, je me place dans cette perspective, pour que la gauche se porte mieux ? À mon sens, Vincent Duclert pose de vraies questions, même si son argumentation est parfois un peu bousculée. Je ne médis pas des réponses militantes et organisationnelles classiques, qui ne sont sans doute pas les siennes. Le socialisme jaurésien, le dreyfusisme lui-même, Vincent le sait mieux que quiconque, se bâtissent autour de deux nécessités fondamentales: organiser et propagander.
Donc organiser, et je crois avec deux orientations: organiser au XXIe siècle est forcément un peu différent de ce qui se faisait au siècle précédent. Les partis doivent évoluer, s’ouvrir davantage sur la société, se lier à elle, multiplier les réseaux, d’autres modes d’intervention… ce qui ne devrait pas trop dépayser des historien(ne)s du XIXe siècle, mais passons… À quoi serviraient alors les militants cotisants ? Comme aujourd’hui, ils formeraient le vivier de ceux qui s’apprêtent à prendre des responsabilités électives. Il est bon que leur nombre augmente (avec le mandat unique, ce ne serait pas trop difficile…), mais comme leur disait déjà Jaurès, ils ne doivent pas s’isoler en une caste ou aristocratie de comité (sinon… ils finissent par perdre les élections, ce qu’ils ne souhaitent pas!).
Il faut aussi organiser la gauche. Une part des difficultés actuelles tient à ce que les compétitions légitimes et nécessaires se passent un peu trop au petit hasard… Le paysage politique n’est pas si bouleversé que cela. Le PS n’est plus hégémonique, mais il ne l’a pas été longtemps, si du moins il l’a été. Les Verts sont à nouveau en phase ascendante (mais ils en ont connu d’autres) et disons «l’extrême-gauche de gouvernement» un peu requinquée, après des années bien noires toutefois… aux dépens de ceux qui à l’extrême-gauche ne souhaitent pas gouverner. En tout cas, on sent bien que devrait se mettre en place, dans l’intérêt commun, mais aussi en fait dans celui de chacun, une régularisation, sinon une harmonisation, de ces compétitions.
Gauche Avenir, présent sur le site Médiapart, où se retrouvent des militant(e)s des divers partis et des citoyen(ne)s sans appartenance partisane, a proposé des structures et des procédures pour permettre ce rassemblement des forces de gauche et écologiques dont pourraient utilement discuter citoyen(ne)s et organisations.
Le mot propagande a mal vieilli. Il s’agit de diffuser des idées, des thèmes, des valeurs, des projets, des éléments d’une civilisation socialiste diraient Charles Andler et Christophe Prochasson (1). Autrefois, on aurait dit «gagner la bataille idéologique» et d’ailleurs c’est ce que revendiquent encore avoir réussi François Fillon et d’autres. La gauche est en difficulté sur ce terrain, parce qu’elle n’est plus sûre de ce qu’elle veut, qu’elle hésite sur son orientation générale, sur le contenu de son argumentaire.
C’est là où l’interpellation de Vincent me semble la plus pertinente. Bien sûr, la gauche sait gérer, administrer, mais avec l’exercice du pouvoir pendant trois législatures depuis 1981, elle s’est trop laissée aller à réduire son rôle à la culture de gouvernement et d’administration. Or, la gauche, ce n’est pas que cela. La gauche ne doit pas seulement «comprendre le réel», mais aussi «aller à l’idéal». Elle doit avoir des idées, même contradictoires, animer des débats, faire vivre la démocratie, bouleverser les habitudes et inventer des «utopies concrètes». Elle doit avoir de la culture.
La crise de la gauche vient de ce divorce non seulement entre intellectuels et partis, mais entre ces derniers et toute la société. Ce n’est pas seulement l’histoire de la gauche qui doit être mise en débat, mais tous les sujets alors que les professionnels de la politique donnent trop souvent l’impression de ne pas vouloir discuter, mais chercher habilement le meilleur positionnement. Dirigeants et militants sont souvent surmenés et hyperactifs, mais on a envie de mettre en cause leurs méthodes de travail : trop de temps passé «en interne», une vie organisationnelle trop complexe, des responsabilités pas assez partagées… Une rénovation de la vie militante doit se faire avec des mesures concrètes et simplificatrices qui donneraient plus de temps à la politique elle-même.
Et il me semble que les priorités alors apparaîtraient mieux : pas des futilités sur les personnalités, qui amusent un temps, mais ne débouchent pas sur grand chose, mais le sens de l’indignation, de l’inacceptable, des grands refus fondateurs. Bref, vouloir changer l’ordre du monde comme le disait Blum en donnant plus de liberté, plus d’égalité, plus de fraternité. Et commencer à être précis pour aller vers un contrat, un accord de gouvernement à gauche : quelle politique de la justice? de l’éducation? etc.
La gauche, et notamment le PS, semblent inutilement trop timides (la déconvenue des européennes, confrontée au succès, à la fois d’imagination et de sérieux, des écologistes devrait servir d’exemple). C’est bien de vouloir remettre ses banderoles dans les manifestations, mais il faudrait être plus actif, plus visible dans des campagnes comme celles pour un salaire maximum, pour la défense de l’impôt, contre les traques d’immigrés sans papiers, etc. Que des responsables identifiables s’en saisissent et deviennent, localement ou nationalement, incontournables sur le sujet.
Ne pas craindre d’être impopulaire sur certains thèmes (car les citoyens acceptent plus facilement qu’on le croit l’affirmation de convictions, même sans être convaincus, cf. Mitterrand sur la peine de mort ou davantage encore Mendès France, Blum ou Jaurès (lequel disait «qu’il fallait savoir dépenser sa popularité»…) et ne pas chercher trop tôt le compromis raisonnable, qui interviendra sans doute, et certainement, mais qui a besoin d’être précédé de la construction d’un rapport de forces plus favorable. Sinon, la «nature des choses» pousse toujours un peu plus à droite…
Pour sortir du malaise actuel à gauche, me semble-t-il, il faut donc donner à nos représentants, mais aussi à nous-mêmes, plus de méthode et de culture, ou, si l’on veut, revenir aux fondamentaux, s’organiser et travailler (mieux).
Gilles Candar
(1) Prochasson publie à la rentrée une édition de La Civilisation du socialisme, du au premier, aux éditions du Bord de l’eau, dans la collection animée par le député européen Vincent Peillon.



