Le 28 Janvier dernier j’ai pu assister à la représentation se tenant à l’Espace 1789 de Saint-Ouen. J’ai pris connaissance de l’événement grâce aux multiples affiches se trouvant dans la ville audonienne. L’impatience me rongeait dés l'instant de la récupération de mon billet.
Ce vendredi soir, il est 19h30 lors de mon arrivée, tout est encore calme une demi-heure avant le début de la représentation. Une dizaine de personnes se trouvent à la buvette sur le côté droit de la salle. Il y a tout d’abord un couple de nancéiens, Marie-Christine et Jean-Marc, accompagnés par une amie parisienne, Élisabeth. Quelles sont leurs motivations pour venir ici ce soir ? Est-ce le football de manière générale, le football féminin plus précisément, ou tout simplement la danse contemporaine ? Elisabeth « adore la danse » et voulait simplement « faire plaisir à des amis » mais elle précise que Jean-Marc « bien sûr, adore le football ». Marie-Christine ajoute qu’ils sont des « supporters de l’AS Nancy Lorraine ». A la table à côté, un autre couple patiente tandis que la file d’attente au guichet commence à bien s’allonger. Ils sont ici car Mégane a adoré les précédents spectacles de l’Espace 1789 mais aussi parce qu’elle aime « les spectacles qui font jouer des personnes de la vraie vie ».
« C’est l’expression artistique qui m’intéresse, d’autant plus avec ce thème, la place de la femme dans le sport »
Du côté de la file d’attente, grâce à leurs vestes, on remarque une section de joueuses du Red Star, l’équipe de la ville de Saint-Ouen en troisième division. Elles sont venues avec leur coach et semblent impatientes de découvrir Footballeuses. Eric Coquerel, député France Insoumise de la Seine Saint-Denis a aussi fait le déplacement en compagnie de sa suppléante Manon Monrimel. C’est le premier spectacle qu’il vient voir « depuis qu’il est élu, tout en étant intéressé par le thème ». Madame Monrimel, a été motivée par sa belle-sœur qui travaille dans le milieu du théâtre : « c’est l’expression artistique qui m’intéresse, d’autant plus avec ce thème, la place de la femme dans le sport ».
Il est 19h50, la salle se remplit ; Il y a plus de deux cents personnes. Beaucoup de personnes sont impressionnées par la taille du plateau, très grand et, partagent entre elles l’histoire du lieu. Selon un spectateur, l’Espace 1789 a été instauré par les communistes pour concurrencer « monsieur le curé, le dimanche avec de la culture ». D’autres, s’amusent à trouver de véritables équipes de football avec un maillot jaune comme celui de l’équipe fictive de Footballeuses. On cite tout naturellement le FC Nantes, une équipe supportée par le père du chorégraphe et dont c’est accessoirement la couleur préférée.

Agrandissement : Illustration 1

À 20h00, le spectacle débute. Les footballeuses arrivent par le haut de la salle telle une équipe de football arrivant à l’entrainement. Sur le plateau, l’échauffement s’enclenche. C’est à partir de là que commence la symbiose entre les gestes du football et les gestes de la danse. Les footballeuses ont conservé leurs vêtements « de ville », ce qui rend circonspecte une partie du public. C’est toute l’ingéniosité du spectacle : le football peut s’apparenter à une danse lorsqu’il est s’exercé sur un plateau.
La suite, c’est le déroulement d’un match fictif entrecoupé de scènes avec des dialogues telle que la mise en place tactique avant le match par exemple. Mais les nombreuses scènes ont surtout vocation de rappeler l’esprit même du projet : l’incarnation de la réalité directement dans l’interprétation. Au beau milieu de la représentation, le temps s’arrête : chacune des dix footballeuses se présente. Certaines parlent de leur métier, d’autres de leur famille et, la majorité, de leur rapport au football et de la route qu’elles ont emprunté pour y jouer. La réalité sociale est aussi présente sous forme d’enregistrements d’émissions de radio évoquant notamment la quatrième place en coupe du monde de l’équipe française de football en 2011. Le présentateur rappelle alors ceci : une double page dans L’Equipe, mais toujours pas la Une pour cette belle performance. La performance, cette fois-ci sur scène, est forte, poignante et percutante. La salle se lève pour applaudir. A la buvette les actrices se mélangent aux spectateurs et échangent avec les amis et anonymes venus les voir.
« 100 ans après le premier match de football féminin en France »
C’est un projet particulier, mis en place par le chorégraphe Mickaël Phelippeau. Un projet qu’il explique lors d’une rencontre chez lui, la veille de la représentation. Une rencontre afin d’évoquer la naissance, la vie et l’esprit de Footballeuses. Suite à sa formation au Centre chorégraphique national de Montpellier, il débute ses créations chorégraphiques en 1999 ; puis, il devient artiste associé au Quartz au théâtre de Brétigny de 2012 à 2016 où lui vient l’idée de ce projet qu’il démarre en 2017.
L’année 2017 est tout d’abord symbolique comme l’explique Mickaël : « 100 ans après le premier match de football féminin en France ». En effet, le 30 Septembre 1917, deux équipes du Fémina Sport (club omnisports féminin de Paris, fondé cinq ans plus tôt) s’opposent pour ce qui est le premier match de football féminin en France. La première Guerre Mondiale a été le moteur de l’envol du football féminin notamment en Grande-Bretagne. En plus de remplacer leurs maris et pères dans les usines, les femmes les ont aussi remplacés sur les terrains. Suite à l’essor de ces clubs féminins dans les usines et les universités, la popularité a bientôt suivit. Preuve en est, en 1920, le match France - Angleterre au stade de Pershing dans le bois de Vincennes a attiré 12 000 spectateurs. Le mouvement en Angleterre fut baptisé « Munitionnettes » du fait de la présence importante dans ces équipes d’ouvrières travaillant dans les usines de munition.

Agrandissement : Illustration 2

Revenons en 2017 et à Footballeuses. Tout d’abord, pourquoi un tel titre ? Mickaël met en avant la notion de « portrait » dans son travail : ce qui relie ces femmes c’est le football, c’est pour cela que le projet se nomme sobrement ainsi. Il précise également que cela fait « dix ans qu’il travaille avec des gens qui portent le poids de leur propre parole sur la scène » et c’est pourquoi ce sont des « footballeuses qui dansent et non des danseuses interprétant des footballeuses ». Ce contexte renforce la sincérité des gestes mais aussi des témoignages sur scène.
« Nous qui ne connaissons rien à la danse et lui qui ne connaît rien au football »
La question du genre se pose rapidement. On peut établir un parallèle entre le chorégraphe et les footballeuses, lui qui en tant qu’homme fréquente le milieu de la danse. Mickaël se rappelle des remarques familiales portant sur ce milieu supposément féminin. Un milieu ou les hommes « seraient forcément homosexuels ». Il dit « interroger l’équivalent pour des femmes que l’on va rapidement traiter de lesbiennes car « jouant au football ».
Lou, une des interprètes ajoute que cette situation a créé une symbiose entre « nous qui ne connaissons rien à la danse et lui qui ne connaît rien au football ». Un objet dont il s’est emparé avec un « regard un peu naïf » selon elle. Cette double méconnaissance fait que le spectacle s’est construit à partir « d’échanges avec les interprètes qui se sont rapidement emparées des outils que je leur apportais » conclut le chorégraphe. Bien sûr, il y a eu quelques difficultés au début du projet, quant à leur engagement, la compréhension du projet, mais se sont des éléments que le chorégraphe a incorporé dans son travail. Comme il le dit lui-même, « si je ne souhaitais pas vivre ces difficultés, je ferais appel à des professionnels ».
Une fois les bases posées, il a fallu aborder la question de l’interprétation du football en tant que telle. Quel cadre adopter pour performer ? Un terrain ou un plateau ? C’est la seconde option qui a été retenue. Cependant certaines répétitions ont eu lieu sur un terrain mais seulement pour « réinvestir ces sensations sur scène ». L’apparence est aussi importante : une véritable équipe fictive est créer, avec des maillots et des numéros ayant une signification particulière pour chaque footballeuse. Mickaël évoque aussi avec amusement la question des crampons, qui a été rapidement évacuée car « les théâtres n’accepteraient jamais que leur plateau se fassent défoncer par des crampons ».
« La claque que provoquent les applaudissements à la fin d’une représentation »
Si le choix d’amateurs correspond à l’essence du projet, celui-ci est néanmoins mené et développé dans un cadre professionnel. Un principe s’impose d’ailleurs dès le début : pour leurs rôles, les footballeuses sont rémunérées en tant qu’interprètes. Le chorégraphe y tient particulièrement, il rappelle « que ce n’est pas le métier premier de chacune, l’année prochaine une représentation à Marseille nécessitera des jours de congés pour l’assurer ». Selon lui cette rémunération a été un « élément de bascule pour certaines ». Lou abonde en ce sens : « cela permettait de rendre compte du sérieux du projet ». Une motivation supplémentaire, mais néanmoins secondaire par rapport à l’aspect émotif. Elle évoque « la claque que provoquent les applaudissements à la fin d’une représentation ».

Agrandissement : Illustration 3
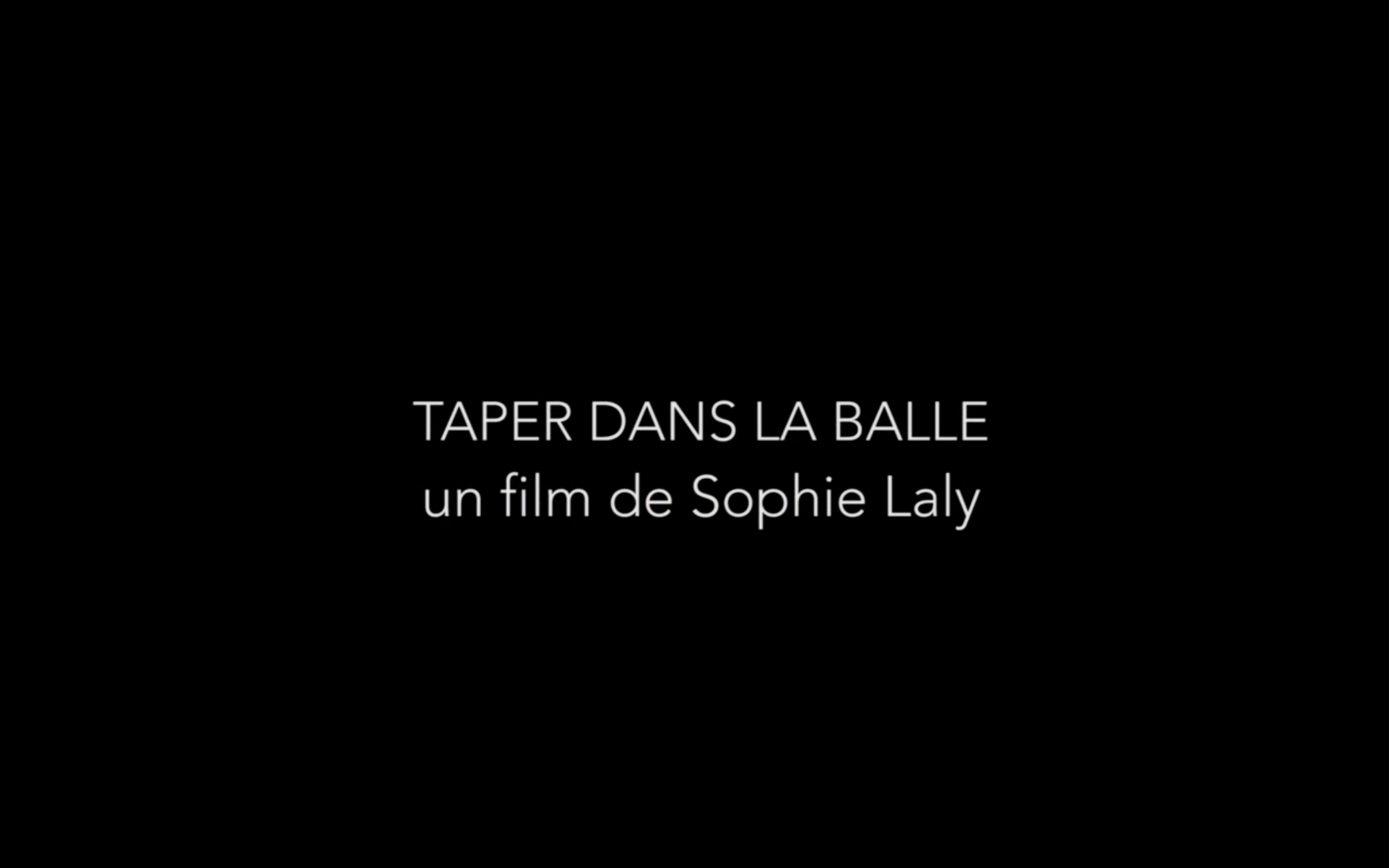
Ce projet a été mis en images par Sophie Laly, réalisatrice et artiste vidéaste. Formée aux Beaux-Arts, elle se lance dans la réalisation lorsqu’on lui demande de filmer des spectacles. Sa caméra a suivi les interprètes de Footballeuses à leurs entraînements et matchs entre Janvier et Mai 2017. Un film qui s’intitule sobrement Taper dans la balle.
Ce film est une succession de témoignages des différentes femmes qui ont pris part ou prennent encore part aux représentations. Les profils sont différents. La majorité d’entre elles sont des membres de l’équipe féminine de l'Amical Football Club de Bondoufle (Essonne) et aussi la présidente du club, Carole. La voix off est composée du témoignage de chacune, calée sur son image et ses gestes. La réalisatrice a été sollicitée par la compagnie de Mickaël Phelippeau qui souhaitait un rendu visuel de ses méthodes. Pourtant, Sophie Laly a hésité car elle refusait d’ « épier cette équipe durant la création (du spectacle) » d’autant qu’elles « découvraient ce monde de la scène » Elle va alors filmer et suivre cette équipe durant les matchs de la phase retour du championnat en 2017 et lors des entraînements le lundi soir. A cela vont s’ajouter des entretiens individuels qui vont durer « parfois des heures ». La porte d’entrée de la réalisatrice est « le rapport au football » pour ensuite passer d’ « un témoignage individuel au football féminin dans sa globalité ». Elle cherchait à avoir un sentiment intime et donc de « les interroger une par une ».
« Tu as vu ? C’est marrant, il y a une fille »
Les portraits s’enchaînent. Il y a tout d’abord Brigitte, aujourd’hui 58 ans qui raconte qu’elle baigna toute son enfance dans le football car son père fut footballeur professionnel. Elle a donc créé sa propre équipe de football avec des amies, l’expérience dura quatre ans. Bien des années plus tard, elle reprend le football presque par hasard en tombant sur une annonce dans le journal local de Brétigny, ville voisine de Bondoufle.
Puis vient le témoignage de Juliette qui commence tambour battant : elle est « fière d’être footballeuse, de répondre aux gens que oui, moi je joue au football ». Elle se remémore ensuite son enfance et les parents de ses camarades dans son club qui s’exclamaient alors : « tu as vu ? c’est marrant, il y a une fille ». Elle se rendait déjà compte qu’il « fallait toujours prouver plus en tant que fille alors que je jouais en équipe première ». Une situation qui l’a poussée à se couper les cheveux en signe de rébellion. Un choix qu’elle regrette très vite en se disant : « mais pourquoi je n’aurais pas le droit ? Ces cheveux ce n’est pas moi ». Elle s’en amuse aujourd’hui en précisant qu’elle n’a plus coupé ses cheveux depuis. A 24 ans elle arrête le football, devient mère, avant de reprendre le football à presque 40 ans.

Agrandissement : Illustration 4

Pour Sophie, ces témoignages ne sont pas étonnants puisque pour elle, « 90% des gens sont dans le jugement » et avoue que ce film « changea le regard de plusieurs personnes sur le football féminin ». Pour Lou « ces témoignages montrent que nous vivons plus ou moins toutes les mêmes choses mais à des lieux et des âges différents ». On comprend par ce film que le football féminin possède encore son lot de clichés. Une séparation avec son homologue masculin qui débute dès l’enfance. Sophie rapporte par exemple que Bettina, une des interprètes évoque une séparation entres genres dès la cour de récréation en primaire. En effet « les filles et les garçons en plus d’être séparés dans les jeux sont séparés tout court dans les différents espaces d’une cour » selon Sophie.
« Il est hors de question que j’arrête »
La question du genre est très présente, comme en témoigne encore Bettina: « je me sentais comme un garçon car j’étais tout le temps avec eux, mais en même temps on me rappelait ma condition car j’étais justement la seule. Mon surnom fut « la fille » durant toute ma primaire ». Ou encore sa mère qui n’était peut-être « pas très heureuse de voir que sa fille était un peu un garçon manqué ». Au final au delà des différentes expériences et des multiples témoignages, ce qui ressort distinctement du film de Sophie c’est que ces femmes sont des footballeuses, que cela n’est en rien quelque chose d’exceptionnel. Surtout, ni l’âge ni le contexte ne les feront jamais arrêter de jouer. Comme le rappelle très clairement une autre joueuse, Fanny : « il est hors de question que j’arrête ».
Il ne faut pas oublier que ce spectacle suggère une dimension politique car « associer football et femmes pose inéluctablement un débat » selon Mickaël. Lou confie d’ailleurs : « ce spectacle à permis d’impressionner certaines de mes amies qui se moquaient de ma passion pour le football, en voyant ce qu’il pouvait m’apporter comme opportunités ». Elle rappelle néanmoins une chose importante selon elle : « le football féminin veut seulement être traité de la même manière que le football masculin, je ne voudrais pas qu’un événement majeur du football masculin soit moins bien traité qu’un événement mineur du football féminin et inversement ».
Ce 12 Mai, le projet repassera donc au Théâtre de Brétigny, lieu de naissance de cette aventure. Une rencontre débat sera organisée avant la représentation autour de la question suivante : « Le foot, un sport de mec ? ». Cela rappelle bien les enjeux du football et son rôle de filtre de la société. Mais ce soir là, à Brétigny, ville de la plupart des interprètes, leur performance démontrera une fois encore, devant leurs familles et amis, que la scène devient le lieu à la fois réel et abstrait où la parole et l’identité peuvent s’affirmer.
Remerciements : Je tiens à remercier Sophie, Lou et Mickaël de m'avoir permis de les rencontrer et de les interroger.



