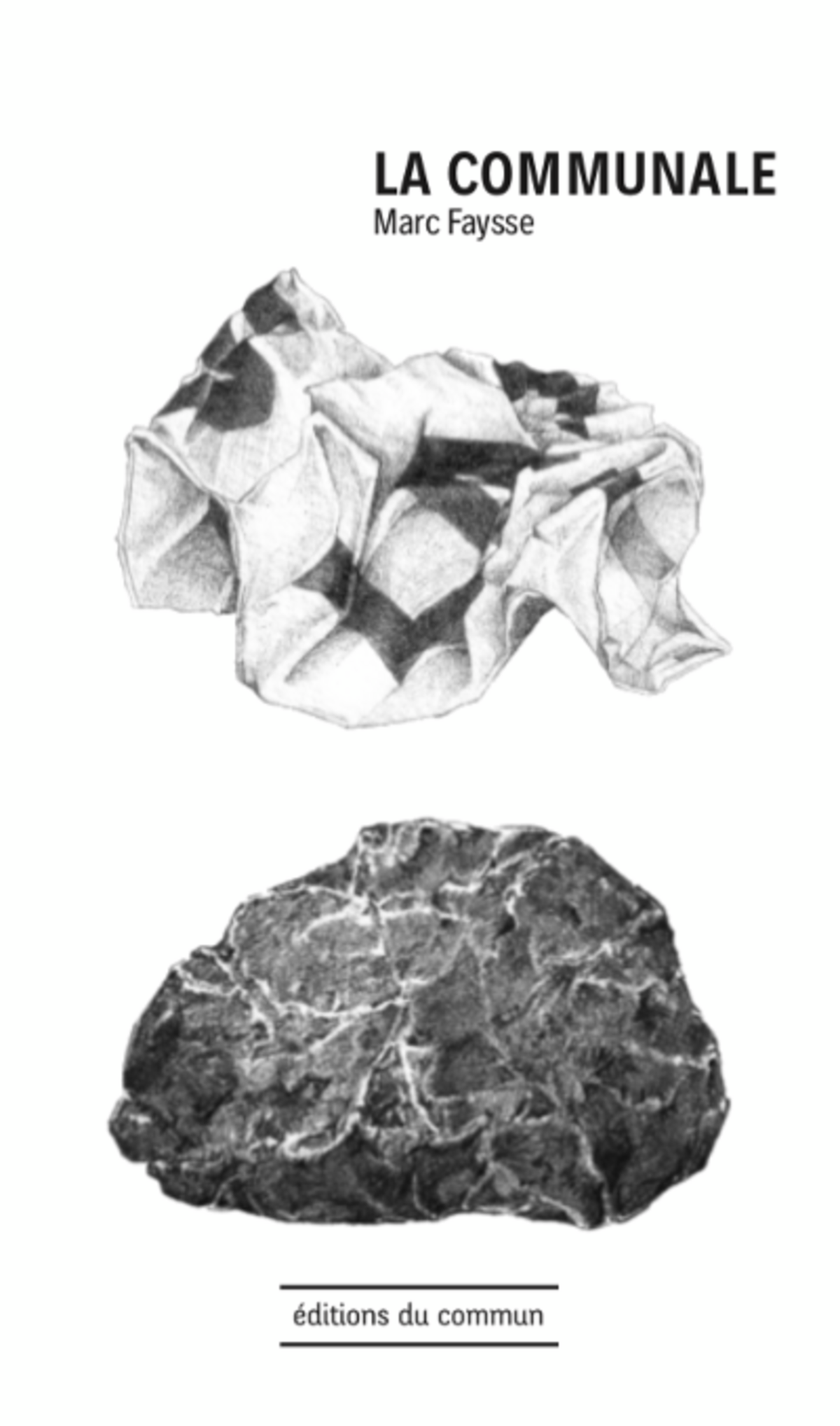
Agrandissement : Illustration 1
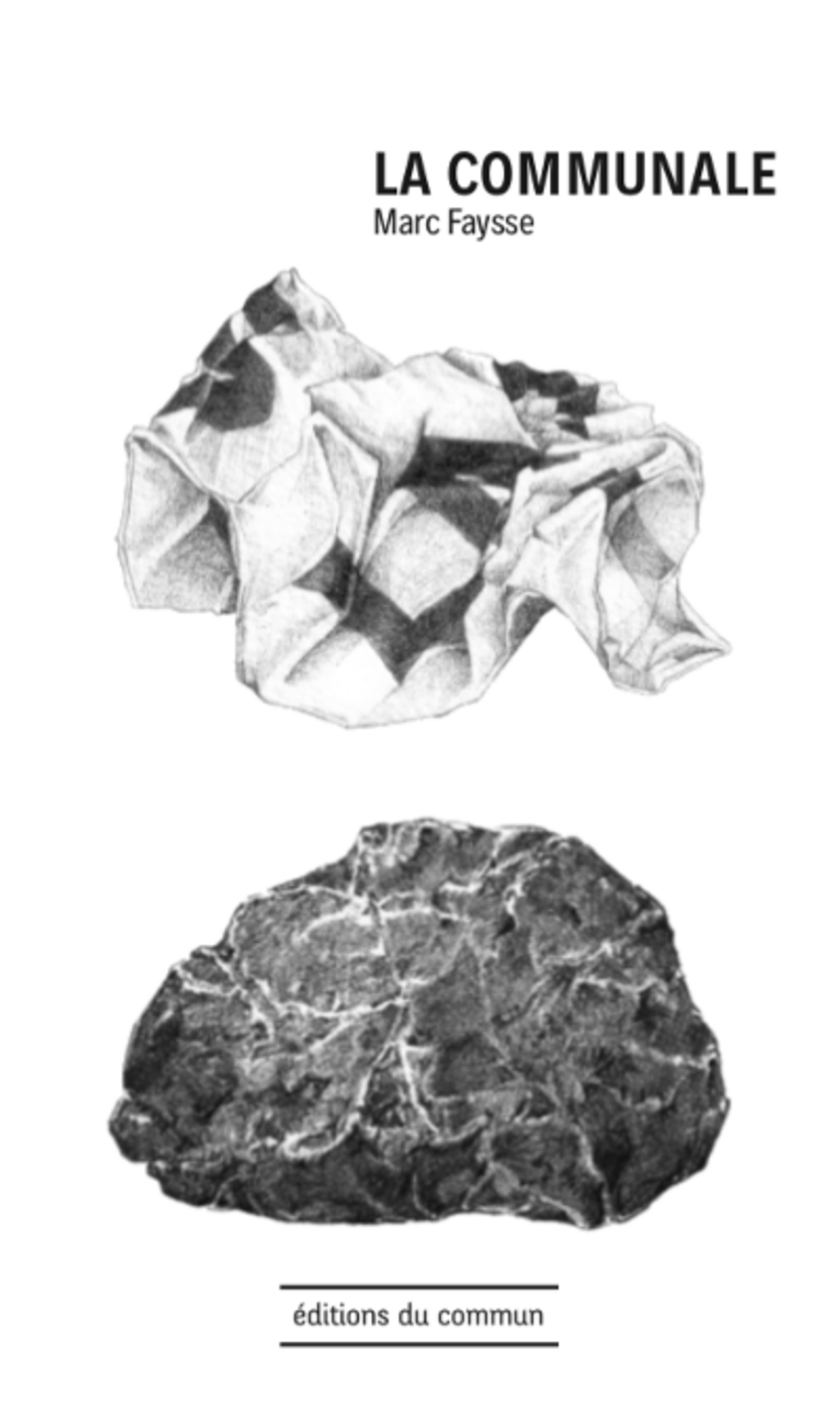
Voici l'introduction de La Communale de Marc Faysse, qui fait partie de notre collection Des réels et sorti en librairie le 26 avril dernier, en libre accès. Il est également en vente sur notre site, où vous pourrez trouver cet extrait en version pdf.
Je déteste l’autoroute. L’autoroute, c’est l’enfer pour les errants. Rien n’est possible, aucune liberté. Pour sortir, il faut payer, pour manger, pour boire, pour pisser il faut payer, et le prix fort. Tout est Vinci, tout est Total, même les gobelets en plastique, même le papier toilette. L’autoroute, c’est le paradis des puissants : tout est sous contrôle.
Fanny, elle, est hors de contrôle. Pendant que je tire sur ma dernière clope, elle fait un tour dans la boutique de la station-service. Le soleil crame tout autour de moi. Je suis allongé. La pelouse est jonchée de petits cylindres blancs, parfois bruns, qui forment un tapis dégueulasse, mou, imbibé d’une eau poisseuse et puante. Le soleil crame tout. L’herbe jaunie pue l’essence et le jus de poubelle, le gaz d’échappement et les restes de pique-nique, l’urine du chien qui a trop attendu la pause de ses maitres. Plus loin, une table et deux bancs, à l’ombre sous un arbre chétif. Coincés entre les planches, des mouchoirs usagés et des emballages de sandwiches. Fanny se fait attendre. Impossible de stopper une bagnole sans elle. Aucune chance. Le soleil m’a donné des airs de gangster, la sueur me fait luire alors qu’elle, la chaleur la rend belle, ses cheveux sont plus éclatants et sa peau est plus sombre. Au bout, sur la bretelle d’arrivée, une décapotable rouge. Une vieille voiture des années 90. De l’autre coté, voilà Fanny la blonde, Fanny aux yeux bleus, aux seins discrets et à l’allure de flibustier. Dans son sweat ample et troué, elle marche d’un pas sûr, et elle me cherche du regard. Lorsqu’elle m’aperçoit, sur ma pelouse toxique et stérile, elle esquisse un sourire du coin de la lèvre.
Tout le monde est plus lent que Fanny. Elle sort de ses poches des glaces à la vanille, du fromage industriel et des sodas sans sucre. Elle a tout piqué dans la boutique Total. Ça nous fait rire de faire perdre un peu d’argent à ces connards. Le seul truc qu’on ne peut pas piquer, ce sont les clopes, planquées derrière le comptoir du caissier en polo rouge. Pas d’alcool non plus. Il n’y a jamais d’alcool dans ce genre de boutiques. Ils doivent se dire que la tentation serait trop grande de se mettre une murge sur un Paris-Toulouse. Je veux bien, mais ils ne pensent pas aux autostoppeurs qui doivent tuer le temps, faire une pause en attendant la voiture suivante. Putain de précautions à la con.
On cuit dans le vent tiède en léchant des glaces industrielles. On est en route. Sur la route. Je suis excité. C’est la première fois que je vais dans ce genre de réunion, je me pose des questions, je suis comme un gosse qui part pour la première fois en colo. Fanny a déjà fait plusieurs colos, elle est déjà la grande gueule, elle fait déjà l’imbécile. Fanny est plus à l’aise, mais je sais que son cœur bat vite.
On repart à la pêche sur le parking. Repérer la voiture sans passager, sympathiser avec le chauffeur, lui expliquer qu’on fait du stop, qu’on est deux. Certains refusent quand Fanny explique qu’elle n’est pas seule. Elle dit que le stop est son thermomètre de la condition féminine. Parfois, quand elle est seule et qu’elle sent que le type veut la prendre tout court, mais qu’elle n’a pas d’autre choix parce qu’elle est en rase campagne, ou qu’il fait trop froid pour dormir dehors, elle se mord les lèvres et serre son couteau de poche. Flipper quand on te prend en voiture ce n’est pas qu’un truc de fille, c’est un truc contagieux, un truc qui te ronge. Il parait que c’est à cause de cette peur qu’on ne voit plus d’autostoppeurs. À cause de ça, et aussi à cause des autoroutes. La technique, quand on est bloqué trop longtemps dans une station-service, et qu’on est deux, comme nous, c’est de laisser la fille demander.
Parfois, il faut en arriver à ce genre d’extrémités.
Un homme d’une quarantaine d’années remplit son cross-over à la pompe à essence. Il a le profil du bon père de famille. Il nous demande quelques minutes pour réfléchir. C’est souvent comme ça. Les gens ont besoin de se retrouver seuls pour ne pas prendre de décision précipitée.
Je regarde le propriétaire du cross-over. Pendant que son café refroidit, il pèse le pour et le contre. Si un fait divers a une bonne place dans sa mémoire, il va pencher pour le refus, et son cerveau va chercher une bonne raison de ne pas nous laisser monter. S’il a déjà fait du stop, s’il est catho de gauche, s’il est de gauche, s’il est frustré par sa vie bourgeoise et qu’il veut se donner bonne conscience, se faire un frisson, on a des chances.
Sous le cagnard, les pensées gonflent. L’homme qui remplit son cross-over est à l’ombre, lui, mais sa chemise beige est tachée par la sueur. Il entre dans la boutique climatisée et je le vois s’enfiler une cannette bien fraiche. J’entends presque son soupir fraicheur, à travers la baie vitrée. On est hors du temps, abrutis par le ciel clair, et je pense que tous les connards du monde se sont donnés rendez-vous sur ce parking pour boire du Fanta citron et pour refuser des autostoppeurs. Je sais qu’il va refuser. C’est cuit, je te dis, Fanny, t’as vu sa tronche. Il a peur de tout, il aura peur de nous. Tu ne crois pas ? Tu ne me crois pas ? Attends de voir, Fanny, attends un peu. T’es à tomber, mais si le mec a peur de claquer, alors tes yeux, il s’en fout.
Fanny doute, elle mange ses biscuits à l’huile de palme en tirant la tronche. Elle regarde ailleurs, je l’ai vexée. « Mais regarde un peu, nos sacs sont dégueulasses, il n’a même pas besoin de prétexte.
– Ça me faisait envie, une voiture climatisée, Achille. Cette canicule, ça me rend folle. Mon sang est trop épais pour ce climat.
– Arrête un peu, crâneuse. T’es normande, pas norvégienne. Et puis on a des glaces.
– Plus qu’une, et déjà bien ramollie. Si le mec ne nous prend pas, c’est à ton tour d’aller en chourer. Je crois que la fille de la Brioche Dorée m’a repérée.
– Tu crois qu’une fille de la Brioche Dorée te balancerait au vigile de Total boutique ?
– Je crois qu’elle a peut-être quelque chose à y gagner »
Rien de pire que les petits soldats intoxiqués. Il y a quelques mois, à Paris, je suis entré dans un microsupermarché. Posées près des caisses, une dizaine de boites de crevettes hors du système de réfrigération. Ils allaient les foutre à la poubelle. Alice, la fille dont le prénom était écrit sur le petit badge Carrefour Contact, m’a dit qu’il était interdit de donner ce type d’articles. Sans raison. Pourquoi ? Eh bien parce que c’est comme ça. La rage m’a fait palpiter les veines sur les paupières. Mais interdit par qui ? Par le patron. Il n’est pas là, le patron. Non, monsieur, ne prenez pas ça, c’est du vol. Non, monsieur. Elle s’est interposée pour que je ne prenne pas les barquettes de crevettes. Je suis sorti, avec le butin. Quand je vous dis qu’en bas de l’échelle, on est un meilleur chien de garde, c’est de ça que je veux parler. De l’incompréhensible absence d’angle alpha.
Plus ton angle alpha est important, et plus tu fermes les yeux quand quelqu’un vole un sandwich dans la boutique. Je ne sais pas ce qu’il faut pour développer l’angle alpha, mais je sais que l’éducation politique ne suffit pas.
L’homme au Cross-over finit par sortir. Il regarde Fanny, dernière hésitation. Contre toute attente, il s’approche avec un sourire. Il accepte de nous prendre. Thierry. Il va jusqu’à Toulouse. C’est parfait, car nous y sommes attendus ce soir. Non, Thierry, ce n’est pas une réunion comme tu les connais, avec powerpoint et blagues sexistes. Bouteilles d’eau et croissants. Mais on parlera stratégie, nous aussi. Thierry travaille pour une entreprise qui fabrique des outils de jardinage. Il fait le tour du pays pour placer ses produits dans des grandes surfaces spécialisées. Tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs de fabrication française. Leur trouver la meilleure tête de gondole, pour en vendre un maximum. Thierry a mis son régulateur de vitesse à 134 kilomètres-heure, c’est une combine de commerciaux, de gens qui font plus de cinquante mille kilomètres par an. Thierry a déjà pris des autostoppeurs, il a même pratiqué quand il était plus jeune. « Quand t’étais libre ? » marmonne Fanny. Ça le fait rire, il croit probablement que c’est une blague. Thierry est sympathique, ouvert sur le monde, qu’il regarde avec un pragmatisme de père de famille. D’ailleurs, il est marié et a une petite fille. Quand sa femme et lui ont découvert les troubles d’Alexia, à 2 ans, et qu’on lui a diagnostiqué un autisme grave, Thierry a sombré. Désormais, Alexia a 8 ans et Thierry a repris le travail, il va beaucoup mieux. Il se raconte et Fanny, côté passager, écoute, relance, questionne cet homme qui se livre sans pudeur à deux inconnus. Au fond de la banquette arrière, les yeux fermés, j’écoute le roman de la vie de Thierry. Il déploie avec une certaine virtuosité la collection d’émotions d’un père honteux d’avoir été faible, d’avoir craqué alors que sa femme et sa fille avaient besoin de lui. La tristesse de son histoire contraste avec l’énergie joviale dont débordent ses mots et ses gestes. Fanny écoute sagement, elle est d’une empathie thérapeutique, elle sait faire parler. Elle contourne habilement les sujets sensibles, et creuse là où elle sent qu’il veut qu’elle creuse. Je la connais par cœur, ça ne lui demande aucun effort, elle a été infirmière.
L’autostop, s’il rend libre, ne fait que flatter le capital car il le rend indispensable. En tendant le pouce, nous nous transformons en parasites. Nous nous accrochons à la bourgeoisie et à ceux qui l’imitent comme des tiques. On doit sourire, donner du rêve à nos chauffeurs. S’ils nous prennent, c’est pour avoir mieux que la radio : un type qui fait la route, qui va de zone en zone, qui est toujours en vadrouille, toujours en vacances, toujours en errance, l’errance romantique du vagabond heureux. C’est le contrat tacite. S’ils nous prennent, en plus de les maintenir éveillés, on doit les empêcher de broyer du noir. Je ne me raconte pas d’histoires. Fanny, elle, s’en raconte. Elle trie sur le volet. Quand elle a le choix, elle veut entrer dans une voiture qui a du vécu, dans laquelle on peut fumer, dans laquelle le chauffeur est un hippie sur le retour, une soixante-huitarde encartée à la CNT, quelqu’un avec qui on peut causer révolution, oppression et lutte des classes. Quand elle a le temps et qu’il ne pleut pas trop, elle choisit dans quelle voiture elle monte. Les principes ont comme variable l’horloge et la météo.
La conversation en stop est rarement politique. C’est la plaie du contre-don. Le voyage n’est pas gratuit, monsieur, il faudra être sympathique. Et surtout d’accord avec tout ce qui se dit. Il est très difficile de ne pas être d’accord en autostop. Si je l’ouvre trop, il va me laisser sur le bord de la route. L’autostoppeur ne doit pas aller trop loin. Fanny écoute, en connaisseuse, pour faire durer le plaisir de Thierry.
Je m’endors dans le bercement de la voix monocorde. Elle se fond dans le bruit de la voiture, et tout devient un vrombissement lourd qui vibre et fait vibrer.
Nous arrivons à Toulouse par Montauban. La végétation change. Thierry ne s’est pas arrêté depuis qu’il nous a pris, 500 kilomètres plus au nord. Il s’en vante, c’est un vantard. Je sens que Fanny n’a plus envie de discuter. Elle laisse la vie de Thierry se dérouler sans aide, toute seule, et elle regarde le paysage. Nous allons devoir nous rendre au lieu de rendez-vous de mémoire. La consigne était claire : ne notez l’adresse nulle part. Si vous demandez votre chemin, citez seulement la station de métro Mirail-Université. Ensuite vous trouverez la maison. Thierry nous dépose dans une zone industrielle, à notre demande. Je crois qu’il est ému, et il a un petit mot d’adieu tremblotant pour Fanny. Il n’a posé aucune question sur nous. Qui nous sommes, ce que nous faisons, ce en quoi nous croyons, ce que nous voulons détruire, et pourquoi. C’est heureux, nous aurions été obligés de lui mentir, parce que nos projets sont secrets, que notre lutte est souterraine, et que nous ne l’aurions pas convaincu de notre mode d’action.
Il y a presque un an, tout a changé. La vie était si confortable quand j’étais moins libre. Quand j’étais moins conscient. Avant la Communale.
***
Il règne sur le campus le calme de la fin de l’été. J’ai obtenu un contrat avec la bibliothèque de l’université. Je fais le tri dans les livres, j’archive, je classe. Sans conviction, je redouble ma troisième année de licence de sociologie. Mes études piétinent, je passe trop de temps dans les réunions du syndicat étudiant. Et dans les bars. Rennes 2. Après le travail dont je m’échappe plus tôt que prévu, j’erre dans les couloirs et le long des bâtiments. Avec nostalgie, je me remémore les assemblées générales, les journées d’action politique, où l’université entière était bloquée. L’atmosphère de cette fin d’été est ennuyeuse et triste, on ne croise personne, il manque les vibrations habituelles, les allées sont désertes, et je suis seul. Alors je saute sur la première invitation à faire la fête.
J’ai d’abord regardé le papier avant de regarder le gars : techno, soutien à la Zad de Notre-Dame-des-Landes, prix libre, lieu sur demande. Comment ça, sur demande ? Il n’y a pas vraiment l’autorisation d’organiser des concerts, alors pour ne pas faciliter la tâche des flics, on se transmet le lieu à l’oral. Je me suis demandé quel est l’intérêt d’imprimer des tracts qui ne contiennent pas l’information la plus importante. Mais je ne dis rien. Le garçon a compris que je suis intéressé. Je viens de rencontrer Yann.
Yann a des allures de clochard, il sent la transpiration vieillie. Ses vêtements sont tachés et en mauvais état. Ses sandales laissent voir ses pieds noircis par la terre et l’humidité. En temps normal, j’aurais un réflexe d’évitement, mais pas là. Pas avec Yann, parce que l’intention politique justifiait tout. Admiratif, je m’imagine que tout ça, les fringues puantes, c’est politique. Il a une voix grave, apaisée, et une manière de regarder autour de lui, par en dessous, qui le rend étrange. On devine, cachée, profonde, une forme de rage de vivre que je ne connais pas et que j’ai envie de comprendre.
Le lendemain, seul, j’arrive devant un ancien club de strip-tease dont les fenêtres ont été bouchées par des parpaings. Sur le trottoir, quelques gars discutent en fumant des cigarettes. Je me roule aussi une clope, un peu pour me donner de la contenance et du courage. Demander du feu, en profiter pour poser des questions. Je constate qu’il faut faire attention aux questions. Les gens y répondent rarement, et vous vous trouvez gêné, sans filet. La vieille porte en bois, équipée d’une petite trappe, est défoncée et ne tient plus sur ses gonds. À l’intérieur, une grande salle d’un autre temps, un long bar aux motifs léopard, des lumières roses et des barres de métal auxquelles s’accrochent les filles, mimant avec ironie des danses acrobatiques. Une centaine de personnes dansent et boivent. Le lieu a tout l’air d’avoir été ouvert le jour même. Sur les murs, on a accroché des affiches : Contre Vinci et son monde, résistance et sabotage. Je me mets à la recherche de Yann. Dans la pénombre rosée, difficile de distinguer quelqu’un : les sweatshirts sont noirs, comme les pantalons. On boit du vin dans des gobelets en plastique qu’on se sert soi-même. Pas d’organisateur, pas de barman, pas de gérant, pas de hiérarchie apparente. Ici, les choses sont politiques, insurrectionnelles, les choix sont pesés, les choses sont pensées. Dans l’instant, j’ai envie de vivre comme eux, de ressembler à ces gens qui ne se contentent pas des réunions du syndicat étudiant. Yann me fait un signe, il est dans une petite pièce attenante où il discute avec deux autres garçons. Il me sourit et me présente à Mathis et Louis, qui semblent plus jeunes que lui. Nous buvons beaucoup de vin et devenons amis.
C’est la fin d’un été lourd et sans saveur, j’ai laissé s’installer en moi une sombre lassitude, un ennui solitaire. J’habite un petit appartement de centre-ville, au rez-de-chaussée, il faut traverser un étroit couloir tout en bois, que je partage avec la crêperie d’à côté. Mon appartement est au fond de la petite cour, le portable ne passe pas, les murs sont trop épais. Le soleil non plus. Pour payer mon loyer sans demander d’argent à mes parents, je travaille dans un magasin bio, où je fais des sandwiches végétariens le matin et la mise en rayon l’après-midi. Les magasins bios ont toujours la même odeur, partout. Une odeur de pain au levain, de spiruline et de bois brut.
Dans les semaines qui suivent, je vois souvent Yann, Mathis et Louis. Nous profitons de la fin du mois d’aout pour mêler nos solitudes. C’est ainsi que nous découvrons la Communale, qui se dresse au petit matin sur notre chemin d’insomniaques.
C’est l’une de ces grandes écoles construites dans les années 1970 pour scolariser les enfants d’immigrés, où tout semble bâclé, où la cour d’école est une vaste étendue de bitume sans un seul arbre. Tellement bâclée, qu’elle n’a pas dû servir plus de vingt ans, avant d’être déclarée insalubre, avant qu’il ne soit plus correct d’y accueillir des enfants, même d’immigrés. J’ai grandi dans une école de campagne d’un petit village au bord de la ville, il n’y avait que deux institutrices. La cour, c’était les arbres et les fossés qui entouraient les champs de colza l’été. L’hiver, nous jouions à la guerre dans la salle des fêtes ouverte spécialement pour nous. Nous étions une cinquantaine d’élèves et cela me semblait déjà beaucoup. Nous grandissions dans un monde tranquille et calme. Cette école n’a rien à voir avec mon école. Elle comporte une vingtaine de classes, des couloirs interminables. Aux enfants, elle a dû paraitre disproportionnée, presque irréelle. Elle est au cœur d’un quartier de tours au sud de Rennes. Après sa fermeture, elle avait été mise à disposition d’associations qui trouvaient là un arrangeant espace de stockage et des salles de réunion. Une seconde vie qui a fait oublier que des milliers d’enfants ont vécu, entassés, dans cette école-usine.
Louis nous appelle depuis le toit. Il a trouvé une échelle. Mathis, Yann et moi grimpons les barreaux rouillés. Nous regardons le soleil se lever en fumant un joint. La fumée se perd dans les premiers rayons. Les arbres rosissent, et toute la cour est colorée. Nous sommes assis, les pieds dans le vide, songeurs, dans le silence du petit matin. Nous pensons tous à la même chose. Louis demande :
« On le fait ? On s’installe ici ?
– Attends, attends, c’est un énorme bâtiment, qui appartient à la mairie, c’est sûrement surveillé, dit Yann.
– Arrête un peu, regarde comme on est rentrés. Ça ira tout seul. Personne ne s’occupe de ce truc, dit Mathis.
– Chaud, je dis. Ultra-chaud. »
Silence.



