En avril 2024, inaugurant les restaurations du château de Dampierre, dans les Yvelines, propriété de la richissime famille Mulliez, la ministre de la Culture, Rachida Dati, s’en est prise aux fouilles archéologiques préventives qui avaient précédé ces travaux. À sa manière, sans façons ni précautions : « Il ne faut pas faire des fouilles pour se faire plaisir, ou alors on ne fait pas payer. […] Je préfère mettre de l’argent dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour creuser un trou ».
Cette sortie ministérielle n’était pas anodine, et les archéologues professionnels ne s’y sont pas trompés qui, immédiatement, s’en sont émus. Elle annonçait en effet une offensive au nom de la « simplification administrative » contre les dispositions légales qui, depuis une loi obtenue de longue lutte en 2001, obligent collectivités, entrepreneurs, maîtres d’ouvrages, constructeurs et bâtisseurs, publics et privés, etc., de soumettre leurs projets d’aménagements à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP, créé en 2002) qui, après les avoir évalués, décide si des fouilles sont impératives, quitte à retarder les travaux prévus.
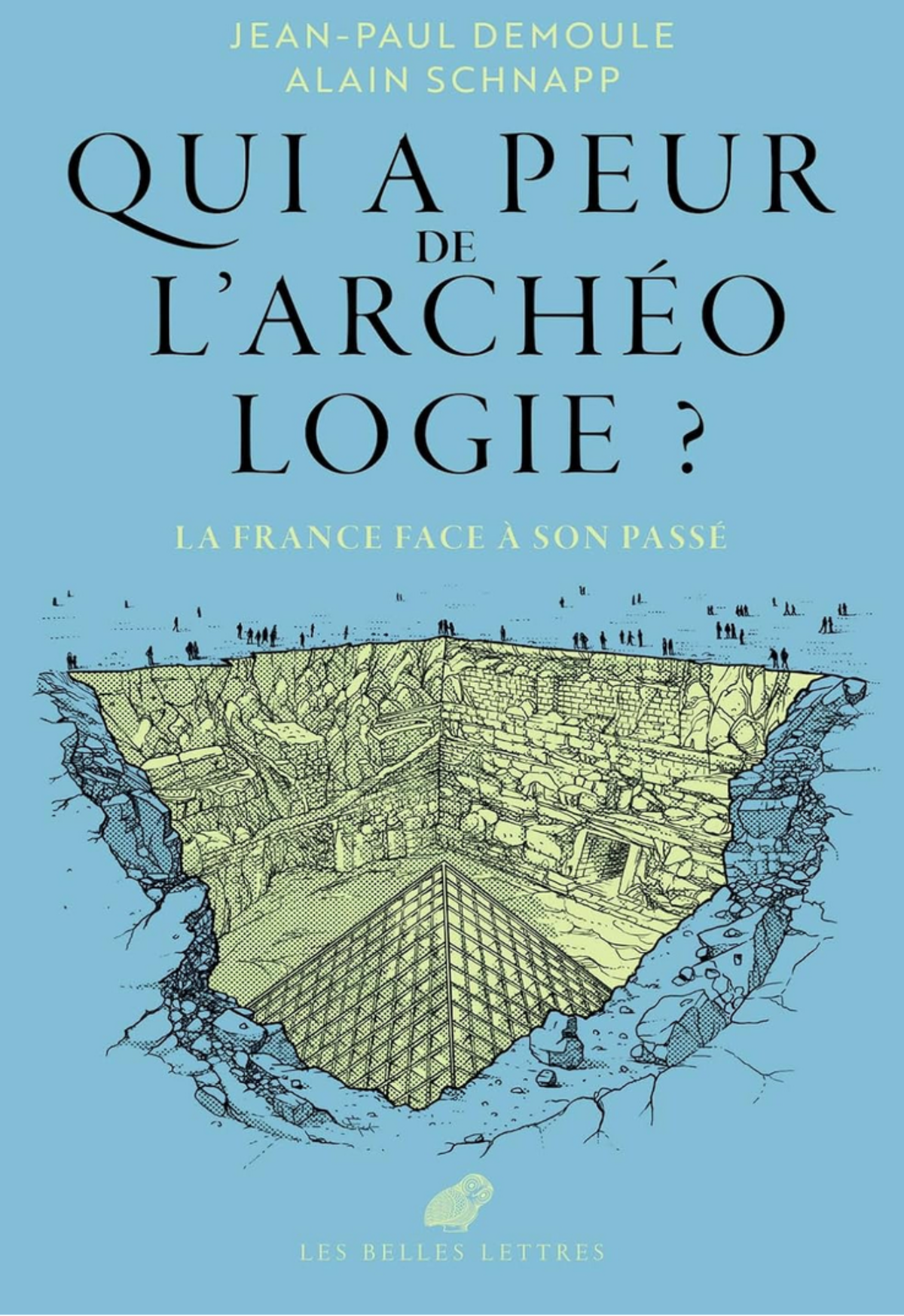
Agrandissement : Illustration 1
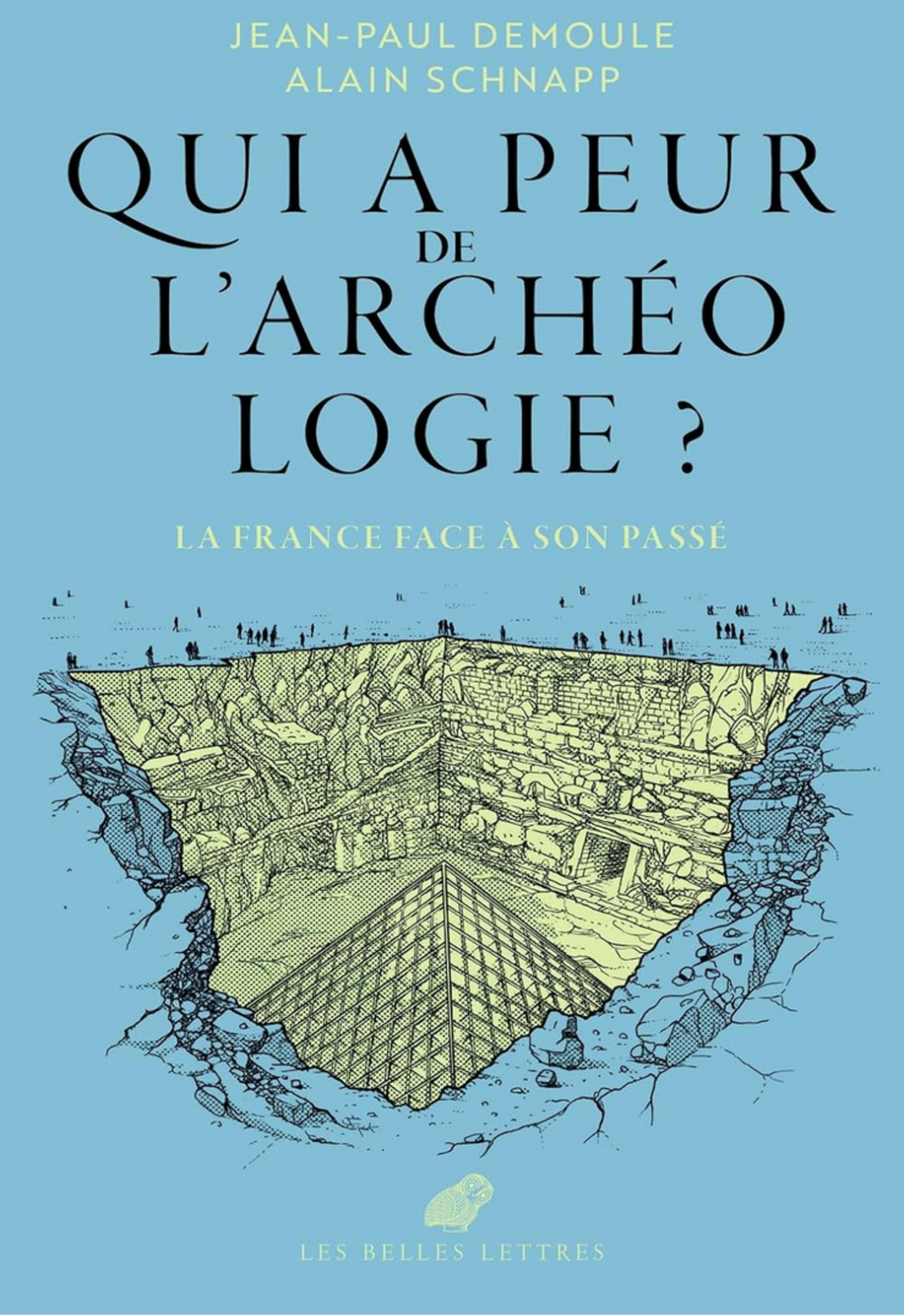
Qui a peur de l’archéologie ? Sous ce titre, Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp, se sont immédatement demandé, dans un ouvrage aussi pertinent que pédagogique paru dès septembre 2024, ce que signifiait cette offensive. Ils étaient les mieux placés pour le faire car c’est leur entêtement, depuis leurs études communes à la Sorbonne à la fin des années 1960, qui est à l’origine de la loi de 2001 et de la création de l’INRAP en 2002. Archéologue préhistorien, Jean-Paul Demoule en fut le premier président (2001-2008), tandis qu’Alain Schnapp, historien archéologue spécialiste de la Grèce antique, prenait la direction de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), créé au même moment.
Leur livre est le point de départ de cette série d’émissions spéciales de « L’Échappée », dont l’actuel président de l’INRAP, Dominique Garcia, historien archéologue spécialiste de la Gaule, est le troisième invité. Tous trois ont codirigé ensemble un ouvrage fondamental, paru en 2018, Une histoire des civilisations, sous-titré Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances, qui, avec une grande rigueur scientifique, met en évidence l’enjeu politique de cette bataille autour de l’archéologie. Cette série est en effet l’occasion de comprendre combien depuis trente ans, grâce aux révolutions technologiques, l’archéologie a changé notre regard sur nous-mêmes, nos civilisations et notre espèce.
Fouiller la terre, chercher des preuves, trouver des indices, émettre des hypothèses, confronter des récits, le tout à partir d’un travail très concret qui n’a rien de livresque, tissé de métiers très matérialistes qui n’ont rien de spéculatif, c’est inévitablement échapper aux racontars et aux fadaises qui nourrissent une histoire hantée par les mythologies identitaires, les origines immuables, les civilisations éternelles. Bref, l’archéologie dérange parce qu’elle nous confronte à toutes les incertitudes – hasards, mouvements, déplacements, rencontres, brassages, accidents, etc. – qui nous ont fait ce que nous sommes, aujourd’hui.
Durant ces trois émissions, diffusées en accès libre les vendredis 8, 15 et 22 août à partir de 19 h, Jean-Paul Demoule, Alain Schnapp et Dominique Garcia partagent avec simplicité leurs éminents savoirs pour mieux nous faire comprendre qu’il n’y a d’histoire qu’au présent. Autrement dit que se confronter vraiment au passé, sans mythologie ni illusion, c’est affronter résolument le présent. Ses défis, ses tragédies, ses espérances. Car si, dans l’imaginaire courant, l’archéologie se résume à des ruines – lesquelles, en France, peuvent n’être que des traces de maisons en bois ou des morceaux de silex taillés –, dont l’inépuisable poésie a inspiré nombre de peintres et d’écrivains, c’est bien parce qu’elle nous rappelle la condition éphémère de l’espèce humaine et la responsabilité qui devrait en découler. Vis-à-vis du Tout-Vivant du Tout-Monde, comme aurait dit Édouard Glissant, donc, aussi, de nous-mêmes.
Un dernier mot, personnel, avant que vous ne découvriez la première de ces « Échappées » en défense de l’archéologie dont le préhistorien Jean-Paul Demoule est l’invité – Alain Schnapp sera l’invité de la deuxième, Dominique Garcia de la troisième. Si j’ai souhaité faire cette série, c’est aussi en souvenir de ma première passion qui, avant le journalisme et les engagements qui l’ont accompagné, fut… l’archéologie. Le hasard d’un chemin de vie m’a transformé en fouilleur du présent, de ses secrets cachés et de ses scandales enfouis, alors que ma première passion fut de fouiller le passé le plus lointain.

Agrandissement : Illustration 2

Entre 1968 et 1970, en Algérie où j’ai vécu entre mes 13 et mes 18 ans, j’ai en effet participé aux fouilles menées sous la direction de deux archéologues réputés, le Français Paul-Albert Février et l’Algérien Mounir Bouchenaki. C’était sur le site de Tipasa, à l’ouest d’Alger, dont Albert Camus fut le récitant, qui fut ma seconde source d’inspiration après la Martinique de mon enfance. Il s’agissait, par le détour des tombes d’une nécropole, des ruines d’un empire, celui dont Rome fut l’épicentre. Des restes et des traces d’une puissance qui n’imaginait pas sa chute, d’une grandeur qui se croyait éternelle, d’une domination minée par son aveuglement sur elle-même.
En souvenir de ces fouilles auxquelles, professionnellement, j’ai finalement été infidèle, je dédie cette série archéologique à la fraternité franco-algérienne dont elles témoignaient, tant elle est aujourd’hui mise à mal par des dirigeants incultes, étrangers à la longue durée et prisonniers de l’éphémère immédiateté. Mais peut-être que je ne l’ai pas été tant que cela, infidèle. Car le journalisme, tel que nous l’entendons à Mediapart, n’est pas sans affinité avec l’archéologie : nous aussi, nous cherchons des traces, des indices, des trésors, des bribes d’humanité tout comme des secrets de puissants. La seule différence est de résonance, d’actualité immédiate et de pertinence obligée. Or elle n’est que d’apparence : ce que disent nos trois invités, c’est que le passé, aussi lointain soit-il, plutôt que d’être un monument antiquaire, figé et immobile, est une source d’inspiration vivante pour le présent, stimulante et dérangeante.
> Tous les épisodes de la série sont ici.



