Sous la présidence de Thierry Beaudet, le CESE mène actuellement d’utiles travaux sur la question démocratique vitale de la qualité, de l’intégrité et de l’indépendance de l’information. Ils ont déjà donné lieu, en mars 2024, à un avis faisant des propositions concrètes aux fins d’agir pour « une information fiable, indépendante et pluraliste au service de la démocratie », dont Thierry Cadart et Vincent Moisselin sont les rapporteurs (retrouver ici l’avis et lire là sa synthèse).
Parallèlement, la même Commission Éducation, culture et communication, présidée par Jean-Karl Deschamps, mène des auditions afin de rendre un deuxième avis, dont Souâd Belhaddad et Marie-Claude Picardat sont les rapporteures, sur la banalisation de la violence verbale et des discours de haine (les précisions ici). C’est dans ce cadre que j’ai été auditionné le mercredi 25 septembre. On retrouvera ci-dessous la transcription de mon propos liminaire, précédé d’une courte vidéo le résumant.
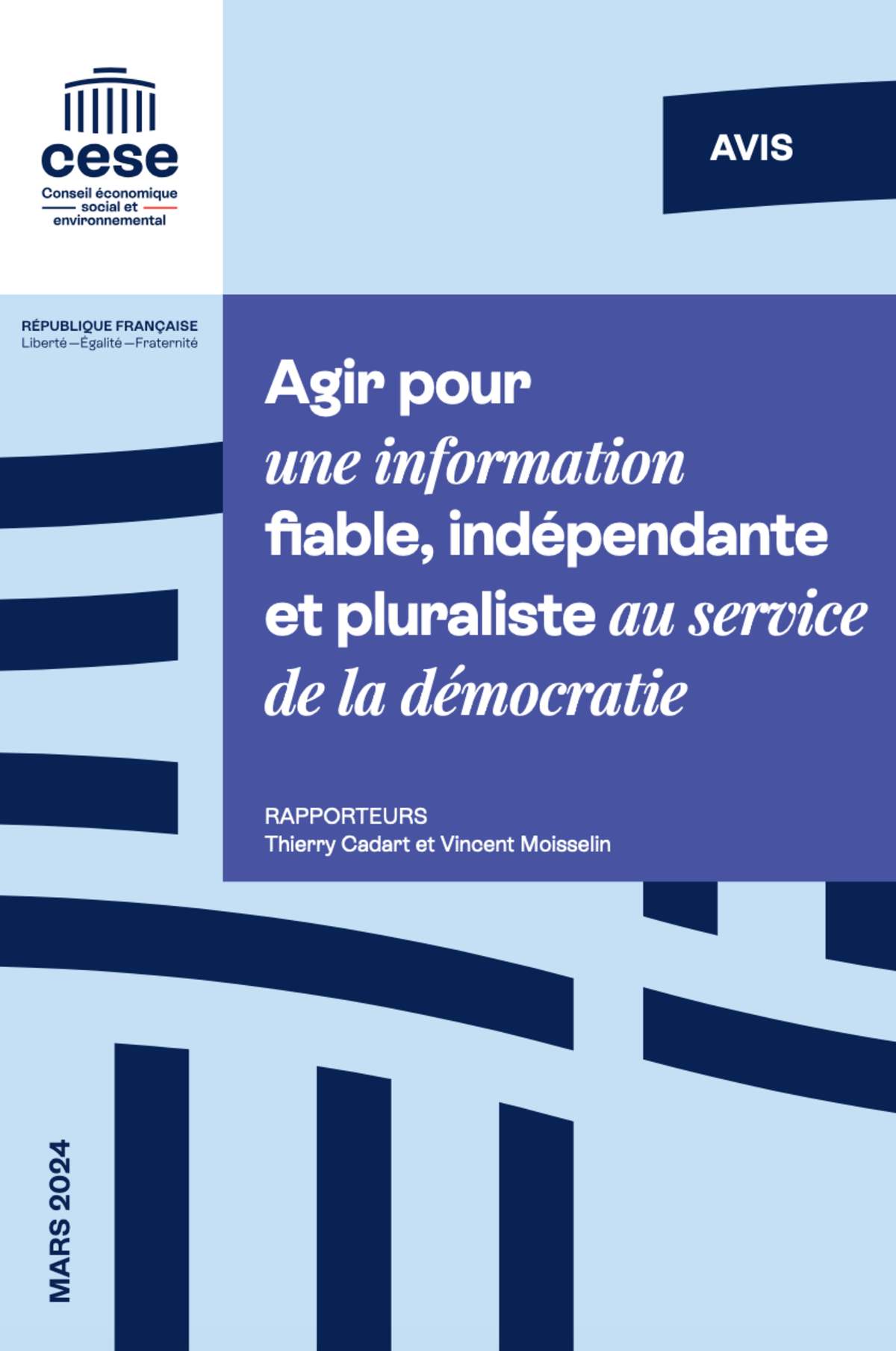
Agrandissement : Illustration 1
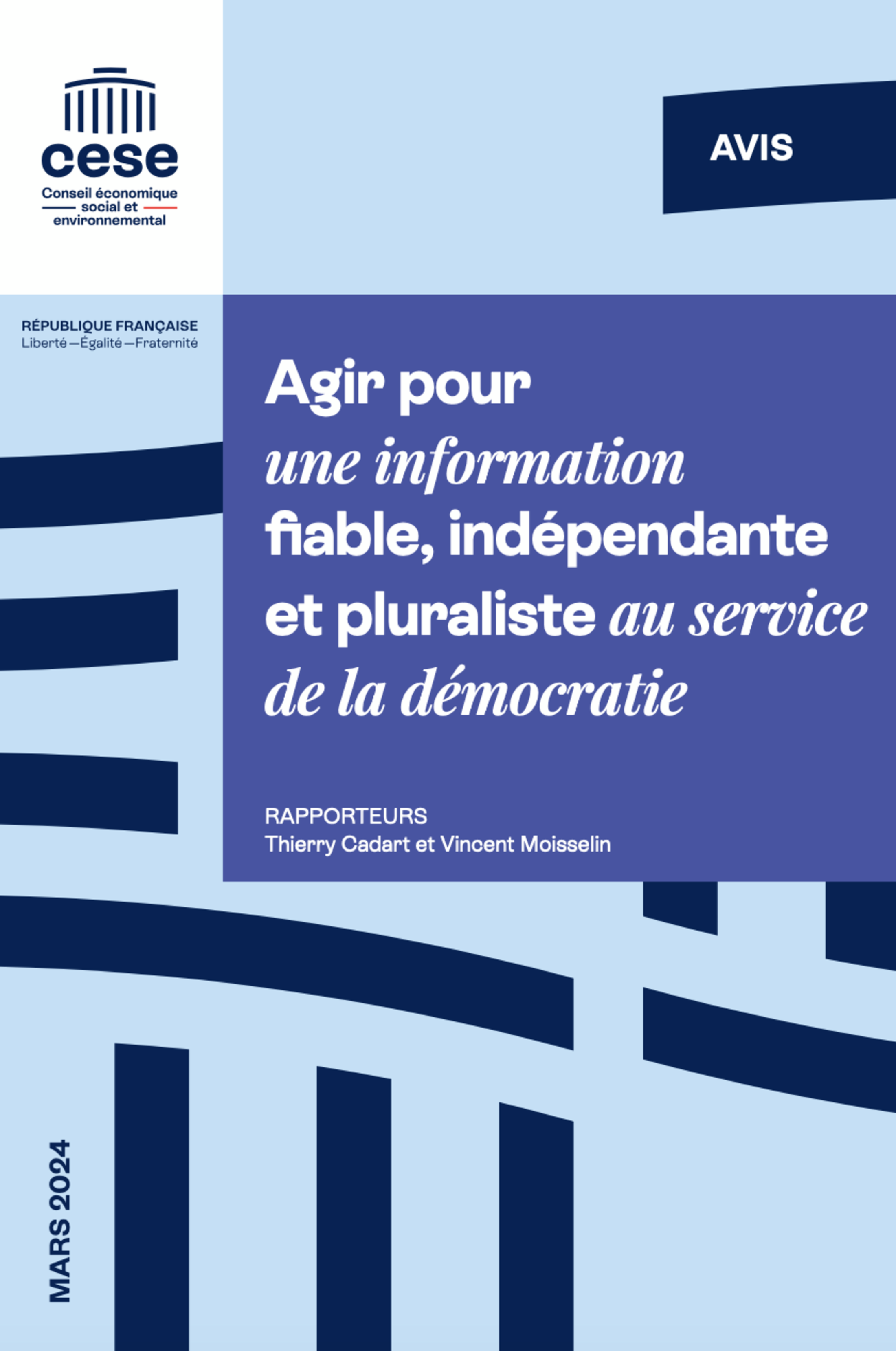
Depuis, j’ai été invité par le CESE à participer, mardi 12 novembre, à une table-ronde ouverte au public autour du premier avis, sur le thème : « Comment redonner confiance dans les médias ? » Les autres intervenants étaient : Raphaëlle Bacqué, présidente de la Société des rédacteurs du Monde ; Hervé Godechot, membre du collège de l’Arcom, ancien journaliste de France Télévisions ; Bruno Patino, président d’Arte et du comité de pilotage des États généraux de l’information (EGI) ; Nathalie Sonnac, professeur à l’Université Panthéon-Assas, présidente du Conseil d’orientation et de perfectionnement du Clémi (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information). On retrouvera la vidéo de nos échanges et du débat avec la salle en conclusion de ce billet.
En préambule de mon audition sur l’action contre les discours de haine, le président Jean-Karl Deschamps et la rapporteure Souâd Belhaddad ont rappelé L’Appel à la vigilance (Éditions La Découverte), publié en 2023, trente ans après l’appel du même nom initié par Maurice Olender auquel ce livre rendait hommage face à une banalisation des mots, idées et thématiques de l’extrême droite qui n’a cessé, depuis, de s’étendre dans le débat public. Voici donc la transcription de mon propos liminaire :
Contre la banalisation des discours de haine
Bonjour à toutes et tous et merci de l'invitation.
Cet « Appel à la vigilance » auquel j'ai rendu hommage il y a un an et demi, en commençant ce livre par une simple phrase « Que nous est-il arrivé ? » est paru dans le journal dont j'ai dirigé la rédaction pendant dix ans, Le Monde, en juillet 1993. Son initiateur, Maurice Olender, qui n'est plus de ce monde, décrivait cet appel comme un « appel philologique », pas un appel de gauche ou de droite ayant une étiquette partisane, mais une mise en garde sur ce qui est le sujet de vos travaux : les mots, l'usage des mots, l'utilisation de la langue, la brutalisation des mots, la déchéance de la langue. Parmi ces signataires, on trouve à peu près toutes les grandes figures intellectuelles de l’époque à l'échelle européenne, dont Umberto Eco qui a prolongé cela, y compris par un petit essai sur ce qu'est pour lui le retour du fascisme.
C'est peu dire que cet appel est un appel vaincu puisque 30 ans après, je lui rendais hommage et une année plus tard, nous nous retrouvons avec les conséquences politiques, électorales, voire aujourd'hui gouvernementales, de cette question, de cette banalisation par les mots, par les écrits, par les discours, de ce qui fait la courte échelle à des politiques qui rompent la promesse (j'y reviendrai) fondatrice du lieu où je parle, qui est l'égalité des droits.
Dans ce livre, je rappelle deux citations qui pourraient servir d'exergue à votre rapport final. L’une est d’un Français, Gustave Le Bon, qui est une figure assez complexe, mais intellectuellement très intéressante, puisque c'est lui qui a écrit « Psychologie des foules », un livre qui a été aussi bien lu par des gens de gauche que par la future incarnation du fascisme italien Mussolini : comment instrumentaliser les foules, comment aveugler les masses. Dans ce livre, il dit : « La puissance des mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses ». C'est écrit avant le début de la catastrophe européenne, avant les 30 ans de guerre civile qui vont se traduire par deux guerres mondiales et des montagnes de cadavres, le crime contre l'humanité, le crime de génocide.
Un témoin de tous ces crimes, qui va survivre miraculeusement et qui lui-même était un linguiste, un spécialiste des mots, Victor Klemperer, va en témoigner avec un ouvrage fondateur, « LTI, la langue du IIIe Reich ». Victor Klemperer, allemand, réussissant à survivre alors qu'il était juif sous le nazisme, va noter tout ce qui sera fait par la radio, par les tracts, par les prospectus pour banaliser des mots qui vont permettre que la barbarie surgisse au cœur de la civilisation. Car c'est bien là l'enjeu de vos travaux.
Aucune nation ne naît raciste, ne naît meurtrière mais nous savons que le fait de se proclamer civilisé, cultivé, développé ne suffit pas à garantir que nous ne basculions pas dans la barbarie. C’est donc cette énigme : comment des peuples cultivés, civilisés, éduqués, peuvent devenir des peuples indifférents à l'humanité ?
Victor Klemperer fait écho à Gustave Le Bon dans ses travaux : « Les mots peuvent être de minuscules doses d'arsenic, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet et voilà qu'après quelques temps, l'effet toxique se fait sentir ».
Sur les mots, je vais avant de développer mon propos et d'en venir aux propositions que vous souhaitez que je formule, prendre un exemple. « Notre programme remplace la notion libérale d'individu et le concept marxiste d'humanité par le peuple. Un peuple déterminé par son sang et enraciné dans son sol. Voilà une phrase bien simple et lapidaire mais qui a des conséquences titanesques. » Fin de citation. Vous avez bien entendu : il n'y a plus d'individu ayant un libre arbitre, il est assigné à résidence, le sang, le sol, la lignée, l'origine, l'identité fixe ; il n'y a pas d'humanité commune, il n'y a qu'un peuple déterminé par le sang, le sol, par son identité qui serait immobile, qui serait enracinée.
Cette phrase détruit l'idée d'une humanité commune, l'idée d'un libre-arbitre, par des mots simples, comme il dit lui-même, « simples et lapidaires », et dont il prédit que cela aura des conséquences titanesques. Je viens de lire un extrait de « Mein Kampf » d'Hitler. Il ne savait pas que les conséquences titanesques auraient lieu, mais il disait bien ces mots simples « un peuple, le sang, le sol, l'identité à racine unique, pas de libre arbitre des individus, pas d'humanité commune, pas de droit de l’humanité supérieur aux peuples et aux nations, aux États », et dire cela a des conséquences titanesques. Notre continent, qui n'a de leçons à donner à personne de ce point de vue, en fut le théâtre puisque c'est sur notre continent que furent commis les crimes qui ont été juridiquement ensuite qualifiés de « crimes contre l'humanité » et de « crimes de génocide ». Ces deux notions ont été inventées juridiquement après la catastrophe européenne.
Je vais angler mon propos liminaire sur trois thèmes, votre question étant « Comment se banalisent ces discours de haine ? »
- Premier thème : la politique
- Deuxième thème : les médias.
- Troisième thème : la question éthique.
J'aime dire (je ne sais si c’est un proverbe chinois ou que j'ai inventé) que « le poisson pourrit toujours par la tête ». Donc, avant de se préoccuper des réseaux sociaux, avant de se préoccuper des bêtises que peuvent consommer tel ou tel citoyen ou tel ou tel jeune, occupons-nous de ceux qui sont en charge d'instituer notre Nation. Je parle du discours politique.
Je vous l'ai dit en introduction, ce qui nous fonde, c'est la proclamation de l'égalité des droits. Cela n’a pas d'étiquette partisane. Quand cela a été proclamé en 1789, après la déclaration américaine (nous ne sommes pas propriétaires de cette universalité), il n'y avait aucun droit, ni droits politiques, ni droits sociaux, ni droits des femmes, les esclaves existaient toujours, ni droits des colonisés, et ainsi de suite. La proclamation de l'égalité des droits est un horizon d'émancipation, un horizon infini qui nous permet à la fois de conquérir des droits, d'inventer des droits, de défendre des droits, et c’est évidemment un moteur infini ; la cause des femmes le montre puisqu'elle est trans-partisane en termes de milieu politique, professionnel et social. Mais aussi, nous le voyons bien, y compris pour nos générations actuelles, nous découvrons les droits du vivant et nous ne pouvons pas, au nom de la grande puissance de notre espèce, détruire le vivant, le saccager, comme nous le faisons depuis que nous nous sommes saisi de cette notion du progrès.
L'égalité des droits, donc. En 1948, la Déclaration universelle des Droits de l'homme, dont le rédacteur fut un Français, René Cassin, l'a proclamée à l'échelle de l'humanité tout entière. Nous savons bien que nombre de nations ne la respectent pas ; nous en avons même la preuve sous nos yeux aujourd'hui, par temps de guerre en Ukraine et à Gaza, mais cet horizon nous permet de défendre nos droits, notre commune humanité. Cette question de l'égalité des droits, c’est un socle, c'est un tabou démocratique. On ne doit pas pouvoir y toucher.
Comment les forces de l'inégalité des droits que nous avons vaincues en 1789 (l'abolition des privilèges), que nous avons vaincues en faisant tomber le fascisme et le nazisme, comment ces forces de l'inégalité des droits, qui sont non seulement des forces politiques, mais aussi des forces idéologiques, qui ont des intellectuels, qui ont des penseurs, qui croient qu'on est inégaux par nature, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des croyances, des apparences, des sexes, des genres supérieurs à d'autres, comment, malgré leur défaite, réussissent-elles à revenir, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde, comme des pensées légitimes ? Comment sortent-elles de cette marginalité où leur défaite les avait mises ? En prenant un cheval de Troie.
Dans notre pays, depuis 50 ans, ce cheval de Troie - cela a commencé par une réunion publique en 1973 à Paris contre « l'invasion étrangère » -, c'est la question migratoire. C'est comme cela qu'ils s'attaquent à l'égalité des droits. Depuis 40 ans, nous avons fait plus de 30 lois sur la question migratoire, cela n'a résolu aucun de nos problèmes sociaux, démocratiques et écologiques.
L'obsession de l'immigré, l'obsession de l'étranger, l'obsession de l'ailleurs, l'obsession de l'autre, c'est le cheval de Troie pour faire tomber l'égalité des droits. C'est ainsi que l'on commence. On commence à rendre cela comme une évidence. Contre l'égalité, que va-t-on opposer ? L'identité. L’étranger serait une menace pour l'identité. Et on va commencer à dire qu’il est normal qu'il y ait des « ayants droits » et des « sans droits » et de là, on va commencer à mettre en cause des droits fondamentaux : s'il y a des droits fondamentaux, il y a un droit à la santé. C'est un droit qui est au dessus de l'origine. Il y a un droit à l'éducation, c'est un droit qui est au dessus de l'origine. Eh bien non, on va commencer à parler de l’aide médicale d'État : certains ont droit à la santé, d'autres n'ont pas le droit à la santé. On va commencer à dire pour les mineurs non-accompagnés : « Tant pis », et ils n'ont pas le droit à l'éducation. Alors qu’il y a des droits fondamentaux, droits de l'enfance, droits de l'humanité.
C'est mon premier point. La première responsabilité, c'est la façon dont nos politiques n'ont pas tenu la digue sur cette question. Et je vous ferai une proposition concrète là-dessus.
En termes d'imaginaire, qu'il y ait des problèmes d'accueil, qu'il y ait des problèmes d'intégration, comme dans toute société, bien sûr, mais la question est : est-ce que l'on tient ferme sur cette idée que notre problème central n'est pas la question de l'étranger, la question de l'autre ?
Vous avez, je suppose, dans d'autres lieux, auditionné François Héran et d'autres démographes. À l'échelle du monde, aujourd'hui, la question migratoire n'est pas la question centrale de notre continent, d'aucune manière, d'aucune statistique, d’aucune réalité ! La seule question est : comment travaillons-nous justement à faire vivre le fait que nous sommes un creuset ? Nous sommes faits d'immigration, c'est la particularité même de notre pays en Europe. Nous ne sommes pas un pays d'émigration. Nous ne sommes pas l'Italie, nous ne sommes pas l'Espagne, nous ne sommes pas le Portugal, nous ne sommes même pas l'Allemagne du 19ème siècle. Nous avons été constitués dans cette relation au monde qui s'est poursuivie, y compris par notre projection sur le monde, par le fait que nous avons toujours des territoires dits d'outre-mer, que nous avons eu une très longue relation avec le continent africain et avec toute la Méditerranée.
C’est donc la première question : plus on fera de l'obsession de la question migratoire, de la question de l'étranger le dérivatif à nos enjeux sociaux, démocratiques, écologiques, puis on fera le lit de la banalisation des discours de haine. Évidemment, nous sommes au cœur de notre actualité ; la préférence nationale était au cœur de la loi Immigration. La préférence nationale, c'est mettre à bas l'idée de l'égalité des droits à l'échelle fondamentale de l'humanité.
Deuxième question, les médias.
Nous sommes tous témoins du fait que la révolution digitale, la révolution numérique dont Mediapart est un acteur, vit aujourd'hui son backlash. Nous avons saisi sa part de lumière, sa part démocratique, de partage du savoir, de démocratisation de l'information, et nous voyons aujourd'hui qu'elle peut être aussi une jungle sauvage, où vont s'exprimer sans frein, sans modération, toutes sortes de haines, de violences, voire de manipulations, d'intoxication par des puissances étatiques.
Mais il faut aller au cœur de ce débat, parce que derrière les réseaux sociaux, en fait, la vraie question ce sont les médias de masse, radio et télévision. Ces médias que l'on ne choisit pas d'acheter, qu'on ne choisit pas de lire, qu'on ne choisit pas d'écouter, mais qui s'imposent à vous parce qu'ils sont gratuits et qu'ils sont sur des véhicules techniques qui les rendent accessibles à tous. Ce sont les canaux hertziens, ce sont des biens publics.
Nous avons une vraie régression devant nous qui pose un problème politique et philosophique. Selon moi, la démocratie, ce n'est pas l'affrontement des opinions. Et je vais vous dire des banalités que vous trouverez chez beaucoup de penseurs, chez Hannah Arendt, chez Karl Popper et bien d'autres.
Si l’on définit la démocratie comme simplement l'expression des opinions, elle tourne à la guerre de « tous contre tous », « mon opinion contre la tienne », « mon préjugé contre le tien », « ma croyance contre la tienne », « mon identité… » etc.
La démocratie, c'est la capacité de mettre au cœur du débat d'opinion un rapport au réel, un rapport à des vérités de fait, un rapport à la connaissance. C'est un texte fondamental, qui est philosophiquement fondateur sur à quoi sert le métier que je représente devant vous dans une démocratie, qu'a publié Hannah Arendt, qui s'appelle « Truth and Politics » (Vérité et politique), qui date de 1967. Elle dit qu’au fond, les vérités d'opinion, le cerveau humain en produira toujours des centaines de milliers, des raisonnables et des très folles, des pertinentes et des très dangereuses. Elle dit, en revanche, que les autres vérités sont beaucoup plus fragiles et ce sont les plus essentielles démocratiquement ; elle les appelle « Truth of facts » : les vérités de fait, pas de vérités révélées, mais le puzzle de la connaissance qui permet de comprendre et d'avoir un rapport au réel.
Nous vivons une époque où nous laissons naître des médias de masse qui détruisent, au prétexte de la liberté d'opinion, la vérité de fait. Aujourd'hui, le travail d'information a pour adversaire le droit de dire, de tout dire, y compris le pire, y compris l'abject.
La conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est qu’en démocratie, il n’est pas possible de laisser exister des médias de masse (radio et télévision) en accès libre sur des biens publics, qui soient des médias d'opinion. C'est cette étape que dans notre pays, l'instance de régulation a manquée, comme l'on manque une marche.
Il ne suffit pas de dire, par rapport à ce que représentent C8 et CNews « On va faire d'autres médias de masse d'opinion ». Non. Pourquoi avons-nous créé des médias publics de la radio et de la télévision dans toutes les démocraties ? Alors qu’on n'a pas créé de journal papier public à l'époque où la presse dominante était imprimée. Parce que la radio et la télévision, financées par la publicité, sont des médias de masse qui peuvent devenir dangereux. On a construit face à cela des médias de service public pour dire qu’il faut un rapport à un commun. On ne peut pas avoir une logique d'audience commerciale qui emporte tout et qui balaie tout.
On peut faire des médias d'opinion, bien sûr, mais que l'on va acheter, que l'on va choisir, que l'on va faire la démarche de lire. Et il y a eu des dispositions qui ont permis que, dans les kiosques, tout cela soit accessible. C'est la liberté d'opinion. En revanche, accepter que sur des biens publics que sont des fréquences hertziennes, il y ait des médias d’opinion, c’est mettre en danger la démocratie. L’erreur de l’ARCOM est de croire qu’il suffit de faire des sanctions parce qu’il y aurait des atteintes à des droits fondamentaux, sous formes de sanctions financières qui sont des gouttes d’eau par rapport aux fortunes des propriétaires. L’erreur de l’ARCOM, c’est de ne pas poser cette question.
Comme je l’ai écrit dans « L’Appel à la vigilance » au risque d’effrayer, si nous ne réagissons pas à cela, nous laissons ouverte la possibilité dans notre pays – qui est de toutes les démocraties européennes celle où il y a le plus de chaînes d'information continue, ce qui devrait déjà nous interroger... –, si nous laissons faire cela, nous permettons la possibilité qu'advienne un jour une sorte de Radio des Mille Collines. Un an avant le génocide au Rwanda, un milliardaire (arrêté il y a quelque temps en France où il se cachait), qui était le financier du génocide, a créé cette radio dans un contexte de transition politique, en disant : « Il faut qu'il y ait la liberté de dire, la liberté d'opinion », et les statuts de Radio des Mille Collines se revendiquent de cette liberté d'expression. Bref, disait-il, nous allons créer un média moderne où tout le monde pourra s'exprimer. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'émetteurs, il met de la très bonne musique, notamment du Zaïre, avec de très bons animateurs, de très bons tchatcheurs qui parlent bien et qui ont du bagout, mais le résultat final sera résumé, puisque ce média voit le jour en juillet 1993 et que le génocide a lieu moins d’un an plus tard, ainsi : « Le génocide, c'est une machette dans une main, un transistor dans l'autre ». C’est sur Radio Mille Collines qu'on va parler des cafards, que l'on va déshumaniser les Tutsis, que l’on va prendre ces mots qui vont faire que des gens qui ne sont pas des criminels par nature vont tuer leurs voisins, voire une partie de leur famille, voire leurs coreligionnaires, pendant quatre mois, jusqu'à entre 800 000 et un million de morts. « Radio Mille Collines », une radio d'opinion !
Selon moi, cette question est centrale au niveau des médias.
Enfin, je termine par le troisième point, la question de l'éthique. J'ai popularisé dans différents articles récemment cette phrase de Albert Camus dans son roman posthume, « Le premier homme » : « Un homme, ça s'empêche ». Nous vivons, à tout point de vue, dans le débat public aujourd'hui, ce que j'appelle un illimitisme, au fond, un débat public dont les responsables manquent de tenue, s'autorisent.
En d'autres termes, la démocratie, c'est une culture. La démocratie ce n'est pas simplement l'élection, le fait d'être élu ou d'avoir un mandat. C'est une culture, c'est un langage commun, c'est un respect de l’adversaire, c'est un respect de ceux qui vous élisent. C'est une langue commune.
De ce point de vue, selon moi, on ne peut pas pactiser avec ces idéologies de l'inégalité naturelle. C'est la phrase de Jean-Pierre Vernant, signataire de cet Appel de 1993, que je cite : « On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages ». En d'autres termes, vous avez un exemple sous les yeux en Belgique francophone, la question du cordon sanitaire, cela tient toujours, cela a été même rappelé par l'équivalent de l'ARCOM, le CSA belge ; le débat public belge, en termes de débat entre politiques et de débat animé par les journalistes, maintient ce cordon sanitaire. Cela ne veut pas dire que des partis d'extrême droite n'ont pas la parole, dans la mesure où ils ont des élus et des représentants, mais cela veut dire que les idées qui violent le principe d'égalité naturelle, qui violent les droits fondamentaux, n'ont pas droit de cité comme des idées comme les autres. Ce ne sont pas des idées comme les autres, ce sont des idées potentiellement meurtrières qui sont résumées en France par deux mots très simples. C'est l'écho à la phrase d'Hitler de tout à l'heure, car c'est la France qui a inventé, via un intellectuel, relayé par un journaliste, défendus ensuite par différentes autres figures du débat public et des médias, deux mots très simples qui sont les mots d'une idéologie meurtrière : le « grand remplacement ». Comme vous le savez, des crimes de masse ont été commis au nom de cette idéologie meurtrière en Nouvelle-Zélande et en Suède. Cette idée que notre peuple serait envahi en son sein et qu'il faudrait chasser une partie de la population qui fait partie de notre peuple.
Je termine par mes trois propositions, qui font écho à ces trois points.
Sur le premier point, la question du discours politique, de notre imaginaire de l'égalité, je fais partie de ceux - quelqu'un qui a été longtemps vice-président de la région Bretagne, Jean-Michel Le Boulanger l'a dit dans un Manifeste pour la France de la diversité, que j'ai préfacé - qui pensent que notre Constitution doit affirmer ce que nous sommes. Nous avons un legs de la Révolution française, une et indivisible, qui est très lié à l'attaque des armées monarchistes par rapport à une France qu'ils voulaient démembrer, mais en réalité notre unité est tissée de pluralité. Nous sommes une nation plurielle, nous sommes une nation de petits pays, nous sommes une nation de multiples cultures, de multiples histoires. Nous sommes tissés de cette pluralité, cette pluralité que d'une certaine manière les cérémonies des Jeux Olympique ont montrée, est notre force, notre dynamique et notre vitalité. Il faut inscrire dans la Constitution que nous sommes une nation multiculturelle. Il faut le proclamer, il faut que cet imaginaire fonde tout le débat public dans notre Constitution.
Deuxièmement, il faut demander à l'ARCOM de mettre fin à l'existence de médias d'opinion sur des canaux publics. Il ne peut pas y avoir de médias d'opinion, radio, télévision, en accès libre sur des canaux publics. Autrement, c'est la porte ouverte à ce que nous vivons aujourd'hui : la banalisation de manière très massive de ces discours de haine. Il faut se rendre compte que beaucoup de personnes isolées dans des quartiers périphériques, dans des zones périurbaines, avec la régression du syndicalisme, des solidarités associatives, du militantisme partisan, n'ont plus que ces médias que l'on retrouve y compris dans le café du village, pour être au courant de ce qui se passe.
Vous savez parfaitement, dans ces médias d'opinion, combien il y a de choses terrifiantes qui sont des mensonges, qui sont des fausses nouvelles, qui sont des violences, jusqu'à comparer les migrants à des punaises de lit. Ce sont des choses très graves qui se banalisent là, et qui ne concernent pas seulement les migrants, mais les questions de genre, les droits des femmes, les violences sexistes et sexuelles. Regardez ce qui se passe avec l'actuel procès de Mazan et ce que cela fait ressurgir comme violence de certains discours contre MeToo, contre la revendication et la prise de conscience d'une égalité des droits.
Donc ma deuxième recommandation, si vous la suiviez, c'est de secouer l'ARCOM. Son président a même laissé passer que CNews obligait à affronter cette idée nouvelle qu’il serait légitime qu’il y ait des médias d'opinion de masse. Eh bien non, je pense que c'est un danger, et vous pouvez documenter cette question. Je crois que la loi fondamentale allemande ne permettrait pas l'existence de CNews et de C8 parce qu'elle est fondée sur cette idée que si on laisse se développer ces mots-là, cela peut détruire totalement le pacte démocratique.
Enfin, la question éthique, c'est la question du « ça s'empêche » de l'illimitisme ». Je pense qu'il nous faut réaffirmer dans l'éducation, dans ce que doivent défendre les personnels de l'éducation, les responsables de l'éducation jusqu'au ministre lui-même, les responsables d'établissement d'enseignement, d'université, de lycée, de collège, que ce qui nous fonde, c'est l'égalité des droits. Nous ne devons pas laisser, sous prétexte de polémique, une place à sa remise en cause, avec des mots inventés pour s'en prendre aux minorités qui s'activent, aux minorités qui défendent leurs droits et qui forcément ont comme toujours quand on doit conquérir des droits, des excès, des excès de langage, des provocations – et toute jeunesse doit être faite aussi de ces excès. Mais ce qui se banalise dans notre langue autour de wokisme, d'islamo-gauchisme, etc., tous ces mots caricaturaux qui sont devenus banals dans le discours politique, c’est la remise en cause du combat pour l'égalité des droits.
Je le répète, ce qui nous fonde, et cela peut nous déranger, nous bousculer, c'est que nous naissons libres et égaux en droit sans distinction d'origine, d'apparence, de culture, de croyance, de sexe, de religion, de genre, et ainsi de suite. Et c'est une bataille permanente contre nous-mêmes. Nous avons tous des préjugés, nous avons tous à penser contre nous-mêmes, nous avons tous à aller vers l'autre et à déconstruire ce qui peut nous éloigner de l'autre.
Donc, ce mot « égalité » qui est au cœur de notre devise républicaine, c'est le mot charnière. La liberté peut être la liberté de s'enrichir, donc la liberté de créer des inégalités. La fraternité peut être la tentation de choisir ses frères et donc de s'enfermer dans sa communauté.
Le mot qui fait la tension républicaine, qui fait la dynamique politique et, qui encore une fois, n'a pas d'étiquette partisane, c'est ce mot « égalité ». Et vous voyez bien que tout ce qui est en jeu aujourd'hui à l'échelle du monde, de M. Milei à M. Trump, aux mollahs iraniens, à M. Poutine, et je pourrais vous en citer plein d'autres, c'est de mettre à bas cette promesse de l'égalité. Nous sommes le pays qui l’a à son fronton. Nous devons réaffirmer que l'ensemble de celles et ceux qui nous représentent, l'ensemble de celles et ceux qui instituent (à l'instar de ce beau mot d'instituteur) la nation, doivent défendre, comme vraiment le cœur de ce que nous sommes, cet idéal d'égalité.
Pour une information de qualité
Voici, en complément, la vidéo de la table-ronde du 12 novembre sur « comment redonner confiance dans les médias ». À la sortie des échanges, j’ai enregistré une courte vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux par le CESE, résumant les trois leviers d’action qui me semblent prioritaires : défendre les informations, protéger les rédactions, combattre les concentrations.



