Paru dans Le Monde daté du 10 mai 1990 – où il m’arrivait régulièrement d’écrire sur l’extrême droite –, cet article, que je republie dans ce billet, s’intitulait « Les mots sont des armes » avec en surtitre : « Le Front national veut créer son propre vocabulaire ».
Révélant un document interne de l’Institut de formation nationale (IFN) créé par le mouvement alors dirigé par Jean-Marie Le Pen et aujourd’hui par sa fille, il illustrait déjà une vérité devenue depuis encore plus flagrante : la catastrophe commence par des mots. Des mots qui l’installent, l’accoutument, la banalisent. Les milieux « immigrationnistes », qu’à son tour, l’actuel président de la République a vilipendé, y sont par exemple qualifiés de « parti de l’étranger », ce qui éclaire d’une lumière blafarde l’imaginaire politique convoqué par Emmanuel Macron.
Trois décennies plus tard, je suis revenu sur cette question des mots et de leur usage politique, qui concerne, au premier chef, notre profession, le journalisme, et les médias où nous l’exerçons. Dans L’Appel à la vigilance, hommage à un appel prophétique lancé par Maurice Olender en 1993, je rappelle cette sentence de Gustave Le Bon, l’auteur de la Psychologie des foules (1895), essai précurseur dont les intellectuels fascistes puis nazis sauront tirer d’utiles enseignement pratiques : « La puissance des mots est si grande qu’il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses ». Sur ce terrain, la stratégie langagière de l’extrême droite n’a cessé de marquer des points depuis 1990.
Ainsi, dans le livre que j’ai publié en 2023, le point de départ tient en deux mots simples – « grand remplacement » – qui, à l’abri de leur apparente banalité, installent une idéologie meurtrière : le désir d’effacer une partie de notre peuple, de l’invisibiliser ou de le chasser. Leur fait écho ce témoignage douloureux de Victor Klemperer, linguiste et philologue témoin et survivant du nazisme : « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir ».
Bref, dire, c’est faire : c’est l’idée fondamentale de John L. Austin (1911-1960), fondateur d’une nouvelle théorie, celle des actes de parole, qui a révolutionné l’approche du langage, avec notamment le concept d’« énoncé performatif », et inspiré, par la suite, les travaux d’autres savants, dont Noam Chomsky. Hasard éditorial faisant écho à notre inquiétude politique, une nouvelle traduction de son œuvre majeure, troisième livre de philosophie anglo-saxonne de l’après-guerre le plus cité au monde, vient de paraître au Seuil : Quand dire, c’est faire.
Si, depuis trente ans que nous sonnons l’alarme, tant de terrain a été perdu face à l’extrême droite, ce n’est pas seulement parce que les représentants politiques ayant la charge de la repousser ont mené des politiques impopulaires et injustes, c’est aussi parce qu’ils ont cédé sur ce terrain du langage : en banalisant ses mots, en les tolérant, en les reprenant, en les acceptant. Dans sa perdition, Emmanuel Macron en est devenu le cas le plus emblématique.
Voici donc l’article paru il y trente-quatre ans dans Le Monde. Si cette alarme n’a pas suffisamment été entendue par les gouvernants de gauche, elle a, en revanche, donné lieu à une prise de conscience citoyenne qui s’est notamment manifestée par la création du collectif « Les mots sont importants » qui existe toujours, animé notamment par Pierre Tevanian et Sylvie Tissot.
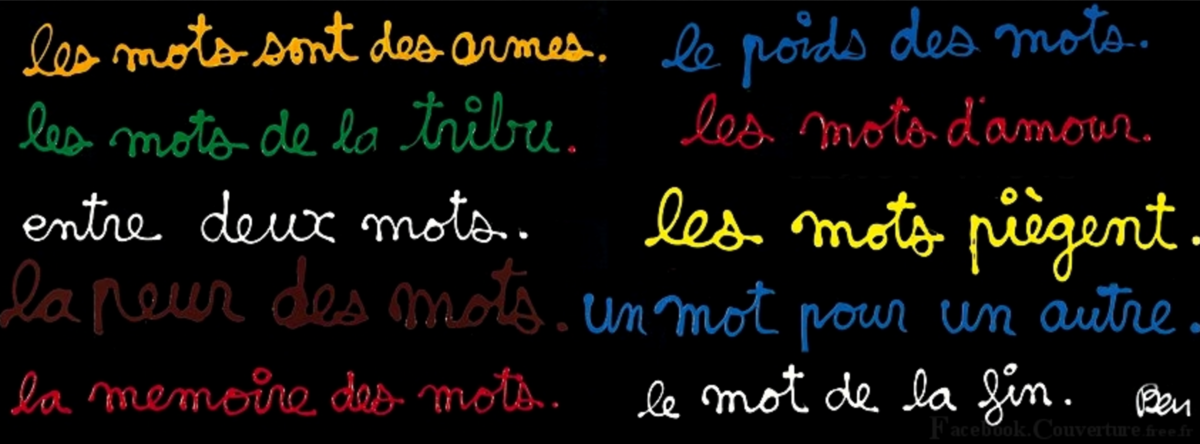
Agrandissement : Illustration 1
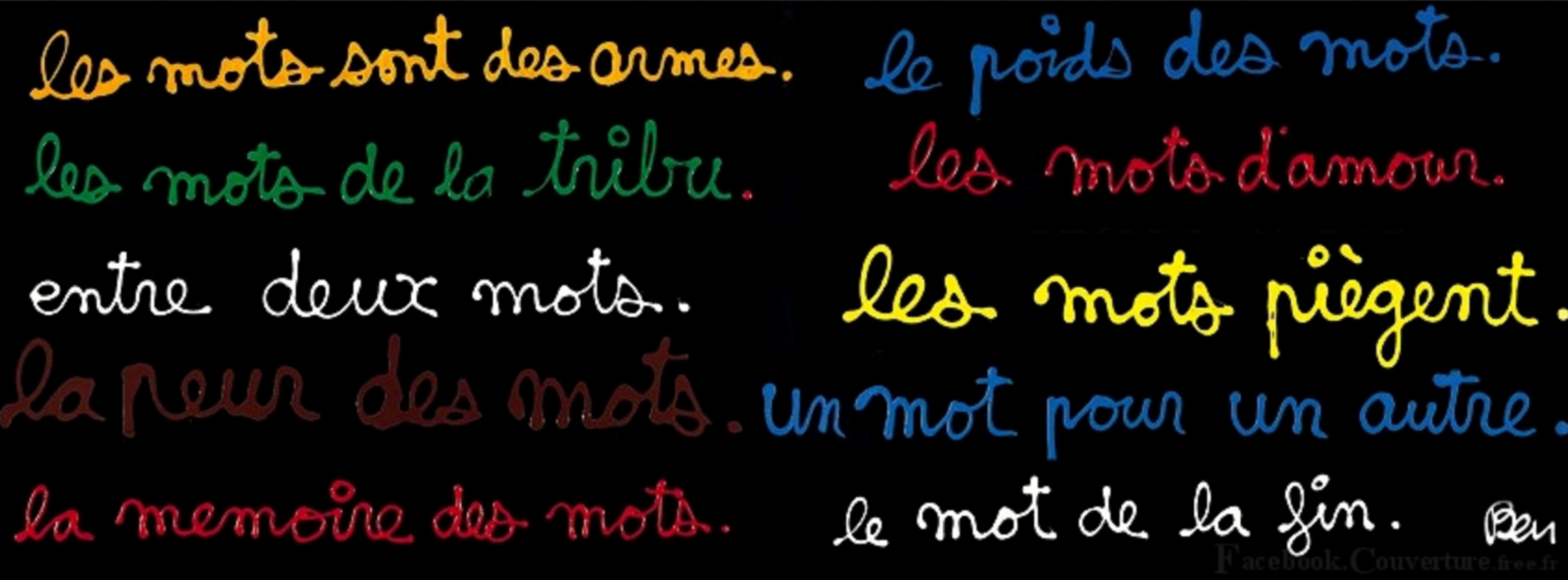
Les téléspectateurs devaient le découvrir à nouveau, mercredi 9 mai [1990], en regardant M. Jean-Marie Le Pen à « L’heure de vérité » : le Front national a son propre langage. Les talents personnels de tribun polémiste et d’orateur populiste du président du Front ne sont pas l’unique clé de l’efficacité persuasive du message de l’extrême droite. En amont, celui-ci est soigneusement élaboré et peaufiné par les dirigeants du mouvement comme l’illustre un texte récent de l’Institut de formation nationale du Front sur l’« image » de ce dernier.
« Créer notre propre vocabulaire », résume l’un des intertitres de ce document. Pour mieux travailler au corps l’imaginaire social, le Front national a choisi d’inventer ses mots. « Du choix des mots utilisés dépend l’efficacité du discours politique mais aussi l’image qu’on en donne », lit-on dans ce texte destiné aux cadres du mouvement qui recommande de « ne pas utiliser le vocabulaire de l’adversaire » ni des « termes » qui le « valorisent » : « Deux types de mots sont à proscrire : les mots appartenant à l’idéologie marxiste, les mots appartenant à l’idéologie des droits de l’homme. »
Les mots interdits devront être remplacés par des mots « à s’approprier » : « Aux mots confisqués par l’adversaire et qui sont devenus autant de symboles, soit du bien (“les travailleurs”), soit du mal (“les patrons”), il faut substituer un autre vocabulaire. » Suit, en deux colonnes, une liste de mots à remplacer par d’autres. Ainsi, un militant ou un dirigeant du Front national ne dira pas « les masses » mais « les peuples », pas « les classes » mais « les catégories socioprofessionnelles, les Français actifs, qui travaillent », pas « les luttes » mais « le combat », pas « le sens de l’histoire » mais « les aléas de l’histoire », pas « les patrons » mais « les employeurs », pas « les possédants » mais « les propriétaires », pas « les mouvements de libération » mais « les mouvements terroristes ».
Une seconde liste donne des exemples de mots à « utiliser pour des raisons tactiques » : « les hommes politiques » deviendront « les politiciens, la nomenklatura politicienne », « le PS, le PC, le RPR et l’UDF » seront désignés sous le label unique de « l’établissement » (le Front refusant « l’establishment », anglicisme qui renforce « le pouvoir attractif de l’American way of life sur la culture européenne »), « les communistes français » seront « les derniers staliniens », « les milieux pro-immigrationnistes » auront droit au qualificatif infamant de « parti de l’étranger », enfin « SOS-Racisme, LICRA, MRAP, etc. » seront tout simplement nommés « les lobbies de l’immigration ».
« Aucun mot n’est innocent », conclut ce texte qui doit beaucoup à l’apport des dirigeants du Club de l’Horloge ralliés à M. Le Pen après avoir eu la même démarche auprès du RPR. « On peut même dire que les mots sont des armes, parce que derrière chaque mot se cache un arrière-plan idéologique et politique. »
Cette portée symbolique du vocabulaire est soulignée par une troisième liste destinée à illustrer la philosophie de l’extrême droite. Ainsi le terme « individualisme » est-il « à bannir » parce que « synonyme d’égoïsme ». À l’individu, cet « homme dépersonnalisé, déshumanisé », le Front national oppose « l’homme enraciné, héritier d’un lignage et d’une culture ». De même l’« universalisme » sera-t-il remplacé par le « cosmopolitisme » ou le « mondialisme », l’« égalitarisme » par le « nivellement », l’« administration » par la « bureaucratie », « les droits de l’homme » par « les droits et les devoirs du citoyen », et la « société » par la « communauté ».
Aucune ambiguïté donc dans ces recommandations tant il est vrai, en effet, que les mots ne sont pas innocents.



