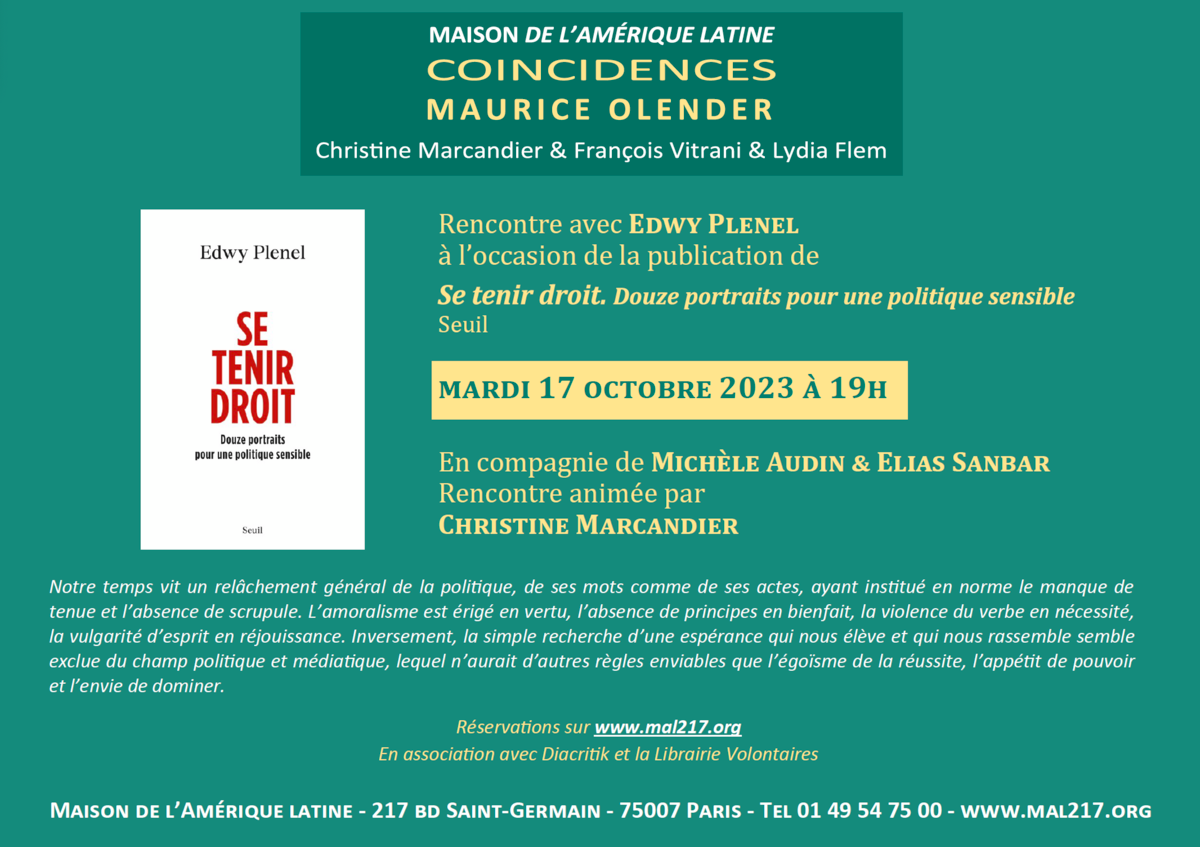
Agrandissement : Illustration 1
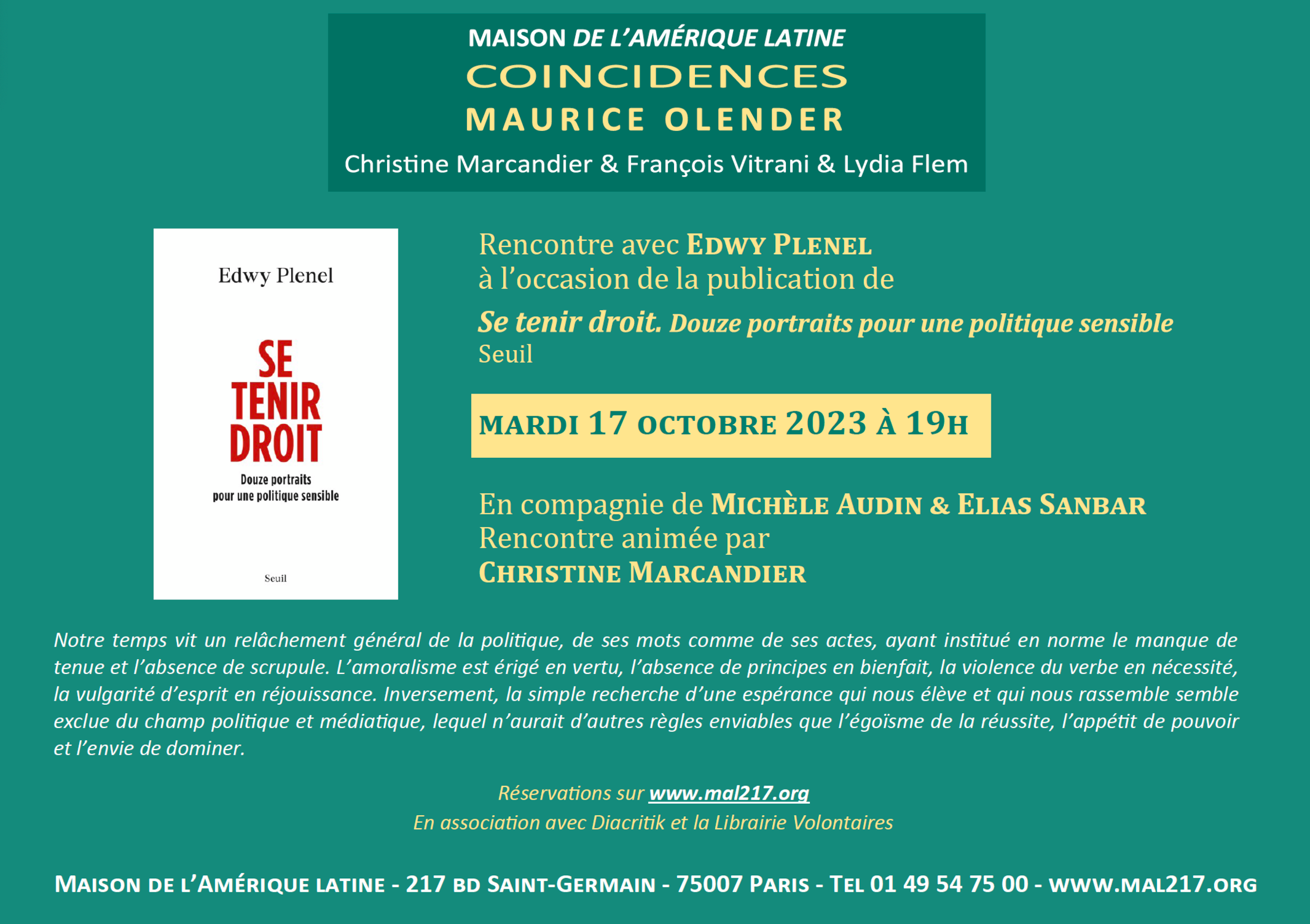
Seuls les poètes savent admirer. C’est à l’enseigne de cette confidence d’Édouard Glissant à propos d’Antonio Tabucchi que j’ai souhaité réunir plusieurs exercices d’admiration suscités par le hasard ou l’amitié, les sollicitations des éditeurs ou l’adieu à des êtres chers[1].
Échelonnés sur trois décennies, ils sont au nombre de douze, comme les apôtres chrétiens, intrus compris puisque Joseph Fouché, avec un portrait en clair-obscur qui nuance sa légende noire, y fait figure de Judas[2]. Le révolutionnaire régicide converti à la haute police y côtoie des personnages de parcours variés et d’époques diverses qui ont en commun d’avoir balisé les routes de l’émancipation, tout en luttant et pensant à contre-courant. Dans l’ordre d’apparition : Édouard Glissant, François Maspero, Daniel Bensaïd, Jean-Luc Einaudi, Charles Péguy, Émile Zola, Léon Trotsky, Joseph Fouché, Roberto Scarpinato et Jean de La Fontaine. Deux femmes en ouvrent et en ferment la marche : Rosa Luxemburg et Lisa Fittko qui y chemine en compagnie de Walter Benjamin.
L’occasion ayant fait le larron, au gré des circonstances, cet inventaire ne dit pas tout de mes fidélités ou de mes curiosités, dont certaines ont fait l’objet d’autres publications[3]. Il y manque, par exemple, deux libertaires qui me sont chers, le critique d’art Félix Fénéon et le géographe écologiste Élisée Reclus. Des lieux aussi dont le souvenir, intact depuis ma jeunesse, m’habite encore, tels Tipasa en Algérie ou Sainte-Anne en Martinique, ou dont la magie m’est devenue, à l’âge adulte, un refuge bienfaiteur, tel l’île-volcan Stromboli. Surtout, sauf dans mon évocation de Charles Péguy, le journalisme y fait figure de grand absent alors qu’il m’occupe quotidiennement depuis un demi-siècle.
Ce paradoxe n’est qu’apparent : ces écrits d’hier, qui s’entêtent à convoquer le présent du passé, laissent entrevoir l’arrière-pensée de mon engagement professionnel, aujourd’hui même. Son ressort, sinon secret, du moins caché. Échappant à la chronologie de leur rédaction, l’ordonnancement que j’ai choisi pour ces douze portraits dessine une carte du tendre où peut se lire un parcours personnel, mêlant biographie, amitié et engagement. Loin des légendes noires, anecdotiques ou mensongères, qu’ont inventé et répandu les pouvoirs et les intérêts que dérange mon itinéraire de journaliste inclassable, ces textes me semblent plus bavards et plus éclairants qu’une confession intime, tant ils en livrent les clés, faisant entendre d’insistants refrains.
Les collationnant, j’ai été surpris par leur unité, ces constances qui les traversent et ces résonances qui les rapprochent. Et j’y ai découvert ce parti pris dont je n’avais pas forcément conscience : un plaidoyer pour une politique sensible.
Des résistances anticolonialistes face aux impérialismes à l’opposition de gauche au stalinisme, du sursaut éthique que signifia le dreyfusisme au combat sans cesse recommencé contre les ennemis de l’égalité, des libertins échappant en secret à l’absolutisme monarchique aux magistrats dressés contre l’hydre mafieuse, des révoltes sociales contre la loi de la marchandise aux épopées héroïques des luttes antifascistes, cette galerie de portraits introduit à une politique rétive aux appareils idéologiques ou étatiques. Résolument indocile, elle est à rebours de leurs pensées froides et de leurs obéissances aveugles, de leurs verticalismes et de leurs autoritarismes, de leurs conformismes et de leurs suivismes.
C’est une politique de l’attention et de la précaution, revendiquant l’écoute et la bienveillance sans craindre d’en être paralysée ou d’en devenir impuissante. Une politique d’éthique et de principe, qui ne redoute pas l’exigence morale. Une politique, en somme, du scrupule : du latin scrupulus, le mot nous vient de cette petite pierre pointue qui, glissée dans une sandale, gêne la marche, obligeant à ralentir ou à s’arrêter. Une politique du petit caillou ou du grain de sable, résolue à entraver les machineries des dominations et les fatalités des oppressions.
Énoncée au temps de ma jeunesse, l’une de ses formulations ne m’a jamais quitté. Contrairement à ce que voudraient faire croire les contemporaines caricatures conservatrices des soulèvements et surgissements des années 1960 et 1970, cette époque fut en effet traversée par cette exigence d’une politique sensible, en ce qu’elle interroge ses conséquences et questionne ses responsabilités. Un texte oublié en apporte la preuve dont le mathématicien Laurent Schwartz fut l’initiateur, lequel ne renia jamais ses engagements trotskystes au sein d’une gauche rebelle. Publié en 1973 sous la forme d’un appel collectif, il entendait rappeler « des évidences morales et politiques fondamentales »[4].
Le premier de ces rappels – le plus essentiel sous tout régime, en toutes circonstances et quelle que soit l’époque – énonçait ceci : « Il n’y a pas de problème de la fin et des moyens. Les moyens font partie intégrante de la fin. Il en résulte que tout moyen qui ne s’orienterait pas en fonction de la fin recherchée doit être récusé au nom de la morale politique la plus élémentaire. Si nous voulons changer le monde, c’est aussi, et peut-être d’abord, par souci de moralité. Il n’est pas de stratégie rationnelle, voire scientifique, qui ne doive être soumise à la morale adoptée. Si nous condamnons certains procédés politiques, ce n’est pas seulement, ou pas toujours, parce qu’ils sont inefficaces (ils peuvent être efficaces à court terme), mais parce qu’ils sont immoraux et dégradants, et qu’ils compromettent la société de l’avenir. »
Dans le contexte de sa publication, celui du communisme soviétique inébranlé, des éphémères modes maoïstes et des dictatures nées des émancipations coloniales, ce texte interpellait en priorité les gauches – interpellation qui les concerne toujours, ô combien. Mais il portait au-delà, pertinent jusqu’à nos jours face à bien d’autres expressions partisanes par sa défense radicale d’un engagement rétif à l’attrait du pouvoir, à ses pièges et à ses mensonges. Ce message n’est en rien une dérobade face aux responsabilités, à la nécessité parfois d’en prendre et aux défis que cet engagement implique avec les contraintes et les malentendus qui en découlent. Mais c’est l’affirmation que cette nécessité ne saurait aliéner durablement nos libertés et que, pour en préserver l’exercice avec toutes ses potentialités, il importe de cultiver une intranquillité foncière. Ne jamais se croire arrivé, ne pas se ranger, ne pas se rendre. Ce que résume cette phrase dont j’ai fait mon mantra personnel : l’inquiétude est l’antichambre de l’espérance.
« Quelle que soit la partie du monde où il se trouve, le camp où il est engagé, poursuivaient ainsi les signataires de 1973, dire la vérité – dire à tout le moins ce qu’il croit humblement être la vérité – est la tâche première de l’intellectuel. Il doit faire cela sans orgueil messianique, indépendamment de tous les pouvoirs et, au besoin, contre eux, quel que soit le nom qu’ils se donnent – indépendamment des modes, des conformismes, des démagogies. Il n’y a pas de moment où l’intellectuel soit justifié de passer de la critique à l’apologétique. Il n’y a pas de César individuel ou collectif qui mérite l’adhésion de tous. L’idéal d’une société juste n’est pas celui d’une société sans conflit – il n’y a pas de fin de l’histoire – mais d’une société où ceux qui contestent peuvent, à leur tour, quand ils viennent au pouvoir, être contestés ; d’une société où la critique soit libre et souveraine, et l’apologétique inutile. »
Les affinités que ce livre donne à voir campent sur cette position radicalement démocratique, à laquelle je crois m’être efforcé de rester fidèle, dans mon parcours professionnel comme dans mes engagements personnels. En dehors et à l’écart, toujours en échappée, foncièrement insaisissable, elle n’est pas commode à tenir tant elle paraît dangereuse aux pouvoirs en place, qu’ils soient politiques, économiques ou médiatiques. Refuser de se laisser assigner à résidence en défendant farouchement son indépendance, c’est se condamner à subir les détestations récurrentes des installés à demeure, puissants du moment ou aspirants à le devenir.
Face à cette adversité, les compagnonnages qui font la matière de ce livre me furent autant de consolations.
*
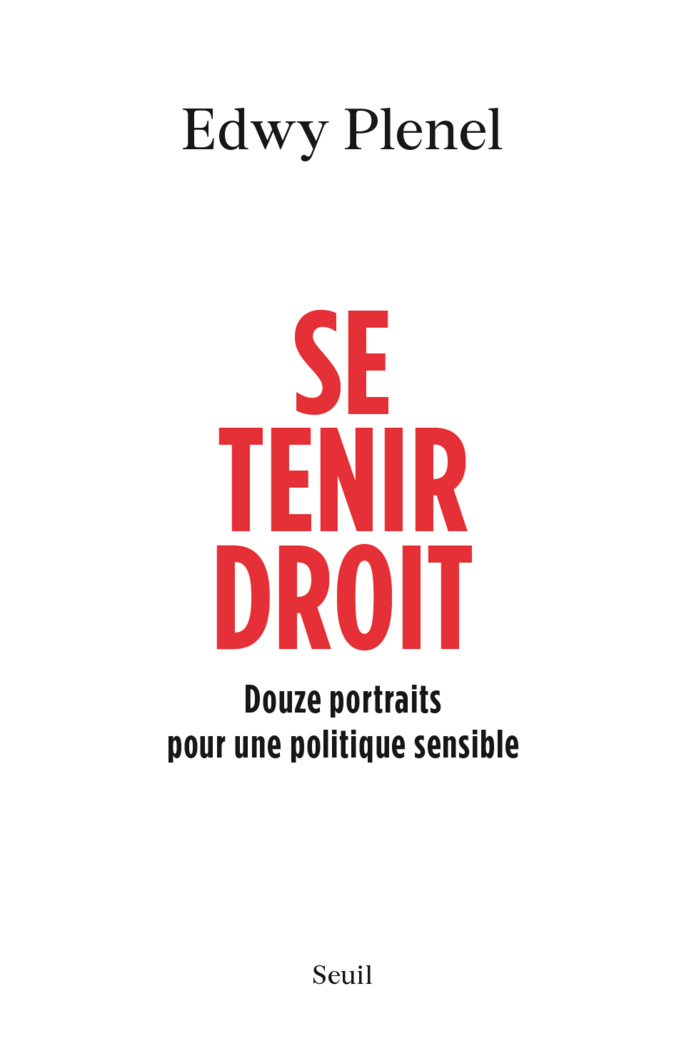
Agrandissement : Illustration 2
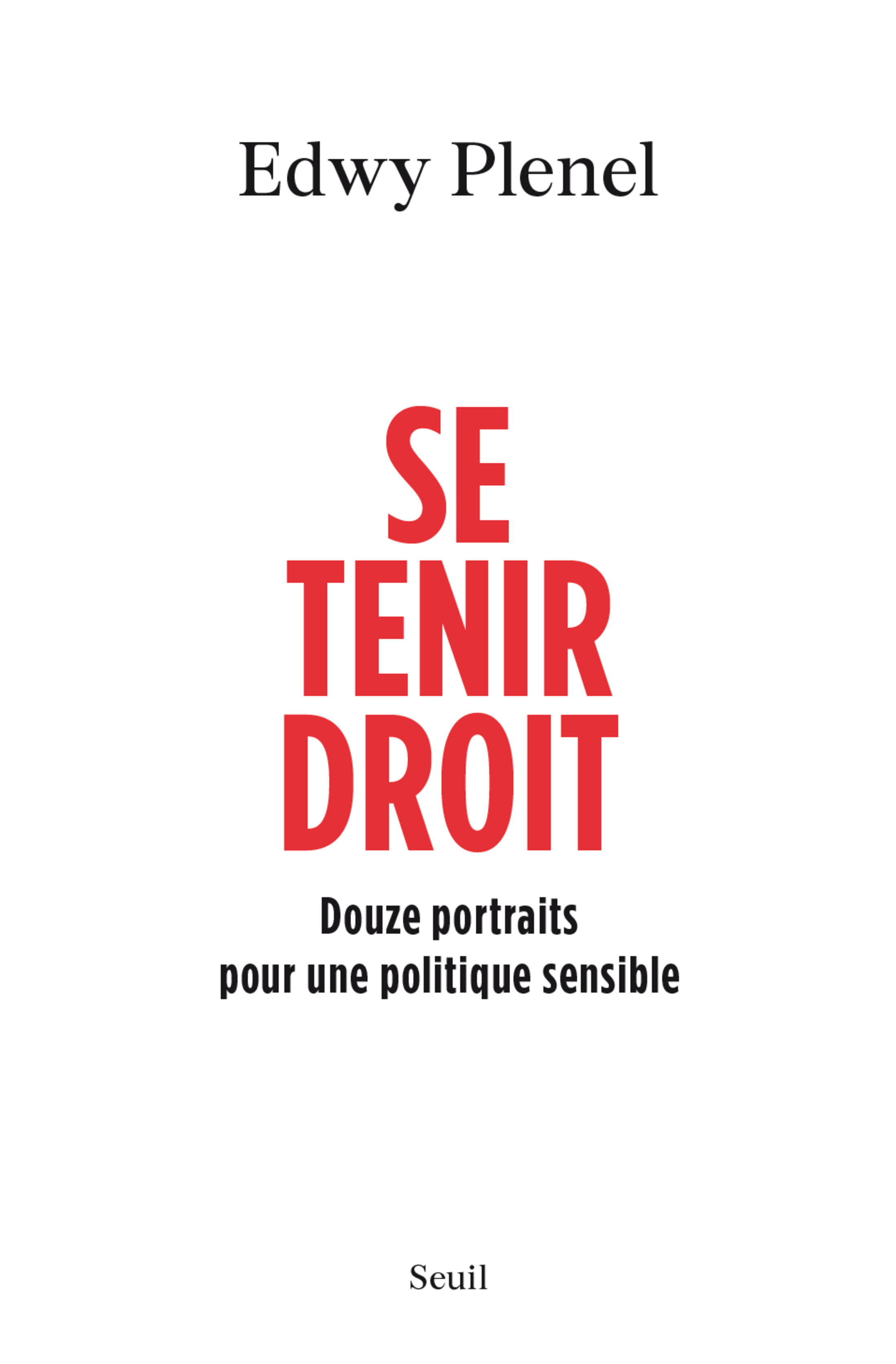
Notes
[1] Cf. « À propos d’Antonio Tabucchi », dans Édouard Glissant, La cohée du Lamentin. Poétique V, Paris, Gallimard, 2005.
[2] Construite par les Évangiles, la sombre légende de la traîtrise de Judas a nourri l’antijudaïsme chrétien qui fut, en Europe, le terreau de l’antisémitisme moderne.
[3] J’ai consacré au cinéma de Costa-Gavras un essai, dans lequel je partage aussi mon admiration pour le théâtre de Michel Vinaver (cf. Edwy Plenel, Tous les films sont politiques, Paris, Seuil, « Points », 2021). Et j’ai rendu hommage aux figures, célèbres ou méconnues, des luttes sociales et ouvrières dans Voyage en terres d’espoir, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2016.
[4] Sous l’intitulé « Il n’y a pas de problème de la fin et des moyens », ce texte fut publié dans Le Monde du 4 juillet 1973. Parmi ses nombreux signataires, outre son initiateur Laurent Schwartz, on relève les noms de Lucien Bianco, Jean Cassou, Georges Duby, Marc Ferro, Roger Godement, Charles Malamoud, Juliette Mince, Edgar Morin, Michelle Perrot, Maxime Rodinson, Claude Roy, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet.



