Depuis la Caraïbe, cet archipel qui fut le lieu de bascule dans notre modernité d’un monde en relation, à la fois fini, commun et marchand, pour le meilleur et pour le pire, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau n’ont cessé d’inventer une poétique de la politique. Une politique qui soit d’horizon et d’échappée, plutôt que d’assignation et de repli. Une politique d’élévation et d’émancipation qui se refuse aux langues mortes du pouvoir et de la puissance. Une politique où l’égalité n’est plus l’alibi de l’uniformité. Une politique du divers et du pluriel.
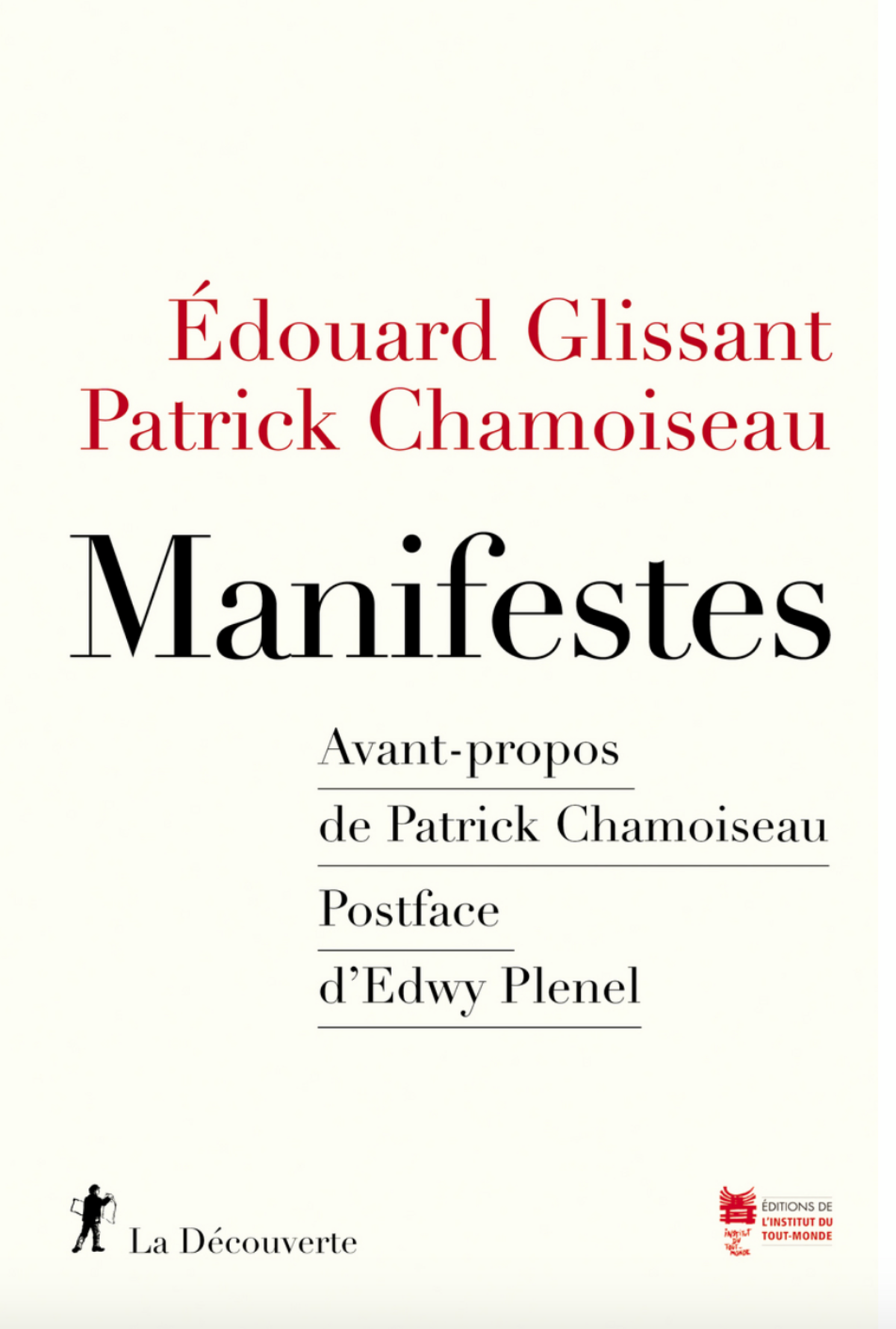
Agrandissement : Illustration 1
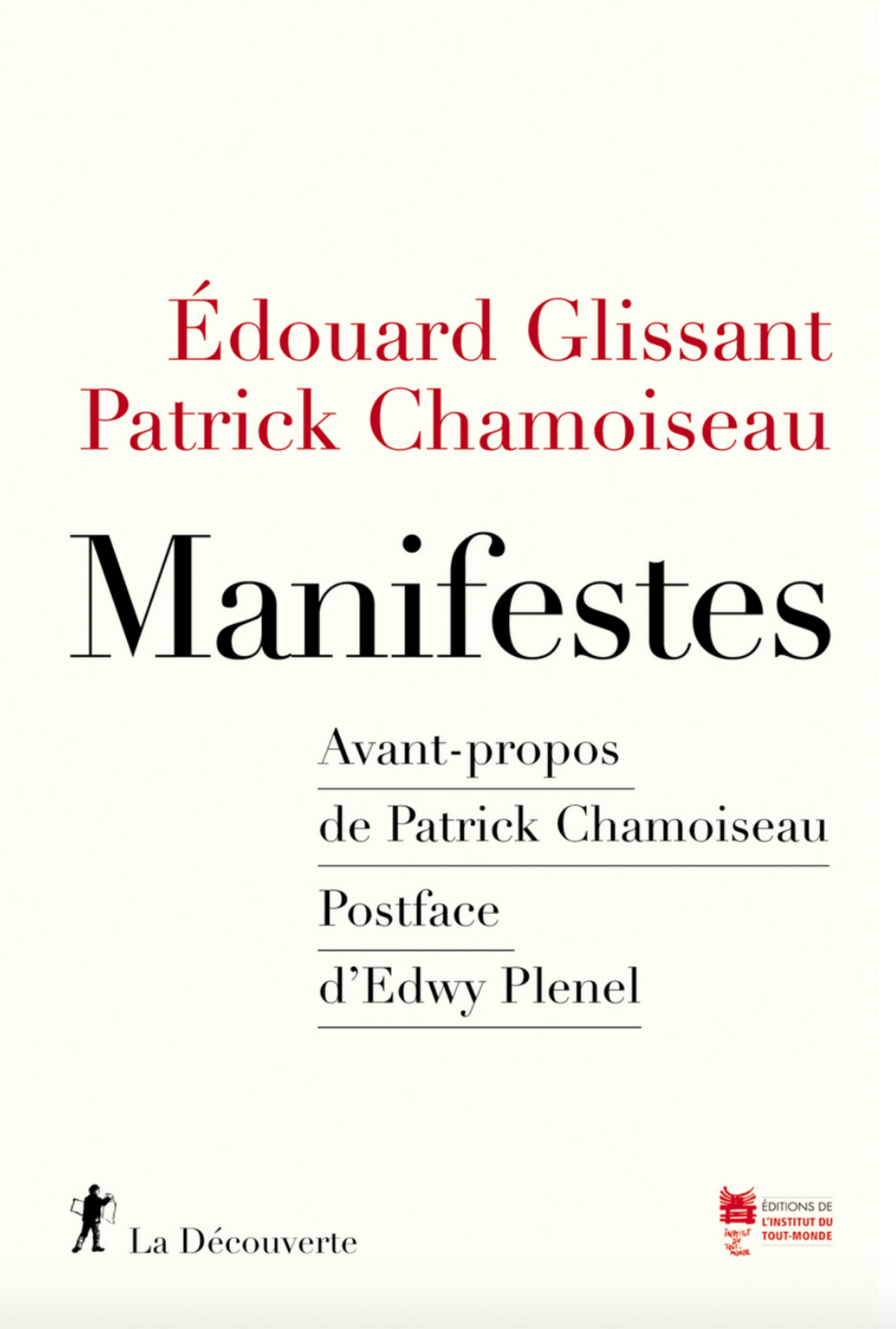
Aujourd’hui réédités à l’enseigne de l’Institut du Tout-Monde qu’avait fondé Édouard Glissant avant de disparaître en 2011, ces quatre Manifestes et les deux tribunes qui les accompagnent en portent témoignage. Écrits pour deux d’entre eux avec le secours d’une fraternelle amicale, ils frayent dans une joyeuse complicité littéraire un chemin de liberté. Voyant plus loin que le présent qui les a justifiés, ils fondent l’imaginaire qui nous manque, en affrontant les défis qui sont devant nous, qu’ils soient démocratiques, sociaux et écologiques, guerriers ou identitaires.
Le premier, en 2000, inventait une refondation des outre-mers français qui ne prolonge ni ne copie les dominations qu’ils ont subies. Le deuxième, en 2007, fut l’appel inaugural au sursaut face à la renaissance, en France, d’une nécrose de l’identité nationale en étendard des haines et des peurs. Le troisième, en 2009, était une adresse à Barack Obama qui, au-delà de son élection à la présidence américaine, définit une politique de hauteur dans la prise de conscience que l’humanité court, de nouveau, à la barbarie. Le quatrième enfin, en 2009 encore, faisant écho à un mouvement social aux Antilles, imaginait une économie écologique, dont la haute nécessité saurait échapper aux mirages de la consommation.
Associant indissolublement le Tout-Monde et le Tout-Vivant, la relation des humains entre eux et celle des humains à la nature, ces quatre textes fondent un humanisme radical, tissé d’empathie, de fragilité et de précaution, tout en restant intraitables face aux injustices et à l’indifférence qui les légitime. Une politique, en somme, de la beauté et de la bonté. Réactions immédiates à deux événements – le vote en 2005 d’une loi indigne vantant le « bilan positif » des colonisations ; les dévastations en 2007 provoquées par le cyclone Dean –, les deux tribunes qui les complètent illustrent ce souci entêté de l’échange et du partage, hérité de « cette interminable doubleur » portée par « une vieille terre d’esclavage, de colonisation, et de néocolonisation ». Un « maître précieux » n’hésitent pas à écrire Chamoiseau et Glissant, à rebours du ressentiment qui macère ou de la plainte qui paralyse : « Les situations déshumanisantes ont ceci de précieux qu’elles préservent, au cœur des dominés, la palpitation d’où monte toujours une exigence de dignité. Notre terre en est des plus avides. »
Ici, la langue est révolution, en ce sens qu’elle renverse, bouscule et déplace, brise des carcans tout en ouvrant des possibles. « Le poète lève, il soulève avec lui le monde », a ainsi écrit Édouard Glissant à propos de leur compatriote, grand frère et illustre prédécesseur, Aimé Césaire, dont l’engagement politique s’affirma d’abord par une rupture poétique. Hommage à « cette énorme Annonciation » que fut le surgissement du Cahier d’un retour au pays natal (1939), ce texte de Glissant repris dans La Cohée du Lamentin (2005) s’intitule simplement « La Poésie ».
« La poésie ne produit pas de l’universel », y ajoute-t-il, tant il tenait en méfiance ce mot figé qui fut et reste l’alibi des dominations s’en prétendant propriétaires, lui préférant pour sa part l’universalisable, ce mouvement infini de la relation, ces rencontres et ces partages où se croisent, s’imbriquent et se mêlent le commun et le divers. « Non, poursuivait Glissant, la poésie enfante des bouleversements qui nous changent. »
Il en est ainsi de ces textes qui n’ont rien perdu de leur intensité ni de leur actualité. Aussi politiques soient-ils, par leur objet comme par leur propos, ces Manifestes sont essentiellement poétiques. Rien à voir cependant avec la figure, galvaudée et malmenée au point d’en devenir parfois malheureuse, du poète (ou de l’artiste) engagé. L’écriture entremêlée de Glissant et Chamoiseau ne campe pas dans la posture du poète-résistant, requis pas une cause qui risque de devenir son piège, entre assignation et réduction, comme ont pu le vivre, dans des contextes différents, le René Char des maquis français ou le Mahmoud Darwich des camps palestiniens.
Dans l’un de ses Entretiens de Baton Rouge (2008), Édouard Glissant rappelait d’ailleurs son originelle réticence, dès sa jeunesse, alors même qu’il était pleinement engagé dans les combats de la décolonisation et du tiers-monde, à ce que l’écriture ait « pour fonction de précipiter le politique ». « Il me semblait, y explique-t-il, que si l’on consacrait l’écriture au seul parachèvement d’une lutte populaire, de la lutte d’une communauté ou d’une nation, si, dans le travail d’écriture, on oubliait ce qu’il y a derrière les luttes, c’est-à-dire les assises les plus discrètes d’une culture, les opacités de l’être, les tremblements du savoir, on n’accomplissait pas le travail de l’écrivain, mais celui, nécessaire tout autant, du pamphlétaire ou du journaliste engagé ou du militant pressé d’obtenir des résultats. »
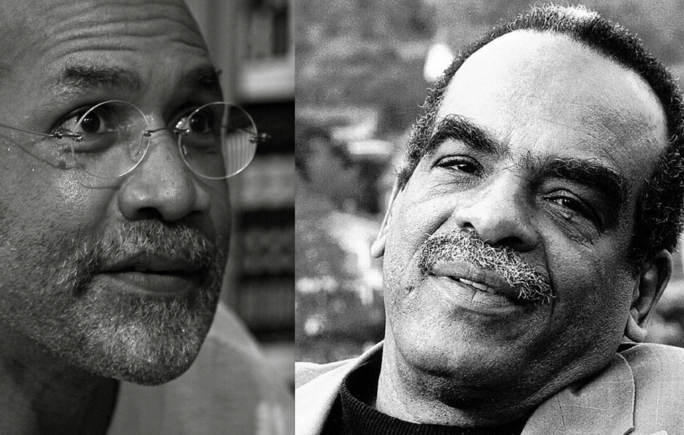
Agrandissement : Illustration 2
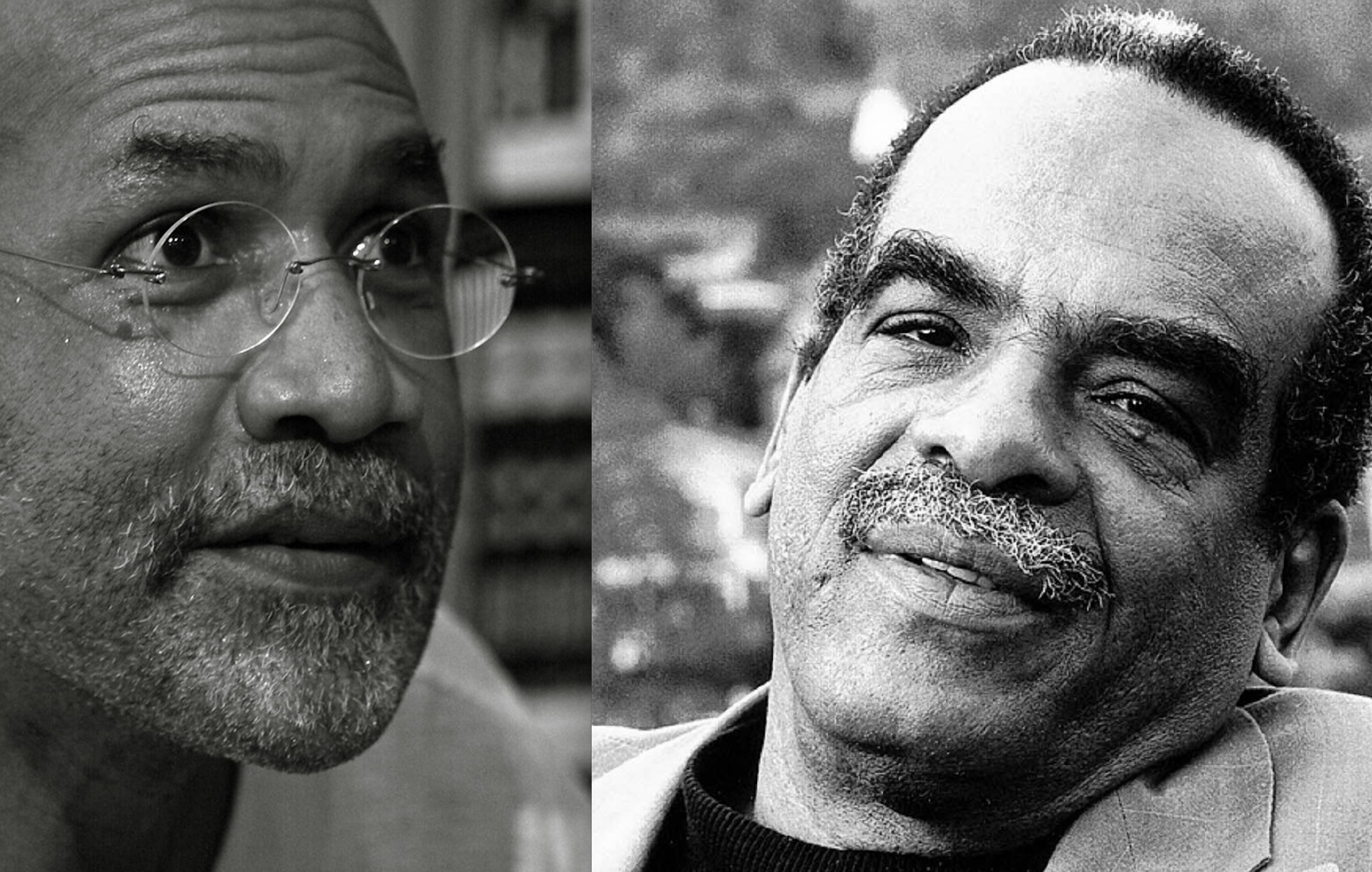
En évitant ce piège, où la poésie s’assèche et la politique s’appauvrit, Glissant et Chamoiseau ont ouvert une voie nouvelle qui réenchante l’espérance, l’armant de lucidité sans renoncer à sa radicalité. Cette invention passe par une subversion de la langue dont l’art puissant provient d’une longue durée de résistance du faible au fort, cette patiente impatience enfantée par le crime esclavagiste. Déportés à fond de cale du navire négrier puis projetés dans le système totalitaire de la plantation, devenus des marchandises dont la valeur n’excédait pas l’éphémère rentabilité, les esclaves ont troué cette nuit infernale en forgeant un discours à nul autre pareil.
En arrière-fond de ces Manifestes, il y a tout cet imaginaire de mots et de sons, de gestes et de sens, de représentations, de sensibilités, de précautions et de sagesses, de tenue et de retenue, d’humour et de distance, de générosités et de curiosités, de haute et simple humanité, tout cet univers sans fin ni limite que Glissant nommait « créolisation ». Une créolisation qui, loin de se réduire à son premier véhicule, la langue créole, transporte son monde de résonances et de raisonnements, de déplacements et de discordances, au cœur d’autres langues, ici le français. Nul hasard évidemment si son maître-livre, sorte de laboratoire et d’atelier de son œuvre, s’intitule Le Discours antillais (1981). Un discours précisément, entre paroles qui se meuvent, pensées qui se forment et propositions qui s’énoncent.
« Toute poétique implique une politique globale », peut-on y lire, recommandation que prolongera à son tour Chamoiseau avec Écrire en pays dominé (1997). « Ces poétiques, poursuit Glissant, sont inséparables du devenir des peuples, de leur loisir de prendre part et d’imaginer ». Dès lors, le discours sera celui du conteur, plutôt que du professeur. Rien qui ne s’assène d’en haut, d’un surplomb, d’une tribune ou d’une chaire. La parole est partage et échange, tissée d’expériences communes et de résonances complices, mettant en rapport et en relation, mieux même : née de ces rapports et relations. « La langue créole, écrit encore Glissant dans Le Discours antillais, est littéralement une conséquence de la mise en rapport de cultures différentes et n’a pas préexisté à ces rapports. Ce n’est pas une langue de l’Être, c’est une langue du Relaté. »
Aussi ne faut-il pas hésiter à lire à voix haute ces Manifestes, à les dire et à les réciter, de préférence à plusieurs – c’est d’ailleurs ainsi qu’ils ont continué à faire chemin, notamment à l’initiative complice de Greg Germain qui leur a souvent prêté sa voix. Ils sont même faits pour cela, être dits autant que lus, concrétisation d’une des promesses que s’était faite Glissant depuis son atelier d’écriture : « Défaire l’écriture de son mandat de souveraineté par rapport à l’oralité » (Le Discours antillais, toujours). Il ajoutait cette précision qui rejoint ce que nous ressentons, en les lisant ou en les écoutant : « Pour nous, l’élément formellement déterminant dans la production littéraire, c’est ce que j’appellerais la parole du paysage. » Où l’on retrouve cette sensation de ne pas seulement rencontrer des mots avec leurs lettres, leurs voyelles et leurs consonnes, mais de découvrir une réalité physique qui ne nous est pas inconnue, où la pensée se faufile comme une intuition, une sorte d’évidence sensible.
« An neg sé en sièc. » Autrement dit, du créole au français : un nègre, c’est un siècle. Placé par Édouard Glissant en exergue de son Discours antillais, ce proverbe martiniquais dit l’infinie longue durée charriée par la grande humanité issue du chaudron caraïbe, ce laboratoire de la créolisation du monde. Juste au-dessus, il avait posé une autre citation, attribuée à Charles de Gaulle, à l’occasion d’un voyage en Martinique : « Entre l’Europe et l’Amérique, je ne vois que des poussières. » On imagine les yeux rieurs du poète devant cette trouvaille, ce rapprochement aussi ironique qu’implacable. Les puissants ne sont forts qu’en apparence, tant ils sont faibles parce qu’aveugles : ils n’imaginent pas ces fragilités devenues des forces, ces îles s’imaginant en univers, ces poussières réinventant l’entièreté du monde.
C’est pourtant bien là, dans cette courbe d’archipels où s’inaugura la projection exploratrice et dominatrice de notre Occident européen autour de la Terre, qu’ont été tracées les voies d’une renaissance libératrice, délivrée des pensées de système qui forgent les oppressions et des systèmes de pensée qui fabriquent les soumissions. Oui, là, entre esclavage et marronnage, souffrance et résistance, violence de la traite et invention de la liberté. De ces échappées belles et prometteuses, ces Manifestes ne se contentent pas de témoigner pour le passé, ils en annoncent le futur : ce siècle à venir, par-delà nos provisoires défaites et nos déceptions momentanées.
> Manifestes d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. La Découverte / Éditions de l'Institut du Tout-Monde, 2021, 120 pages. 12 €.
> L'émission quotidienne de Mediapart À l'air libre a été consacrée à ces Manifestes le 10 février 2021, avec Patrick Chamoiseau et Sylvie Glissant :



