Paon, martin-pêcheur, perruche... Pourquoi ce déluge de couleurs chez certains volatiles ? Dans son essai Une pluie d’oiseaux, Marielle Macé s’interroge en particulier sur le bleu qui nous émerveille lorsqu’il colore un plumage. Comment expliquer ce surplus de beauté ? La chercheuse écrit :
Et je pense à Bleuets, ce récit où Maggie Nelson raconte la manière dont elle est tombée amoureuse d’une couleur, dont la couleur a pris “un tour personnel”. Elle parle du bleu comme d’un remède, sans nommer sa maladie (Wittgenstein aussi écrivit ses Remarques sur les couleurs dans les dix-huit mois qui lui restaient à vivre) [1].
Tiens donc. Se trouver au seuil de la mort et s’abîmer dans la contemplation des couleurs, j’avais déjà lu cela quelque part : sous la plume de Toni Morrison, dans le roman Beloved. Dans ce récit, Baby Suggs est une vénérable matriarche dont la vie d’esclave a été marquée au fer rouge de l’horreur. Son fils, esclave lui aussi, a jadis passé un accord avec leur propriétaire : pour affranchir sa mère, il a travaillé tous les dimanches pendant des années, sacrifiant ainsi son peu de temps de repos. Baby Suggs découvre ainsi la liberté dans sa soixantaine et c’est peu dire qu’elle ne s’attendait pas à un tel bouleversement. Pour la première fois, elle sent les battements de son cœur, qu’elle reconnaît comme le sien. Pour la première fois aussi, elle voit les couleurs.
Son passé avait été semblable à son présent -intolérable-, et comme elle n’ignorait pas que la mort était tout sauf l’oubli, elle utilisait le peu d’énergie qui lui restait pour méditer sur les couleurs[2].
On pourrait s’attarder longtemps sur la profondeur de ces mots – la mort est tout sauf l’oubli – mais c’est un tout autre sujet, alors poursuivons :
Baby avait la moelle fatiguée, et le fait qu’il lui avait fallu huit ans pour trouver enfin la couleur dont elle avait soif témoignait du grand cœur qui l’animait.
Avoir soif d’une couleur : synesthésie mystérieuse qui n’est pas sans rappeler les correspondances baudelairiennes où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent[3] ». La couleur serait ainsi l’objet d’une quête acharnée aux résonances alchimiques. Enfin :
Maintenant je sais pourquoi Baby Suggs a réfléchi à des couleurs, les dernières années de sa vie. Elle n'avait jamais eu le temps de les voir, moins encore d’en profiter, avant.
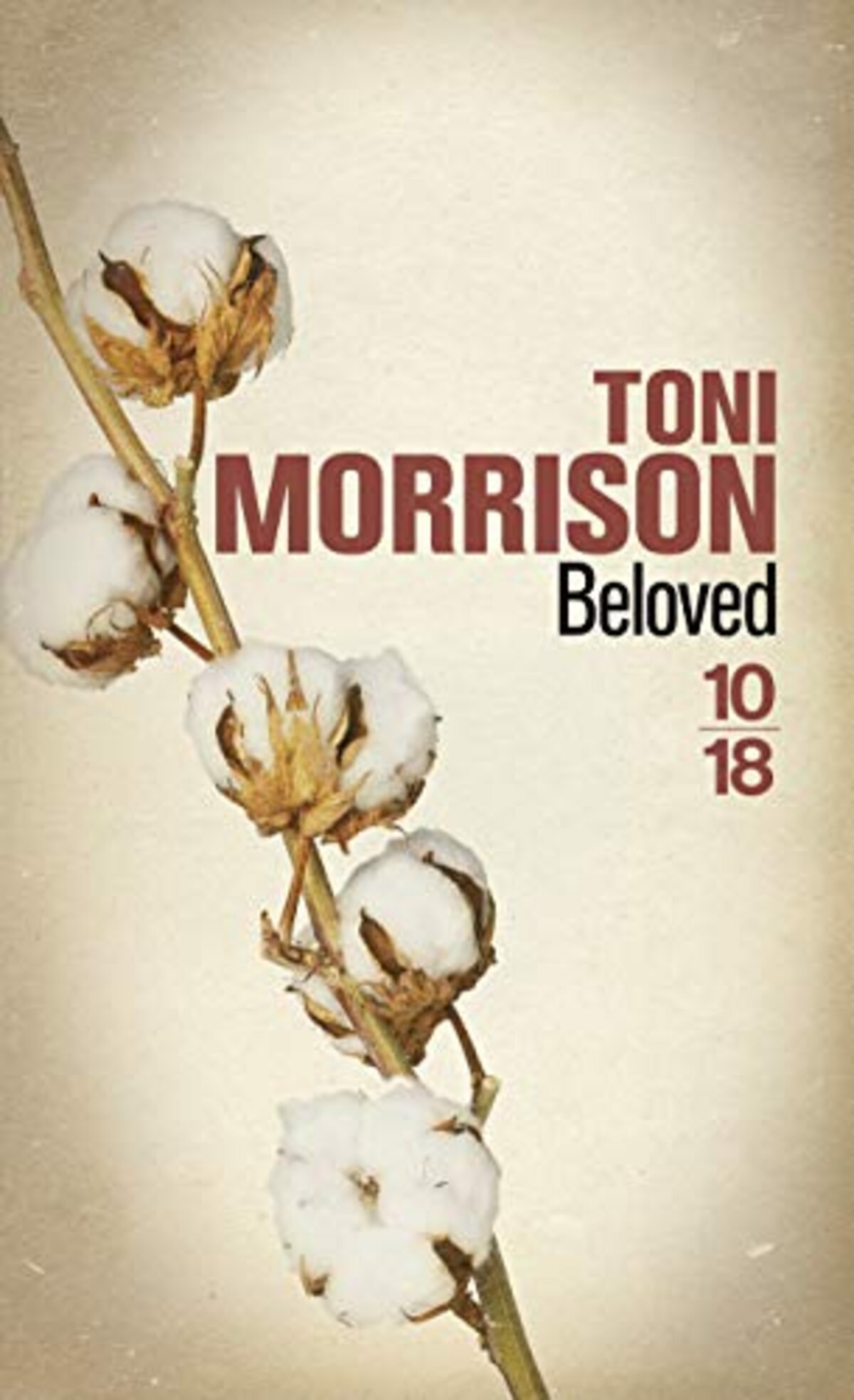
On se doute bien que la notion de couleur a, dans ce texte, des résonnances particulières. Esclave, la vision de Baby Suggs était faite de noir et de blanc. Voir les couleurs constitue le privilège de qui est libre. Mais il ne s’agit pas seulement de les voir, encore faut-il les regarder. Singulier point commun donc de Maggie Nelson, Wittgenstein et Baby Suggs : l’imminence de leur mort les a amenés à une méditation sur les couleurs.
Pourquoi ? De quels secrets les couleurs peuvent-elles bien être dépositaires ? Michel Pastoureau, historien spécialiste en la matière, rappelle au micro de France Culture que la couleur n’est pas une donnée objective. Nous les percevons chacun et chacune à notre façon. Qui plus est, la chimie, la peinture ou la physique en donnent des définitions différentes[4]. La spécificité de la couleur est donc d’être métamorphe. Elle se décline en nuances.
Et ces nuances nous fascinent. Cela commence très tôt : touches du xylophone, crayons de couleurs, palette de l’arc-en-ciel… Il y a vraiment un trésor au pied, dis ? L’univers des mômes est bigarré. De vieux enfants[5] prolongent cet émerveillement en errant rêveusement devant les pots de peinture des magasins de bricolage. Toute velléité de créer implique un détour par le monde de la couleur. Quant aux nuances, leurs noms sont empreints de poésie : menthe, absinthe ou bouteille pour un vert qui, décidément, donne soif. Les teintes émeraude, rubis ou ambre se parent d’un caractère précieux. Quant au bleu, azur, outremer ou persan, il invite au voyage. La palette des couleurs ouvre un infini de possibilités, comme si elle nous murmurait, tout bas mais avec quel éclat, que nous sommes toutes et tous des créateurs en puissance.
Les enfants ne s’y trompent pas quand ils déballent tous les feutres de la boîte et font valser les capuchons. Bientôt, le dessin déborde de la feuille, macule vêtements et mains de tâches bariolées. Pendant ce temps les adultes râlent parce qu’il faut, paraît-il, ne pas dépasser et surtout, ne pas en mettre de partout. Les gosses, eux, ont d’autres préoccupations. Une question notamment les taraude :
C’est quoi, ta couleur préférée ?
Parce qu’il faut en avoir une ! Singulière obsession, à l’instar de Maggie Nelson, Wittgenstein et Baby Suggs - il y a décidément bien des points communs entre le premier et le dernier âge. Je n’ai jamais su que répondre. Aux couleurs claires, je préfère les teintes sombres, j’y trouve plus de profondeur et de mystère. Le rose me rebute puisqu’il a toujours été la couleur attribuée d’office aux petites filles. À ce sujet, Pastoureau m’a appris que cette convention est récente : elle date de l’après Première Guerre mondiale. Avant cela, la majorité des enfants était vêtue de blanc dans la mesure où les pigments, que l’on ne savait pas encore bien fixer, ne résistaient pas à la lessive. Mieux, jusqu’au XIXe siècle, le rose, en tant que dérivé du rouge, était une couleur considérée comme masculine puisqu’elle symbolisait le sang, la guerre, la passion. Le bleu, marial, était plutôt affaire de femmes. Rose pour les filles, bleu pour les garçons : un cliché vieux d’à peine un siècle ! La symbolique des couleurs change parce que la manière dont nous appréhendons le monde aussi.
Au-delà de leurs significations spécifiques, l’historien rappelle que la fonction première des couleurs est de classer. Grâce à elles, nous ordonnons le monde, nous le rendons intelligible. Rouge : danger. Vert : vous pouvez y aller. C’est particulièrement signifiant dans le domaine de la mode. Pastoureau affirme : « Il ne faut pas croire que nous portons les couleurs que nous aimons[6]. » Nous privilégions l’image que nous renvoyons aux autres plutôt que nos goûts personnels. Les couleurs fonctionnent donc comme des codes. Si on les transgresse, cela peut nous coûter. Ainsi, on réserve souvent la couleur à un détail – rouge à lèvres vif, boucles d’oreille, chaussettes ou cravate fantaisie… Voilà pour la petite touche qui nous assurera un certain style. Mais attention à ne pas en faire trop. Il ne s’agirait pas de passer pour un clown quand même – de détonner.

Agrandissement : Illustration 2

Il existe en Inde, dans la région de l’Uttar Pradesh, une fête dédiée aux couleurs. C’est Holi. Chaque année, on y prépare des bombes d’eau colorée et des sacs de pigments que l’on se jette à la figure. Les rues et les corps s’irisent, c’est splendide. Les couleurs permettent de célébrer le retour du printemps et la fertilité. Elles sont de fait l’emblème joyeux et fantasque de la vie. Nous n’avons pas du tout le même rapport à la couleur en Occident où la gamme du noir au blanc demeure le symbole de la distinction, de l’élégance, de l’esprit de sérieux.

Agrandissement : Illustration 3

C’est ici que l’étymologie de la couleur prend tout son sens. Le mot latin color se rattache au verbe celare qui signifie cacher. La couleur possède une ambiguïté profonde : elle recouvre et rend visible. Elle convoie des codes, charrie des imaginaires en même temps qu’elle peut révéler quelqu’un. Plaire aux autres ou se plaire à soi ? Il paraît que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Rien n’est moins vrai. Parce que rien, dans la couleur n’est figé. C’est son ambivalence intrinsèque qui en fait un prisme intéressant à travers lequel regarder notre société. Les couleurs ne sont pas seulement l’affaire du peintre et de l’enfant : elles sont politiques. Il y en a pour qui le rouge ET le vert sont synonymes de danger, n’est-ce pas ? Le noir aussi, sans oublier les couleurs de l’arc-en-ciel… Pour certain·es, le spectacle des couleurs mélangées a quelque chose d’insoutenable parce qu’il est une célébration de la diversité. Baby Suggs en a fait la découverte : ce n’est que lorsqu’on est libre qu’on peut choisir sa couleur préférée. Une préoccupation qui est tout sauf naïve ou superficielle. C’est cette vision du monde que l’on doit défendre : un monde polychrome, riche de sa diversité, un monde où l’on peut penser et créer. Ce n’est d’ailleurs que dans un tel monde que l’on peut voir s’envoler des oiseaux au plumage chamarré – et s’en émerveiller.
[1] Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, 2023.
[2] Toni Morrison, Beloved, 1989.
[3] Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857.
[4] Se reporter au podcast de La Grande Table des idées du mardi 08 décembre 2015, « Que nous disent les couleurs sur notre société », avec Michel Pastoureau et Arlette Farge : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-2eme-partie/que-nous-disent-les-couleurs-sur-notre-societe-7173190
[5] L’expression est de Claude Ponti, je crois.
[6] « Le bleu, histoire d’un paradoxe », Des goûts et des couleurs avec Michel Pastoureau, France Culture, lundi 23 décembre 2013.



