UN SERPENT ! Vos poils se hérissent. Des spasmes vous parcourent comme si vous aviez été mordu·e et que le venin s’insinuait dans votre sang. UN SERPENT ! Vous déglutissez avec angoisse, votre cœur s’emballe. L’adrénaline, déjà, court dans vos veines. Nul besoin de le voir, son nom seul suffit pour que le poison agisse. Votre raison se paralyse.
D’où vient cette terreur que le serpent sait, mieux que tout autre animal, inspirer ? C’est l’une des phobies les plus communes[1]. En France métropolitaine, on dénombre quatorze espèces de serpents seulement. Parmi elles, dix couleuvres et quatre vipères, seules ces dernières pouvant se montrer dangereuses. Et encore, on compte environ un décès par décennie relatif aux serpents[2] : piètre score n’expliquant pas l’effroi que cette bestiole suscite dans notre imaginaire collectif. On a pu entendre que la peur des serpents était innée. C’est une théorie sans fondement scientifique[3]. De plus, ces reptiles sont pour la plupart paresseux, paraît-il. Ils n’attaquent que lorsqu’ils sont acculés, assure Françoise Serre-Collet, une herpétologue passionnée[4]. Alors ?
Les expressions où ils se faufilent ont la couleur du vice, ainsi de la langue de vipère qui peut faire avaler des couleuvres à sa victime. Il faut dire que les serpents ont mauvaise réputation depuis un sacré bout de temps, tout au moins en Occident.
La mythologie grecque grouille de créatures terrifiantes. À commencer par les Érinyes. Ces divinités chtoniennes, de l’ancienne génération des Dieux, viennent du monde d’en-dessous. Elles sont hideuses : du sang coule de leurs yeux furieux. Des serpents hérissent leurs têtes. Leurs ailes leur font comme une auréole funeste. Pour compléter ce tableau infernal, Eschyle les arme de torches et de fouets. Quand une offense a été commise, elles quittent les Enfers et pourchassent le coupable. Elles sont impitoyables. Pour venger son père Agamemnon, Oreste a tué la criminelle, sa mère Clytemnestre. Il s’est rendu coupable devant les Dieux du plus sacrilège des crimes en versant le sang maternel. Ce n’est pas aux humains de rendre justice pour les crimes odieux. C’est le rôle dévolu aux Érinyes. Dans la tragédie de Racine, c’est un roi qu’Oreste a tué, à la demande d’Hermione dont il est amoureux. Folle de chagrin, celle-ci se tue sur la dépouille de Pyrrhus. Resté seul, Oreste contemple ses crimes. La folie s’empare de lui, il voit Hermione :
Dieux ! quels affreux regards elle jette sur moi !
Quels démons, quels serpents traîne-t-elle après soi ?
Hé bien ! filles d’Enfer, vos mains sont-elles prêtes ?
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes[5] ?
L’allitération en s du dernier vers est demeurée célèbre. C’est tout de même génial : cette première lettre du mot serpent comme une lettrine imitant la forme même de l’animal, ce s sinueux qui serpente et se contorsionne tout en spirales… Fascinant.
Comment ne pas évoquer Méduse ensuite, cette gorgone à la chevelure serpentine que Persée devait tuer pour prouver sa valeur ? Son regard pouvait, paraît-il, vous transformer en pierre.

Chaque époque interprète le mythe de Méduse au prisme des problématiques qui sont les siennes. Et si Méduse est aujourd’hui devenue une icône féministe[6], elle a très, très longtemps été l’archétype de la femme fatale : de celle qui peut tuer. C’est le cas dans le tableau de Klimt. Alliant le danger à l’érotisme, Méduse nous renseigne sur le rapport trouble que les hommes peuvent entretenir avec les figures féminines. On retrouve cette sensualité mêlée de crainte chez Baudelaire :
À te voir marcher en cadence,
Belle d'abandon,
On dirait un serpent qui danse
Au bout d'un bâton[7].
Le serpent s’insinue dans le fantasme sexuel pour en marquer l’aspect inquiétant. L’histoire du jardin d’Éden ne raconte pas autre chose, en réalité. Le serpent siffle à Ève de goûter à la pomme de l’arbre de la connaissance. Il permet au couple de prendre conscience de sa nudité. C’est avec le serpent que commence la sexualité et, partant, le début de l’humanité. Si la tradition en a fait un animal maléfique, sachons lui gré (au serpent) de son rôle de passeur de connaissances. Ève a bien eu raison : on se serait ennuyé ferme au paradis.
Or même lorsqu’il est associé au savoir, le serpent symbolise encore le danger. L’emblème des pharmacies peut être interprété en ce sens. Il représente un caducée[8] autour duquel s’entoure un serpent. Bien des significations s’y rattachent. Les premières sont positives puisque le reptile incarne cette capacité à se régénérer lorsqu’il mue. Son venin peut d’autre part entrer dans la composition de médicaments. Mais le remède, parfois, se transforme en poison. C’est d’ailleurs l’ambivalence du terme grec pharmakon, qui possède cette double signification. Le serpent traîne avec lui cette double polarité : je peux aussi bien soigner que tuer, nous siffle-t-il.
Le serpent nous inciterait donc moins à la tentation qu’à la prudence : il faut user des connaissances avec sagesse. La leçon est somme toute raisonnable ! Pourquoi diable est-il alors aussi dur de se débarrasser de cette phobie ? Il faut chercher ailleurs d’autres raisons qui l’expliquent.
Et si c’était tout simplement parce que ces bestioles marchent sur leur ventre[9] ? Les serpents sont des tétrapodes pourtant : ils ont eu des pattes, jadis. Mais leur disparition les a forcés à adopter un autre mode de locomotion. La reptation désigne le fait d’avancer à l’horizontale, par ondulations et rétractations alternatives, en prenant appui sur les irrégularités du sol. Étymologiquement d’ailleurs, serpent signifie « se traîner ». Le mouvement créé est fascinant parce qu’harmonieux. Le serpent s’insinue partout, file vite et avec précision, dessine des courbes délicates. C’est un animal très différent de l’humain. Peut-être est-ce pour cette raison qu’il nous fait si peur. L’humain a parfois une fâcheuse tendance à être xénophobe…

Agrandissement : Illustration 2

Autre chose : le regard du serpent, à l’instar de celui de Méduse, pétrifie. On lui prête même un pouvoir hypnotique, largement relayé par le méchant Kaa du Livre de la jungle. Petite précision : dans l’ouvrage de Rudyard Kipling, ce serpent n’est pas maléfique. C’est Disney qui l’a diabolisé. Mais voilà, l’absence de paupières confère au serpent un regard fixe qui nous déstabilise. Écailles, langue bifide (la même que celle du Diable d’ailleurs), thermorégulation du sang, mâchoires mobiles, double pénis (eh oui) : autant de caractéristiques qui font du serpent notre alien favori.
Cet étrange animal est au cœur d’un roman magistral, couronné du Grand Prix de l’Imaginaire en 2014 : L’homme qui savait la langue des serpents, d’Andrus Kivirähk. L’auteur prend appui sur les légendes estoniennes pour bâtir son histoire. À l’époque, les humains vivaient dans la forêt, en harmonie avec la nature et le peuple des serpents en particulier. Celui-ci, dont les plus illustres membres sont des vipères portant couronnes, se distingue par sa sagesse et son raffinement. Parce que l’humanité faisait preuve d’une intelligence exceptionnelle parmi les vivants, les serpents lui ont enseigné leur langue. Or qui connait cet idiome acquiert de puissants pouvoirs dans la forêt... Mais les humains sont ce qu’ils sont. La modernité débarque avec les colonisateurs chrétiens. L’appel de la nouveauté se fait sentir. Les croyances ancestrales sont oubliées, la forêt désertée. Le héros, Leemet, va tâcher de préserver son monde et la magie qu’il recèle.
Il y a une grande richesse dans la légende modelée par Kivirähk, où se mêlent poésie, merveilleux, émotion… Et réflexion. L’auteur déploie une analyse fine de notre ambivalence, humains géniaux et stupides que nous sommes, tout à la fois capables d’amour et de cruauté, si prompts à l’aveuglement fanatique. Dans ce livre, ce sont les rapports que les humains entretiennent avec les serpents qui permettent de faire émerger ce questionnement. Plus la modernité progresse, plus les humains s’éloignent des reptiles et deviennent ignares. Les serpents, autrefois alliés, recommencent à faire peur aux hommes. Et la raison, à nouveau, se paralyse.
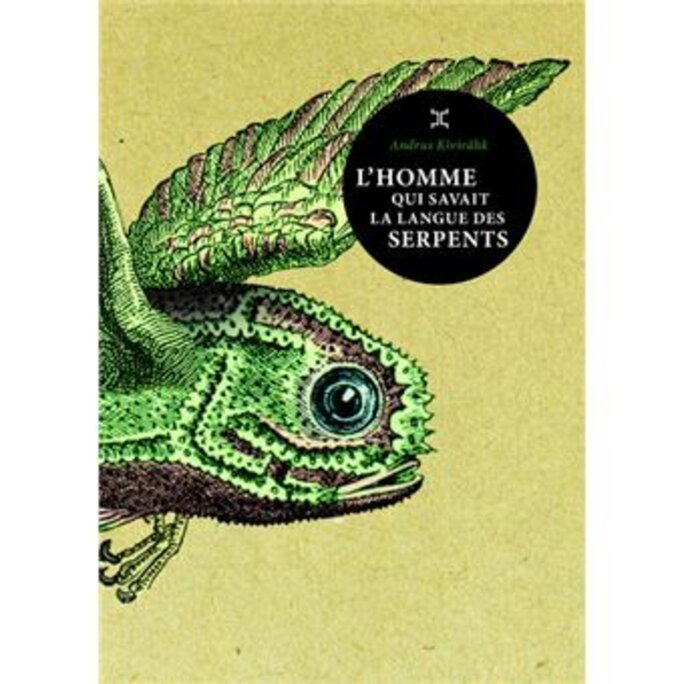
Est-ce une surprise si les populations de reptiles sont en fort déclin aujourd’hui en France[10] ? En cause : le changement climatique, la dégradation de leurs habitats, morcelés par nos « activités ». Les humains quoi. Humains toujours bien prompts par ailleurs à dégommer l’immonde bestiole qui se trouve sur leur chemin. On ne veut pas croiser son terrible regard. On pourrait voir s’y refléter, par exemple, un monstre terrifiant. Une vérité qui nous pétrifierait d’horreur. Ce serait, à n’en pas douter, le serpent qui se mordrait la queue.
[1] L’ophiophobie, pour la nommer.
[2] Chiffre avancé par l’herpétologue Françoise Serre-Collet dans un entretien avec le National Geographic à retrouver ici : Pourquoi avons-nous si peur des serpents ? | National Geographic
[3] L’anthropologue Lynne Isbell avait conduit une expérience sur des primates en 2006, à partir de laquelle elle avait formulé cette hypothèse. Or les résultats en étaient biaisés, ce qu’ont démontré des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Clermont-Auvergne : Non, nous n’avons pas une peur innée des serpents
[4] Étienne Klein et Françoise Serre-Collet, « Devrions-nous mieux aimer les serpents ? », La Conversation scientifique, France Culture, 30 mai 2020. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-conversation-scientifique/devrions-nous-mieux-aimer-les-serpents-6465139
[5] Racine, Andromaque, acte V scène 5.
[6] Voir notamment Le Rire de la Méduse d’Hélène Cixous (1975).
[7] « Le serpent qui danse », Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857.
[8] L’attribut d’Asclépios, le dieu de la médecine.
[9] Comme le dit si bien la reine Guenièvre dans Kaamelott !
[10] Voir le rapport de l’association Cistude sur les populations de serpents en Nouvelle-Aquitaine : Serpents : les espèces s'effondrent en Nouvelle-Aquitaine et l’article de l’Agence régionale de la biodiversité Centre Val de Loire sur le déclin des populations de reptiles en France : Les reptiles en France métropolitaine, des populations en fort déclin - Portail de la biodiversité en Centre-Val de Loire



