Je veux vous parler aujourd’hui de trois livres éclaboussés de sang, de désespoir, de violence. Ils nous viennent des bas-fonds, de la marge. Ils questionnent l’humain et ce que signifie, en politique et dans la vie, être de gauche, à gauche. Vraiment. Sans fioritures, sans langue de bois, mais avec beauté et poésie. De la vraie littérature, en somme.
- À la ligne – Joseph PONTHUS, 2019.
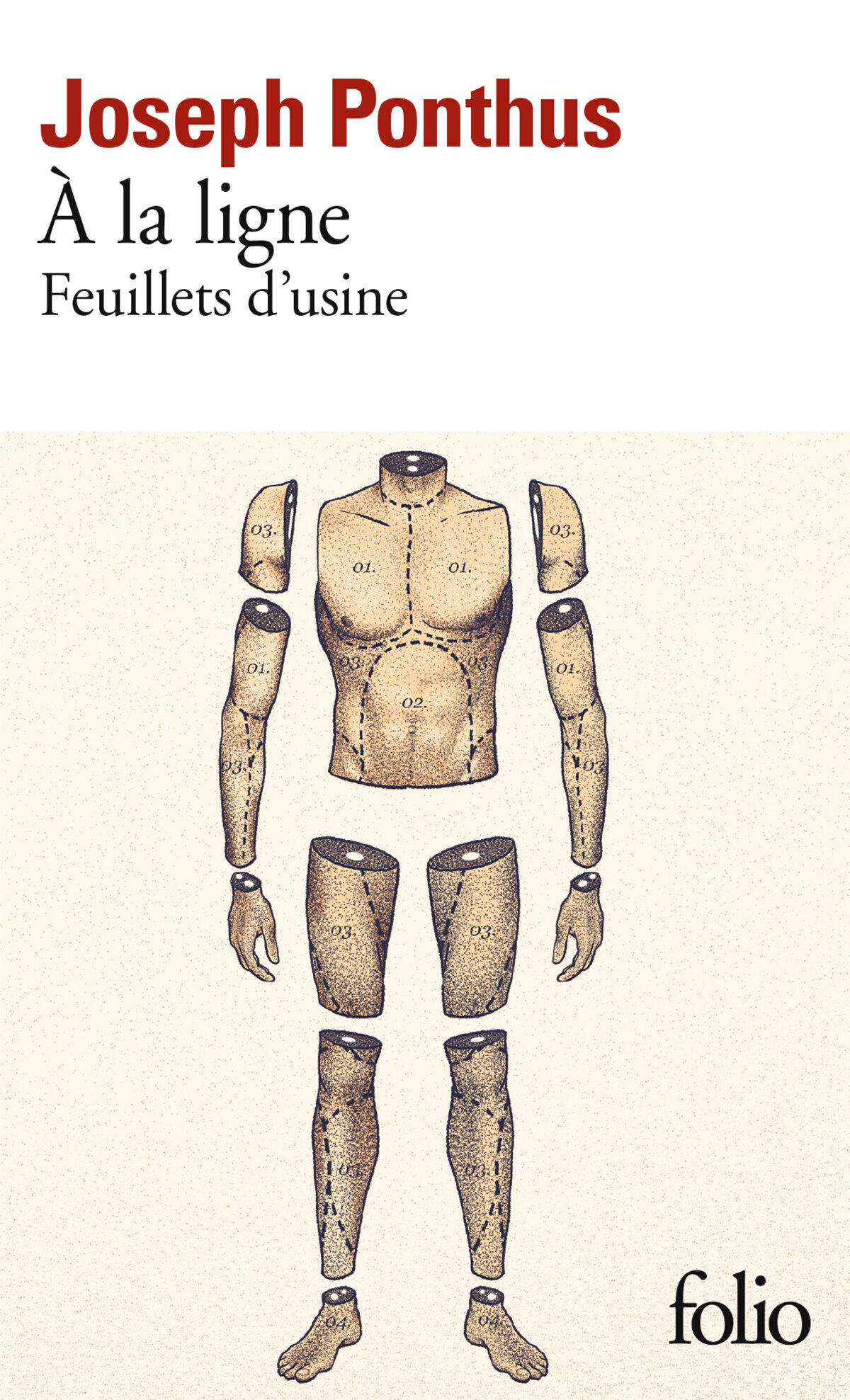
Agrandissement : Illustration 1

Sous-titre : Feuillets d’usine. Il y a des bouquins qui sont des boîtes de Pandore. Celui-ci est classé dans la catégorie « roman ». C’est une erreur. Nos catégories ne sont pas faites pour ce genre d’ouvrages.
Après des études littéraires, Joseph Ponthus devient éducateur spécialisé à Paris. Puis c’est le départ en Bretagne. Cause du déménagement : le grand amour. Là-bas, pas de travail. Il lui faut de l’argent. Faute de mieux, il est embauché à l’usine. À la ligne.
Le froid, les odeurs, la vitesse, l’absurdité du travail à la chaîne, les nuits, les pauses trop courtes, la dureté du boulot – le poids d’une carcasse de bœuf ! – la précarité, le stress, les chefs, attention une mission d’intérim ça ne se refuse pas, si tu veux qu’on te rappelle lundi, faut bosser dimanche ! – les gens qui défilent et toi qui restes. Et puis le froid, les odeurs, vite, vite, les nuits à la chaine, si longues, les week-ends si courts, la fatigue, la précarité, le stress, clope, clope, clope, l’abrutissement. Tout ça pour quoi ?
L’usine est
Plus que tout autre chose
Un rapport au temps
Qui ne passe pas
Éviter de trop regarder l’horloge
Rien ne change des journées précédentes
Parce que Ponthus s’interroge, non comme un intellectuel de gauche curieux de savoir comment vit la classe ouvrière, mais comme un type qui redoute la fin du mois. Le monde de l’usine a tous les traits d’un cauchemar kafkaïen. L’ouvrier est devenu le maillon d’une chaîne dont il ne connaît pas la fin. Précisément : comment justifier une telle déshumanisation ? Entre temps, Ponthus conditionne ses crevettes cocktails, disposées par douze, en étoile, dans une boîte en plastique. Imagine sa destination finale. Questionne notre rapport insensé à la consommation.
Pourtant le monde de l’usine n’est pas tout noir. Ponthus est bien trop intelligent et sensible pour être manichéen. Il y a l’entraide, les moments de grâce. Les chansons qui font tenir : Brel, Trenet… On redécouvre pourquoi le chant est essentiel. Ailleurs et à une autre époque, le blues est né de ce même élan vital. Aussi le cœur se serre quand on lit cette parole désolante d’une ouvrière à la chaîne, captée par l’auteur :
Tu te rends compte aujourd’hui c’est tellement speed que j’ai même pas le temps de chanter
La splendeur de Ponthus, c’est qu’il se sert de l’usine pour en éclater les murs et porter sa réflexion loin, plus loin. Ces feuillets sont rédigés en vers libres, sans ponctuation : des réflexions hachées au rythme des mouvements qu’il effectue. Il bosse et il pense. Ses idées sont arrimées à la ligne, comme lui. La philosophie se déploie pendant que la main charrie une carcasse de bœuf. La forme épouse le fond.
Et puis il y a la poésie, quand les heures se font interminables :
Regarder l’heure
Que tout le temps qui passe
Ne se rattrape guère
Rallumer une clope au cul de la dernière
Jetez un œil au dernier vers : c’est un alexandrin… Barbara aurait aimé, sans nul doute. Mais voilà, ma lecture terminée, j’ai appris avec horreur que Jospeh Ponthus venait de mourir. À quarante-deux ans. C’est donc un mort qui m’avise, dans À la ligne, d’aller découvrir deux autres livres : Journal d’un manœuvre de Thierry Metz et Fragmentation d’un lieu commun, signé Jane Sautière.
- Journal d’un manœuvre – Thierry METZ, 1990.
La souffrance enfante les songes
Comme une ruche ses abeilles
L’homme crie où son fer le ronge
Et sa plaie engendre un soleil
Plus beau que les anciens mensonges
… disait Aragon. On pourrait aisément imaginer une strophe, dans ces vers dédiés aux poètes, en hommage à Thierry Metz. La vie ne l’a pas épargné. Il a laissé quelques ouvrages remarqués et notamment Journal d’un manœuvre, publié chez Gallimard en 1990. Là encore, les étiquettes sont insuffisantes : chronique et poésie s’y entremêlent.
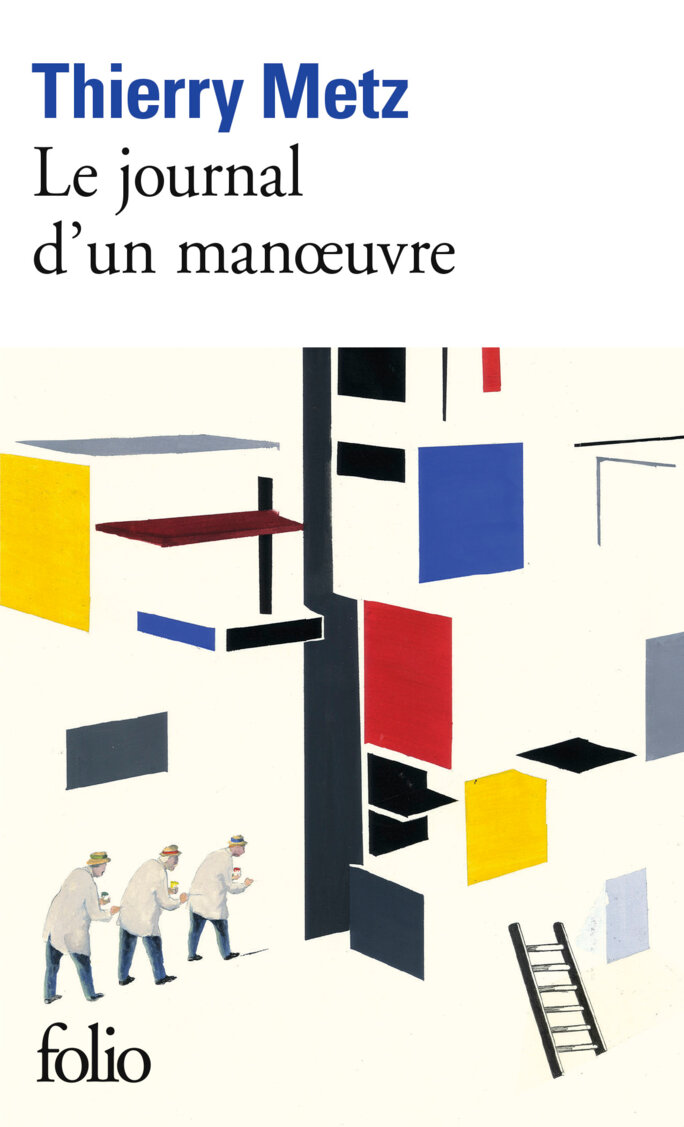
Agrandissement : Illustration 2

Dès la première page, on comprend pourquoi Joseph Ponthus a vu en lui un camarade :
16 juin. – L’agence de travail temporaire m’a trouvé un emploi dans une coopérative ouvrière. Huit heures par jour. Salaire minimum.
Après les abattoirs, l’usine, je retourne dans le bâtiment.
Et il faut tout de suite manier la pioche, creuser, casser, porter des poutrelles, construire, démolir, pelle, ciment, se dépêcher. Vite, vite. Comme chez Ponthus, le manque de temps est cruel :
On passe d’une chose à l’autre. Très vite. Pas moyen de s’arrêter une seconde pour désigner le nuage. […] On n’est convié à rien puisqu’on n’a pas de mots.
Que des outils…
C’est tout.
Écris ton poème maintenant.
Paradoxalement, c’est ce sentiment d’être au ban du monde qui permet au manœuvre-poète de le saisir.
31 juillet. – Des pelles et des pelles de sable, des sacs et encore des sacs de ciment : comment exprimer le vide par le vide, le plein par le plein ? Il suffit d’être ici, entre la pelle et le sac. Le manœuvre est bien placé : si près de la cible.
Lui, Ahmed, Rodriguez, Manuel, Alain, Bernard…. Ils construisent nos maisons. Qu’y a-t-il de plus élémentaire, de plus important que cette tâche ? Ces prénoms si différents ne sont, dans ces livres, séparés que par des virgules. Cela aussi, c’est élémentaire. Ils construisent les maisons que nous habitons.
Et au milieu de la violence du quotidien, il y a les rires encore, les silences, et surtout, presque à chaque page, les oiseaux qui passent dans le ciel et dans les yeux de Metz. Prévert ne s’y était pas trompé : chanter les oiseaux, c’est rêver de liberté.
Des hirondelles bavardent sur un fil de téléphone. Des bateaux se suivent et se croisent sur le canal. Et près du pont de pierre qui enjambe la parole on voit l’âme des pêcheurs qui sert d’appât et de signal…
Mon dimanche est un pays simplifié.
Comme Joseph Ponthus, Thierry Metz a dépouillé le verbe de ses scories, il a remanié la forme pour qu’elle épouse ce qu’il voulait dire : la vie, violente, implacable, nue.
- Fragmentation d’un lieu commun, Jane SAUTIÈRE, 2003.
Nous voici maintenant en prison. Jane Sautière est éducatrice pénitentiaire. Elle court, les bras chargés de dossiers, du tribunal au foyer d’accueil, de cellule en cellule. La violence à laquelle elle est confrontée chaque jour est inouïe et prend des visages multiples. Celle des condamné.e.s, celle de l’institution. La sienne enfin, car la rage et le désespoir la submergent parfois.
Alors, comme Ponthus et Metz, il lui faut écrire, pour raconter. Mais comment ? Le carcan de la littérature « classique », encore une fois, ne convient pas. Il faut démembrer, hacher, couper le récit pour qu’il épouse la violence qu’elle veut dire. Elle a choisi le fragment. Il y en a cent et chacun esquisse le portrait d’une personne rencontrée. Sautière raconte cette population de la marge en utilisant la deuxième personne du pluriel. Vous. Venez, marginaux de tous bords, que l’on vous entende. Mais ce « vous » interpelle aussi le lecteur. La littérature, chez Sautière, a une ambition universelle.
Il y a le SDF qui dormait dans une cage d’escaliers. Il entre un jour chez la seule dame qui lui venait en aide. Il la viole. Il y a ce vieux tzigane dresseur d’ours, rescapé des camps de concentration. La mère qui a éteint sa cigarette sur le sexe de sa petite fille. Les travestis, les camés, cette femme condamnée pour braquage qui nourrit tout son immeuble avec son colis alimentaire, la foule des sans-papiers écartelés par l’administration, les hommes violents les femmes battues… Le défilé de la misère est sans fin.
Ces éclats de portraits sont découpés à vif dans une réalité qu’on préfère ignorer. Les mots de l’autrice ne trichent pas, ils disent juste ce qui est. Et racontent aussi la fatigue, le manque de moyens, la frustration, l’horreur.
C’est un cauchemar. On court partout. Vous voulez nous voir pour avoir des nouvelles de vos familles, leur faire savoir que vous allez bien, demander à prévenir un avocat… Dès que nous arrivons, vous hurlez tous, on n’entend plus ce qu’il faut noter. Les trousses de toilette, distribuées à la hâte, sont reprises à la hâte, car vous vous coupez les veines avec les lames de rasoir, il y a du sang partout. Je cherche un médecin. Il n’y en a qu’un, introuvable, cavalant lui aussi d’une cellule à l’autre. Une dizaine de toxicomanes ont été empilés dans la même cellule, la même cage, couverts de vomissements. Je suis prise de tremblements.
Comment tenir alors ? Il y a la clope, métaphore élémentaire de la vie qui se consume à toute vitesse. Vous dites que vous n’auriez pas tenu sans les clopes. Une pause, une bouffée d’air, toxique bien sûr.
À Huntsville, Texas, prison de la mort, les condamnés peuvent commander le repas de leur choix avant leur exécution. Tout est autorisé, sauf les cigarettes. Le tabac tue.
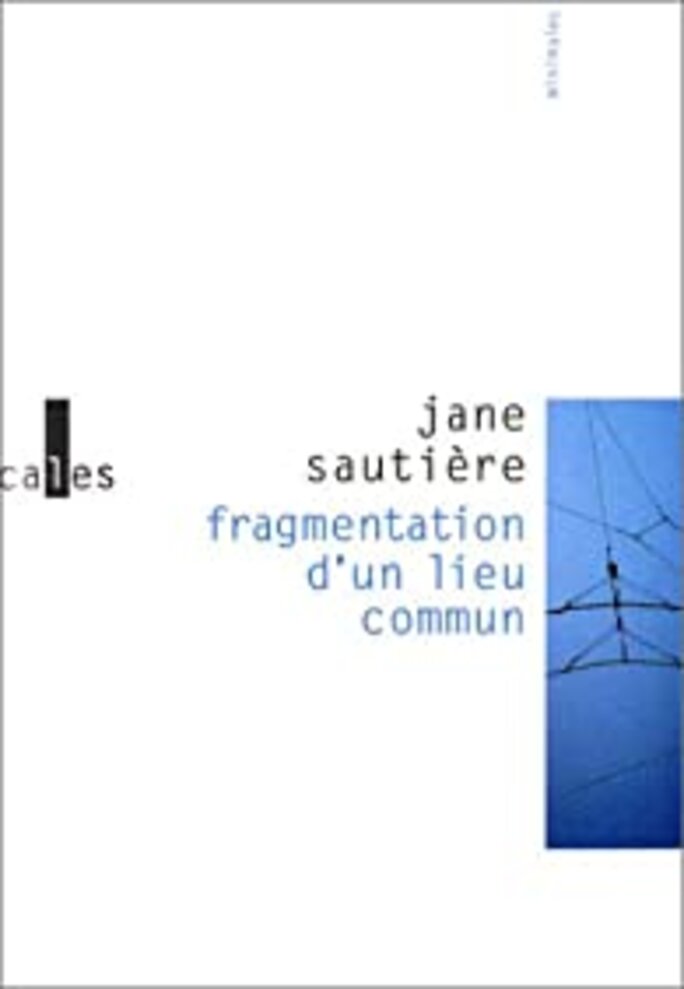
Il y a des touches d’humour, même s’il est noir, des éclats de rire salvateurs, de la compassion, une soirée crêpes organisée en douce. Rien n’est manichéen. Comme chez Ponthus et Metz, c’est au plus près de la déshumanisation que Sautière arrive à questionner notre humanité.
Parfois, un aveu fuse avec une dignité rare. « J’ai des sentiments pour vous », vous me l’avez dit. Je savais que vous étiez là pour proxénétisme aggravé, en l’occurrence des violences physiques terribles exercées sur des prostituées. Cela n’ôte rien à cela. Le contraire non plus.
Et puis enfin, l’autrice convoque les voix de ceux qui ont chanté la misère et l’absurde: Kafka, Genet, Cocteau, et Léo Ferré bien sûr. Poètes, vos papiers… Ils forment les fils d’une grande toile dans laquelle Jane Sautière vient inscrire son ouvrage, comme Joseph Ponthus, comme Thierry Metz. C’est cette toile qui permet de tenir, d’opposer la beauté à l’horreur, de faire briller un peu de poésie dans le noir. Je pense immanquablement aux Fleurs du mal. Baudelaire disait : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or ».
C’est, en définitive, ce qui me plaît tant dans ce trio d’ouvrages. De l’usine à la prison en passant par le chantier, ces trois auteurs, à travers leur voix, font entendre celles de tous ceux qui n’ont pas les mots. Ils recréent le lien, retissent la toile de ce qui nous est commun. C’est comme cela que l’on peut faire société.
Loin de l’élitisme qui emprisonne et dénature parfois la littérature, Jane Sautière, Thierry Metz et Joseph Ponthus viennent nous dire pourquoi elle est essentielle, vitale même. Pourquoi elle appartient à toutes et tous. Le sacro-saint Proust en prend d’ailleurs pour son grade, dans À la ligne, et c’est très drôle (jubilatoire, diraient d’aucuns) :
Le temps perdu
Cher Marcel je l’ai trouvé celui que tu recherchais
Viens à l’usine je te montrerai vite fait
Le temps perdu
Tu n’auras plus besoin d’en tartiner autant
Qu’on ne s’inquiète pas pour Proust, ses défenseurs sont légions. Et c’est tant mieux ! Mais qu’on entende aussi les autres : ceux des bas-fonds, ceux de la marge. La littérature est assez vaste pour contenir l’ensemble de leurs voix. Il faut les lire.



