Lorsqu’elle débarque dans le monde des Esprits, la capricieuse petite Chihiro constate avec horreur que ses parents se sont transformés en porcs. Afin de les aider, elle doit se faire embaucher par la sorcière Yubaba. Celle-ci, lorsqu’elle lui fait signer un contrat de travail, lui confisque une partie de son nom : Chihiro devient Sen et ne se souvient plus de sa véritable identité. Elle vient d’abdiquer sa liberté. C’est également le cas d’Haku, le garçon avec qui elle se lie d’amitié : lorsque Chihiro lui rappelle son vrai prénom, Kohaku, celui-ci retrouve sa nature première. Il est de nouveau lui-même.
Dans le chef d’œuvre de Miyazaki, le nom revêt une importance capitale : il permet d’exister, et d’exister librement. C’est l’une de ses fonctions premières.
Nommer pour faire exister
Le monde qui nous entoure est complexe, foisonnant, infini surtout. Nommer les choses permet de les rendre intelligibles. Lévi-Strauss disait d’une autre façon que le nom servait à identifier, à classer[1]. En donnant des noms, on ordonne ce qui était auparavant un vaste chaos. C’est une très vieille habitude. Les naturalistes, lorsqu’ils découvrent une espèce animale ou végétale, s’empressent de la nommer. Le baptême d’un enfant – ou d’un bateau !- est un rituel sacré, qui souligne bien l’importance du nom. Celui-ci est au cœur de l’histoire du graffiti : à défaut de voyager soi-même, on taguait sur les wagons de train le nom que l’on s’était choisi. Même les épées légendaires ont leur nom : Durandal, Excalibur, Anduril… Si les noms communs sont des étiquettes qui permettent de ranger les choses et les êtres dans des catégories (un passereau, un roman policier, une ville), les noms propres quant à eux singularisent. On peut déjà tirer une conclusion essentielle de ces exemples : avoir un nom signifie non seulement que l’on est connu, mais plus encore que l’on est reconnu.

Agrandissement : Illustration 1

Petite piqûre de rappel : le nom est une classe grammaticale. L’une de ses particularités ? C’est un « réservoir » qui accepte volontiers de nouveaux mots. En effet, on n’invente pas de prépositions ou de conjonctions tous les jours[2]. Mais il est admis que le nom est une catégorie plus ouverte. Les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire chaque année sont en majorité des noms, suivis de verbes et adjectifs dérivés de ces derniers, liés à des réalités inédites qu’il fallait… nommer. Ces entrées sont largement commentées en ce qu’elles reflètent les évolutions sociétales. Au choix pour le dernier cru : trottinettiste, empouvoirement, exaflopique[3]…
Et pour cause, la nomination est tout sauf un acte anodin. Elle est une question de choix, elle atteste d’une façon de regarder le monde. On va donc forger des néologismes pour :
-nommer une pratique qui n’existait pas jusque-là (le selfie, il y a quelques années).
-donner à une pratique existante une coloration politique et citoyenne : c’est le sens de l’écogeste.
- rendre compte d’un phénomène non plus de manière romantisée mais de façon concrète et objective – c’est ainsi que le féminicide remplace enfin le crime passionnel.
On va, pour finir, utiliser des mots déjà existants pour nommer une réalité rendue taboue pour toutes les (mauvaises) raisons que l’on sait : c’est le cas du nom génocide utilisé pour parler de l’abomination que subissent les Gazaoui·es.
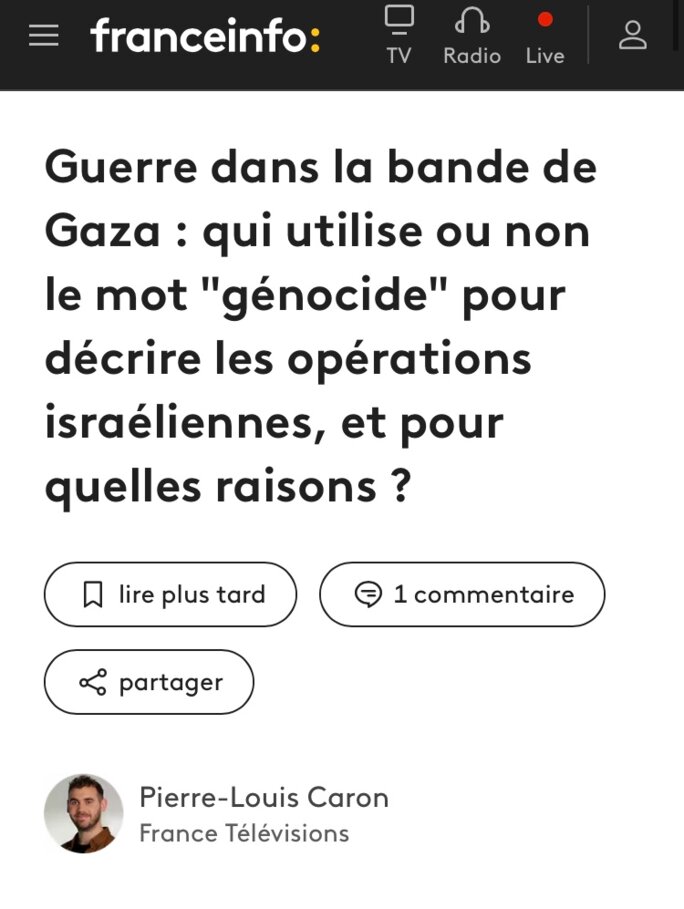
Agrandissement : Illustration 2
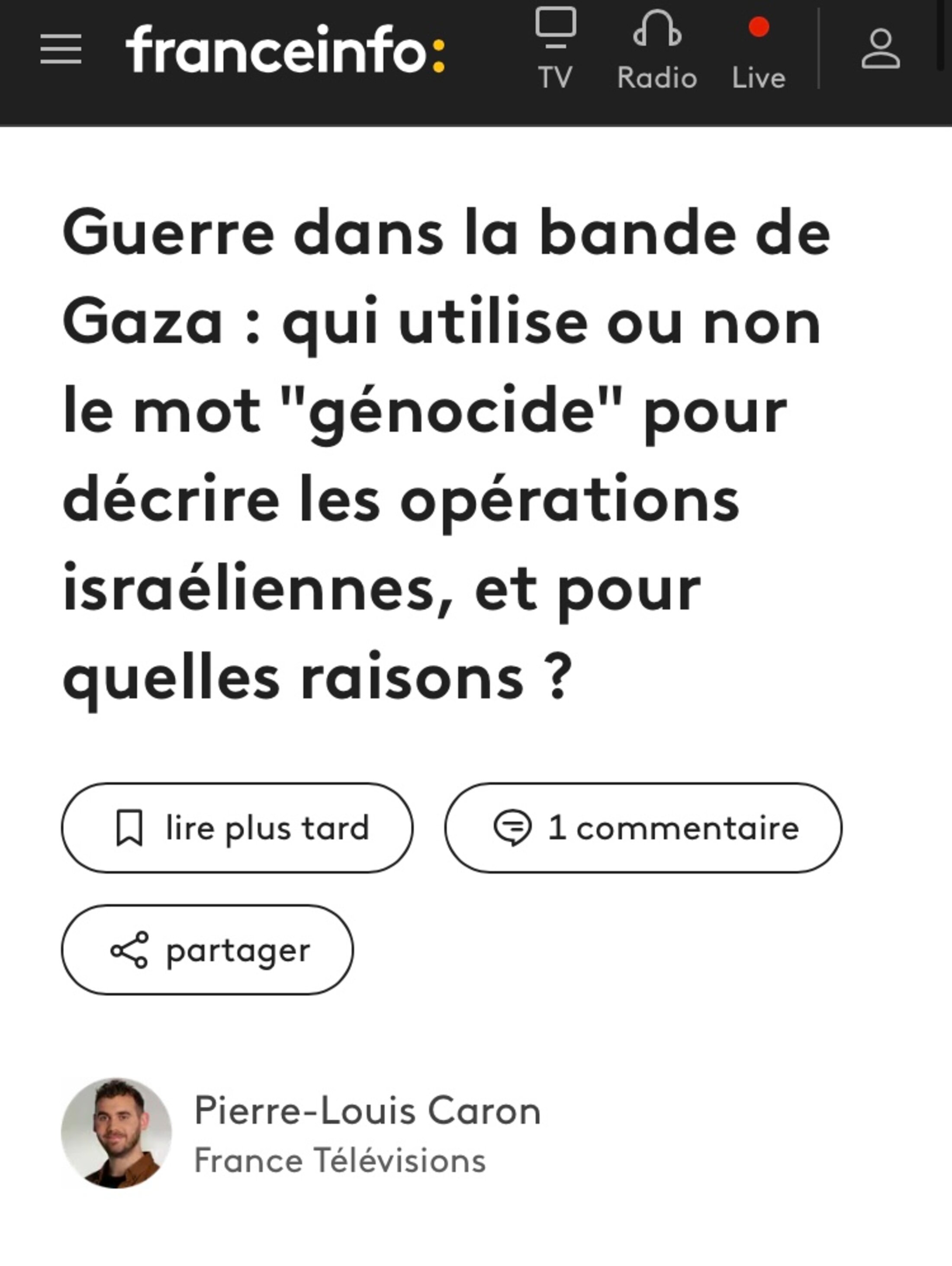
Enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels du nom
Ainsi, le nom atteste de la (re)connaissance de ce qu’il désigne. Cela soulève bien des enjeux, ce qui confère au nom un rôle de premier plan. Celles et ceux qui occupent des positions stratégiques dans notre monde en sont tout à fait conscients.
Dans un article fort intéressant, Omar Guerrero rappelle les enjeux liés à la nomination en traitant d’un exemple éminemment politique et actuel[4] : celui des migrants. Avant la crise syrienne de 2015, les discours politiques et médiatiques parlaient de « réfugiés » : un terme relatif au droit qui rappelait aux nations signataires de la Convention de Genève qu’il était dans leur devoir d’accueillir les personnes ainsi nommées. Et puis les discours ont changé. On a parlé de « migrants » : un terme plus générique, plus flou. Le migrant n’engage à rien. Il se déplace, peu importe le contexte politique. D’ailleurs, peut-être migre-t-il par choix. Ou pour piquer le travail des Français ? Et le migrant devient alors un « étranger ». Cela autorise une « gestion » déshumanisée de ces « flux » qui « menacent » de nous « submerger ». L’indécence de ces discours qui balaient d’un revers de la main celles et ceux qui sont véritablement en train de se noyer. Une stratégie infâme.
La façon dont on nomme quelqu’un ou quelque chose révèle donc une orientation politique. Depuis mai 2024, il est intéressant d’observer, dans les médias, qui choisit de dire Nouvelle-Calédonie et qui lui préfère le nom de Kanaky. Autre exemple : l’odonymie ou comment la féminisation des noms de rues est devenue le cheval de bataille de collectifs féministes. On retrouve le chiffre suivant sur le site du gouvernement : en 2014, seuls 2% des noms de rues portaient le nom d’une femme[5]. Là encore, il y a ceux qui hurlent à la défiguration du patrimoine français, ceux qui tournent en dérision ces revendications, ceux que ce sujet indiffère. C’est édifiant.
Si le nom assume donc une fonction politique, il est également au cœur d’enjeux économiques. Connaissez-vous la pratique du naming ? Il s’agit, pour les entreprises, de donner leur nom à une manifestation ou un lieu. On pourra ainsi aller voir un concert à l’Accor Arena à Paris, ou au Groupama Stadium à Lyon. Une opération marketing qui pérennise l’identité d’une marque dans l’esprit des… consommateurs. La dénomination n’est décidément jamais neutre. Alain Damasio, dans Les Furtifs, n’a peut-être pas inventé grand-chose au final lorsqu’il imaginait une France dont les grandes villes seraient rachetées par des multinationales.
Naming. Il fallait bien l’anglais pour rendre trendy une pratique peu originale en définitive. Donner un nom. Parlons prénoms, tiens. Ils jouent un rôle évident, abondamment documenté, sur les rapports que nous entretenons aux autres. C’est toute la question du déterminisme social qui est ainsi soulevée. Les Eugénie et Firmin réussissent mieux au baccalauréat[6]. Les personnes possédant un prénom arabe auront plus de difficulté à trouver un emploi en France, quand bien même Sofiane serait un génie de subtilité et Louis un crétin fini (voire même un chroniqueur chez LCI). Le prénom, en ce sens, loin d’être un révélateur de l’identité d’une personne, fonctionne comme un écran qui masque l’être. Non, si le prénom est révélateur de quelque chose, c’est plutôt du fonctionnement de la société dans laquelle il est donné. Pour cette raison, beaucoup détestent leur prénom, qui les enferme dans des stéréotypes. D’autres finissent par l’aimer et le revendiquer. D’autres encore ont opté pour un surnom devenu leur véritable identité. Cas plus anecdotiques mais néanmoins éloquents : les homonymes de célébrités. Le rugbyman australien Harry Potter est-il toujours enchanté de porter pareil patronyme ?
Les noms que l’on porte, comme nos vêtements, parlent à ceux qui nous entourent, avant nous, d’une certaine culture, d’une classe sociale, de fantasmes, de lieux aussi que l’on habite. Tout un imaginaire.
Noms de lieux
Justement, basculons maintenant sur des considérations toponymiques. Certains noms de lieux peuvent laisser songeur. On trouvera aux alentours de Grenoble le sommet du Cornafion, une cascade de la Pisserotte, le col du Merdaret que l’on peut atteindre par le Cul du Pet. Quelle poésie ! Il y a aussi la forêt du Massacre dans le Jura, le Jardin des Fontaines pétrifiantes ou la route des Chevaliers de l’an Mil dans l’Isère… Quels noms ! Pour l’anecdote, Léman viendrait d’une racine indo-européenne signifiant lac. Le lac Léman est donc un pléonasme, au même titre que golfe du Morbihan, puisque ce dernier mot veut déjà dire « petite mer ».

Agrandissement : Illustration 3

Pour beaucoup d’entre eux, ces noms n’ont pas été donnés pour rendre hommage à la beauté de la nature ou pour faire joli. Ils viennent de l’usage, sont nés d’une historiette, d’une association d’idées. Ils répondent à des nécessités pratiques : pouvoir parler de lieux communs, se repérer dans l’espace. On retrouve ici la fonction première du nom, celle d’ordonner le monde. Ces appellations se sont inscrites au fil du temps sur nos cartes. C’est d’ailleurs le sens du mot lieu-dit : un endroit portant un nom traditionnel. Voilà comment les noms font paysage. On trouve une jolie page chez Steinbeck à ce sujet. L’auteur parle des noms que l’on peut trouver en Californie, là où il situe son roman À l’Est d’Éden. Il y a d’abord l’empreinte espagnole à la religiosité forte : San Bernardo, Nacimiento, San Miguel… Puis ceux que l’auteur appelle les Américains arrivent, qui donnent des noms descriptifs aux territoires dont ils s’emparent :
Ces noms exercent une grande fascination sur moi, car chacun d’eux suggère une histoire oubliée. Je pense à Boisa Nueva – la bourse neuve ; Morocojo – le Maure Boiteux (qui était-il et comment arriva-t-il jusque-là ?) ; le Canyon du Cheval Sauvage et celui du Pan de Chemise. Les lieux sont marqués à jamais par ceux qui les baptisèrent, respectueux ou irrespectueux, poétiques ou moqueurs. On peut appeler n’importe quoi San Lorenzo, mais Canyon du Pan de Chemise ou Maure Boiteux a une autre saveur.
Comment ne pas être d’accord avec lui ? Un nom gagne en force lorsqu’il est poétique, lorsqu’il possède une force évocatoire. Mais ce que ne mentionne pas Steinbeck, ce sont les noms que les natifs américains avaient auparavant donnés à ces lieux, avant la violente colonisation dont ils furent le théâtre. Le canyon du pan de chemise, si plaisant à entendre, a dû enterrer un autre nom. Et c’est bien là toute l’ambivalence de cette notion : le nom permet de faire exister, oui. Il atteste d’une identité, oui. Et parfois il fait écran à cette identité. Il la cache, il la travestit, il la défigure.
Derrière le nom
On se fait fort, dans le monde politique, de changer de nom. Le FN devenu RN, l’UMP devenue les Républicains. Et qu’importe que l’extrême-droite, dans son essence, soit l’antithèse des idées de rassemblement ou de république. Parfois, c’est le contribuable qui en fait les frais : l’ANPE devenue Pôle Emploi devenu France Travail… Mais faites des économies et traversez la rue, bande d’assistés ! Ailleurs, on peut trouver « Les Lilas », « Les Myosotis », « Les Oursons » pour nommer des banlieues laissées à l’abandon, des EHPAD voués au profit, des lotissements construits en carton-pâte sur des zones inondables. Le nom, utilisé comme de la poudre aux yeux. Bienvenue dans l’ère de la communication - de la « com’ », pardon.
Il y aurait encore tant de choses à dire sur le sujet, tant de remarques à faire sur les noms que l’on donne aux plantes et aux animaux et sur l’anthropocentrisme qu’ils traduisent. Il y aurait encore des choses à dire sur les anonymes, les noms de plume ou noms d’oiseaux, les noms d’étoiles et noms de dieu…
Toutefois, au terme de cette brève analyse, il apparaît évident que le nom est bien davantage qu’une étiquette. Il recèle une puissance. De Voldemort au cancer, il y a des noms que l’on ne prononce jamais, n’est-ce pas ? Il y a en a que l’on prononce trop. Ce qui est intéressant par ailleurs, c’est que ce label n’est pas toujours en phase avec ce qu’il désigne. C’est ce décalage, cet interstice qui doit nous interpeller. Puisque du pouvoir se loge sous le nom, ses usages requièrent notre vigilance. Le langage est dynamique. Les noms, en dépit des apparences, ne sont jamais figés, à l’instar des réalités qu’ils désignent et du regard que nous portons sur elles.
[1] Dans son ouvrage Les structures élémentaires de la parenté, entre autres.
[2] Il est, de même, beaucoup plus rare de former de nouveaux pronoms : on voit à quel point les « iel·les » et autres « celleux » suscitent de résistances. C’est que cette catégorie grammaticale est usuellement figée : elle touche à des structures de pensée qu’on rechigne à changer. Mais il s’agit là d’un tout autre sujet.
[3] Mots tirés de la liste des nouvelles entrées du Petit Larousse 2025, à retrouver ici : Mots nouveaux du Petit Larousse 2025 – Club d’orthographe de Grenoble
[4] Article à retrouver ici : Guerrero, O. (2016). L’importance de nommer Passerelles entre politique et psychanalyse. La revue lacanienne, 17(1), 165-169. https://doi.org/10.3917/lrl.161.0165.
[5] Voir ici : adresse.data.gouv.fr/blog/feminiser-et-decoloniser-les-noms-de-voies
[6] Voir entre autres l’article du Monde qui relaie les travaux du sociologue Baptiste Coulmont sur la question : Du prénom à la mention au bac : des déterminismes sociaux toujours puissants



