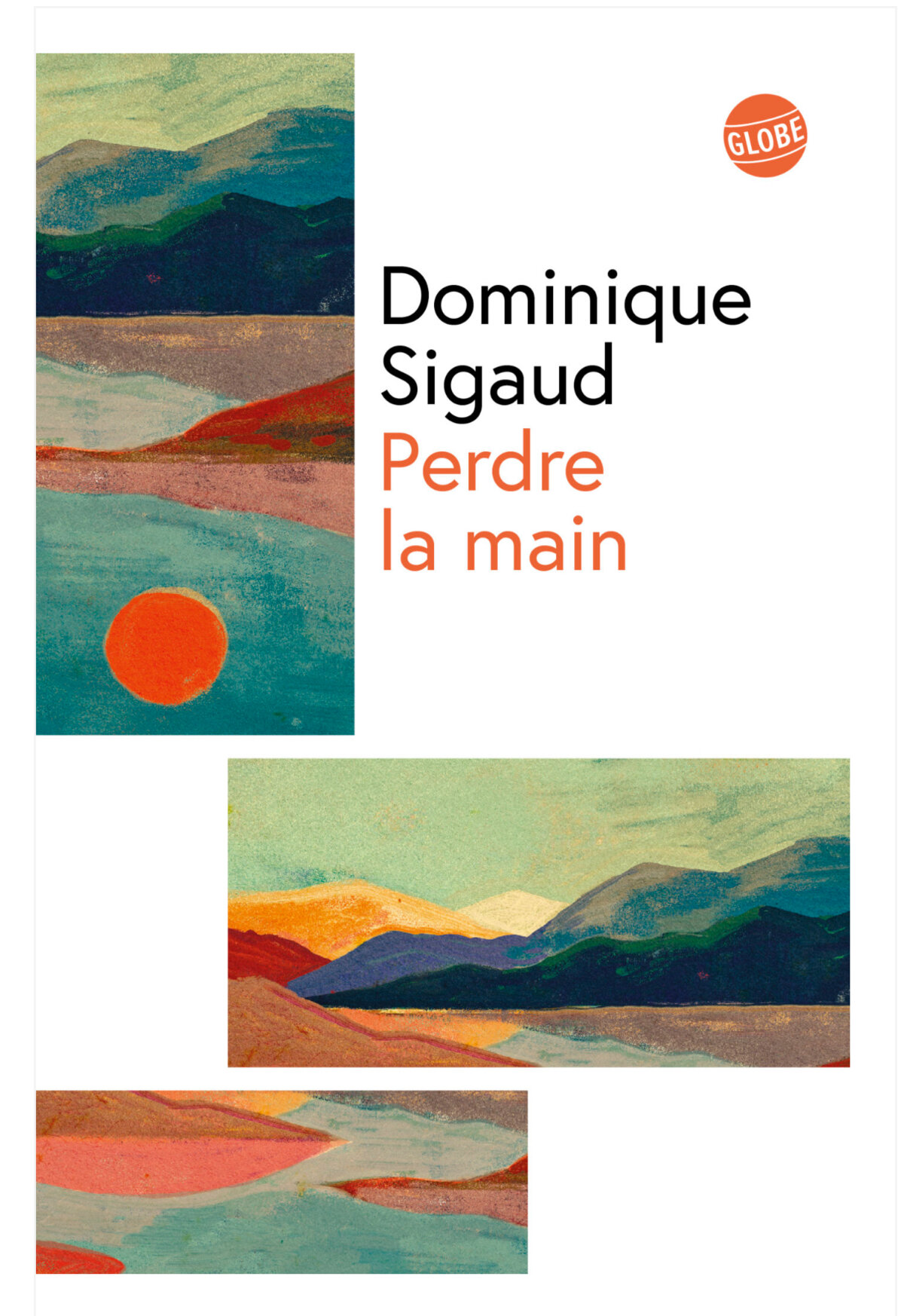
Agrandissement : Illustration 1
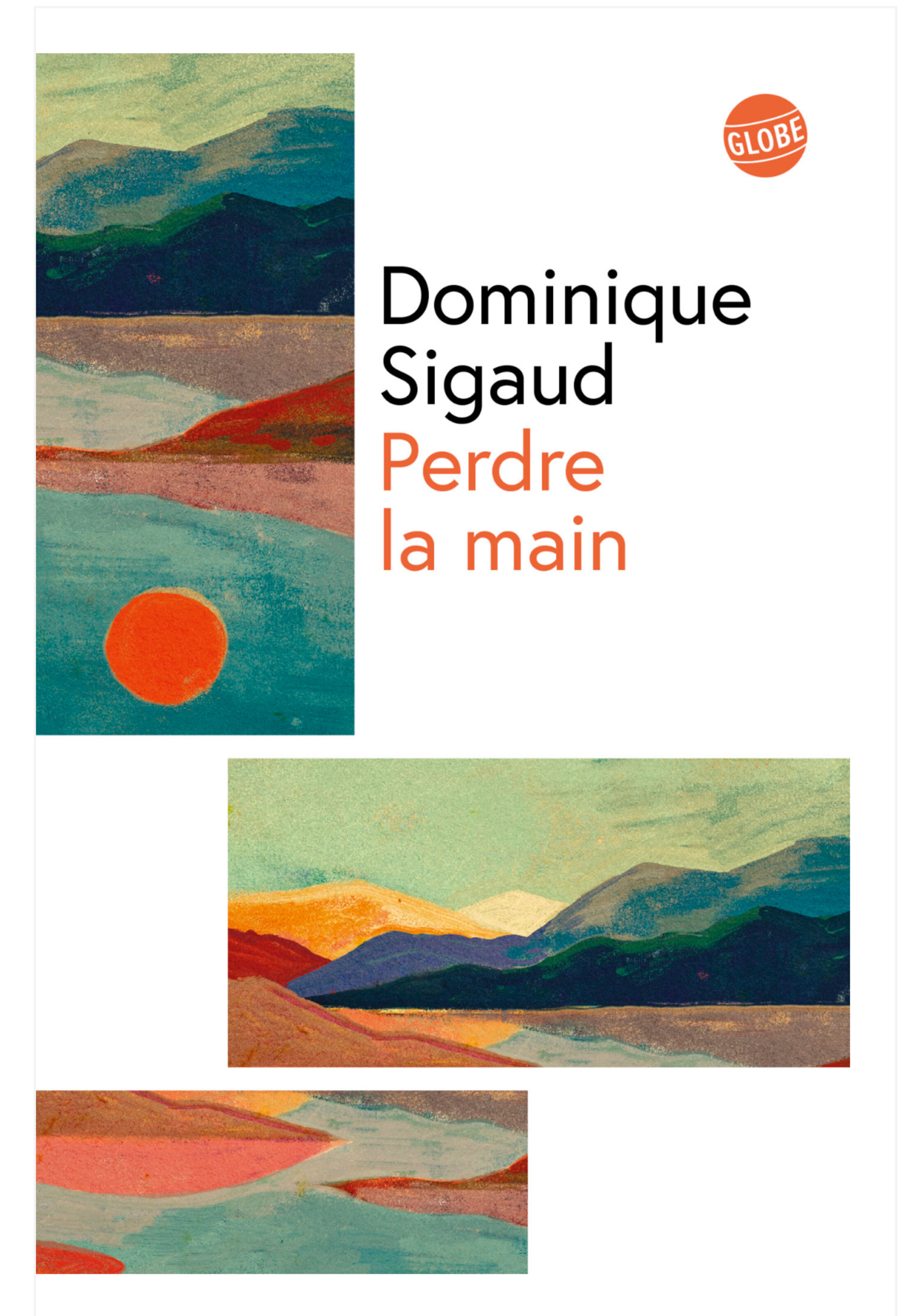
Elle vous saisit dans un moment suspendu, un de ces moments auxquels on voudrait toujours échapper : que ce soit en Israël, à Gaza ou en Ukraine, l’horreur s’impose dans nos vies en direct et en continu, réveillant nos angoisses et nos mémoires ancestrales. Le sang et les larmes, les bombes et les ruines, les enfants qui tremblent, les corps en sang et la détresse sur nos écrans ne cessent de nous renvoyer à notre impuissance, tandis que les propagandes politiques nous accablent et nous font perdre tout sens commun.
On ne savait pas, en 1994 ce qui se passait au Rwanda en regardant la télévision, en ouvrant les réseaux sociaux. J’avais 32 ans, pas d’enfant encore, et je savais déjà que je ne deviendrais pas journaliste de guerre, contrairement à Dominique Sigaud, grand reporter comme on disait alors, une des rares femmes à être partie sur le terrain pour raconter une guerre civile, un génocide annoncé dans lequel allaient périr 800 000 personnes. Je la connaissais vaguement et j’admirais son parcours qui ne serait jamais le mien. Ses livres très forts, l’originalité de son regard et son écriture inégalable traçaient un chemin : elle était de ces personnes qui, à mes yeux, ouvraient le champ des possibles. Et quand j’ai découvert il y a quelques semaines Perdre la main, j’ai été saisie par la puissance de ce texte au point que j’ai voulu vous en parler aujourd’hui, le 8 mars, plutôt que de n’importe quoi d’autre (et pourtant il y a beaucoup d’autres choses dans ma vie en ce moment mais c’est comme ça, j’ai parfois des ordres qui viennent de je ne sais où, et je les suis parce que bon, voilà, c’est ce qui est juste, et qui suis-je pour ne pas écouter l’appel des esprits ?).
Mémoire traumatique
L’horreur ne se traverse pas toujours. On fait tout pour la fuir, pour l’enfouir, et c’est précisément le sujet du livre de Dominique Sigaud qui, dans une langue incandescente, raconte ces quelques semaines au Rwanda, au cœur du génocide. Le texte ressemble à un blast : le souffle de la bombe que l’ennemi vient de larguer dans la maison où l'on vivait encore quelques minutes plus tôt. On sent, en le lisant, le silence qui écrase tout et nous met dans un état second lorsque l’impossible, l’impensable, l’insupportable se produit.
Ce texte est organique et presque humain. C’est son corps qui l’a gardé, presque intact, puisque ce temps d’il y a trente ans, dit-elle, elle ne l’a pas vu passer, elle l’a même oublié : il appartient à ce qu’on appelle désormais la mémoire traumatique. Imprimé tel quel dans sa psyché, obsédant et indomptable pas sa forme répétitive, il est porteur d’autres traumas, d’autres vécus tout aussi indicibles.
Ce texte, raconte-t-elle, s’est imposé à sa main, sommée jour après jour d’écrire d’autres mains disparues. Parce que c’est ça aussi, le génocide Rwandais. Pas seulement les morts, mais aussi les centaines de milliers de blessures, de mutilations parfois invisibles et, pourtant, transmissibles.
Ce texte est enfin politique et, je dirais, déontologique. Il pose constamment la question de ce qu’on fait là, quand on est journaliste, ou témoin, quand on n’est pas « concerné·e », victime, cible ou proie. Comme si l’on ne pouvait être qu’une chose à la fois. Comme si cela pouvait ne pas nous concerner, en réalité.
Obstinément, Dominique Sigaud écrit ce qu’elle a vu, sans emphase, sans faux-semblant non plus. Elle tente aussi modestement de raconter ce qu’elle a vécu alors, et comment elle a été depuis habitée par cette épouvante dont le souvenir lui échappait toujours. Pour deux personnes : une femme mutilée rencontrée en boîte de nuit, et un homme gisant au bord de la rivière, les mollets coupés.
Elle ne le sait pas, mais elle a aussi écrit pour nous, dénouant ces sortilèges mortels avec des mots qui nous touchent par leur justesse et, de façon inattendue, nous apaisent.
Perdre la main, par Dominique Sigaud, Globe.



