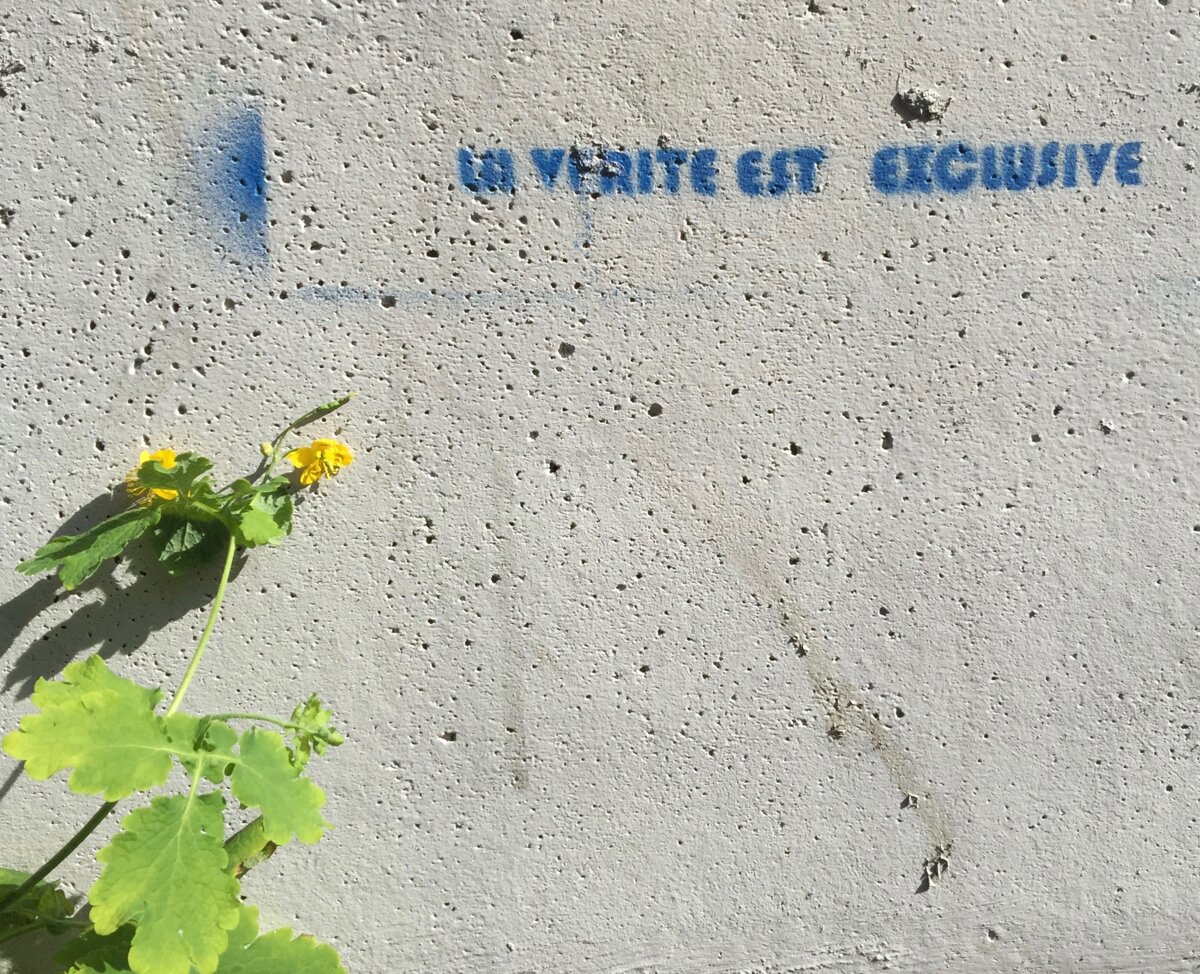
Agrandissement : Illustration 1

En 1883, Eugène Pottier, âgé de 68 ans décide de repartir en goguette. L’expression un peu désuète désigne la participation à un club d’amateurs de chansonnettes, comme il y en avait à Paris des centaines. Celui auquel Pottier était attaché s’appelait « La lice chansonnière ». Créée en 1831, c’était la plus célèbre et la plus prestigieuse goguette de Paris. Elle organisait régulièrement des concours et cette année-là, Eugène Pottier avait décidé de présenter une de ses chansons « Chacun vit de son métier », qui remporte la médaille d’argent. Il faut imaginer ce vieillard oublié de tous s’exposer ainsi au jugement d’une jeunesse insouciante, parmi 300 autres candidats. Le poème parle d’un croque-mort qui ne gagne pas sa vie parce que les ouvriers vont à la fosse commune... Un petit bijou d’optimisme.
En découvrant l’ancien communard indigent, à demi-paralysé, rongé par le saturnisme, les membres de la Lice décident enfin de l’aider et publient un recueil d’une cinquantaine de ses poèmes sous le titre de « Quel est le fou ? », avec le soutien financier d’un chansonnier fortuné, Gustave Nadaud, qui admire Pottier sans partager ses idées. On peut écouter la chanson en question You Tube et comme bien d’autres œuvres de Pottier, elle frappe par son actualité. En 1887, alors qu'il va vers son dernier souffle, paraissent ses Chants révolutionnaires, aux éditions Dentu. On peut y lire notamment un poème paciféministe, la Grève des femmes, qui se termine par ces vers : « À bas la guerre ! en grève ! en grève ! La femme doit briser le glaive. Nargue à l’époux, nargue à l’amant ! Jusqu’au désarmement : Les femmes sont en grève ! »
Brigands révolutionnaires
Les Chants révolutionnaires ne feront pas la richesse de Pottier, qui meurt le 6 novembre 1887 sans en connaître la mélodie. J’ai dit qu’il avait en tête l’air de la Marseillaise lorsqu’il l’a écrit, mais c’est finalement un ouvrier et compositeur belge, Pierre Degeyter, qui écrit en 1888 la mélodie que nous connaissons aujourd'hui. Si elle est originale, le thème des premiers quatrains présente des similitudes avec un air des Bavards.
C’est Gustave Delory (1857-1927), membre du Parti ouvrier français et futur maire de Lille qui avait demandé à Pierre Degeyter (1848-1932) de mettre L’Internationale en musique pour la Lyre des travailleurs, une société musicale lilloise. La légende prétend que Degeyter, subjugué par la puissance du poème, en a écrit la musique en trois jours dans un café dénommé Liberté, et c’est un 23 juin que la Lyre des travailleurs l’interprète pour la première fois à Lille lors de la fête du Parti ouvrier français.
Un livret réunissant paroles et musique est édité à Lille à 6000 exemplaires. Mais le succès est long à venir. En juillet 1896, il est enfin entonné par les participants du XIVe congrès du Parti ouvrier français qui se tient à Lille. Mais la consécration survient le 8 décembre 1899, lorsqu'il clôt le congrès national du Parti ouvrier français salle Japy à Paris pour tenter de réunir les diverses tendances d'une même voix.
Les vers sont dans le fruit
Hélas, le ver(s) de la division est déjà dans le fruit. Celles et ceux – dont je suis – qui s’émeuvent des querelles actuelles de la gauche seraient surpris d’apprendre que dès la naissance du mouvement révolutionnaire, la bonne humeur et la fraternité n’étaient parfois fournis qu’en option – quand elles ne faisaient pas purement et simplement défaut. A la fin du XXe siècle, on comptait pas moins de cinq tendances dans le socialisme, auquel il faut ajouter les anarchistes. Il y avait là de quoi s’entretuer largement sans l’aide du Grand Capital.
La question de savoir à qui appartient l’Internationale est alors… capitale, et on se tire bien la bourre entre les réformistes (Jean Jaurès, Paul Brousse…) et les révolutionnaires (Jules Guesde, Edouard Vaillant…). Si ça ne vous rappelle rien, c’est que vous vivez sur la planète Mars, et je ne peux pas vous en vouloir. Par boutade, Marx affirmait même à l'époque qu'il n'était par marxiste, ce qui donne quand même une idée du degré de confusion qui pouvait régner.
En 1904, alors que le combat fait rage, Adolphe, le frère de Pierre, déclare être… le véritable auteur de l’Internationale.
Degeyter est obligé de faire un procès pour retrouver ses droits, mais la blessure est terrible. En 1916, Adolphe, bourrelé de remords, laisse une lettre où il reconnaît avoir menti sous la pression de Gustave Delory, alors qu’il était employé de mairie. Ce serait pour punir Pierre d’avoir quitté le Parti ouvrier français que le maire de Lille aurait monté cette machination, à laquelle Adolphe a cédé par faiblesse de caractère. Il se suicidera un an plus tard.
Un an plus tard, c’est aussi la révolution en Russie et l’Internationale deviendra l’hymne de l’Union soviétique. Mais l’humiliation suprême survient lorsque la cour d’appel de Paris ordonnera plus tard que soit effacée de la tombe d’Adolphe, qui repose au cimetière de Lille, toute référence à l’Internationale.
Degeyter a près de 80 ans lorsque Staline l’invite à Moscou pour le dixième anniversaire de la Révolution d’Octobre. Il lui accorde, semble-t-il, une petite pension d’Etat qui lui permet de vivoter à Saint-Denis, où il s’est finalement installé, et où il meurt en 1932 dans un relatif dénuement. Cette fois, 50 000 personnes se rendent à son enterrement – les funérailles étaient plus courues qu’aujourd’hui apparemment – et sa tombe est ornée d’une faucille et d’un marteau du plus bel effet.
Sans surprise, on chante devant sa tombe l’Internationale. Mais pour ce qui est des droits d’auteur… je vous en dirai plus lundi, car j'attends des révélations exclusives pour ce week-end.



