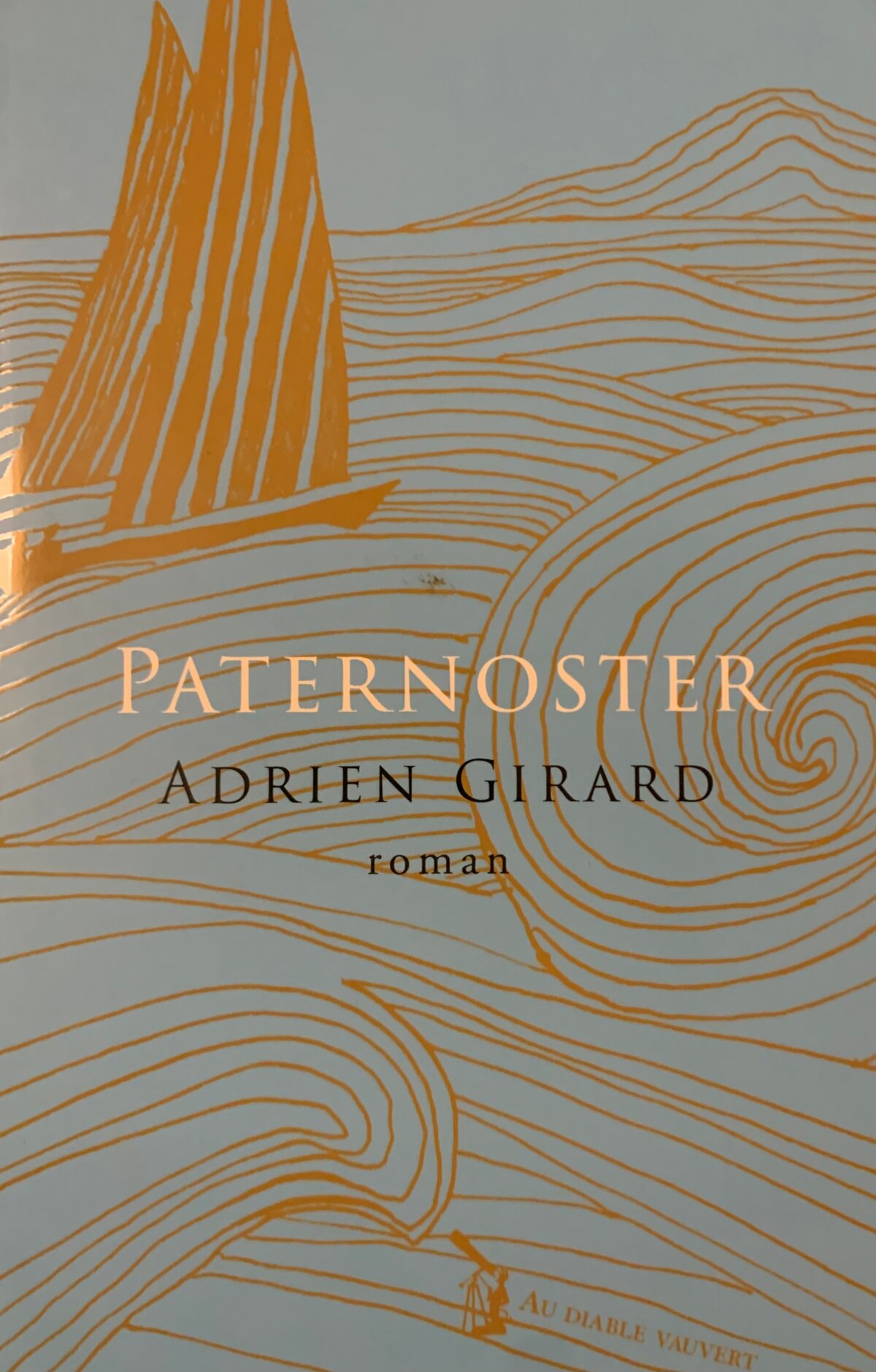
Agrandissement : Illustration 1
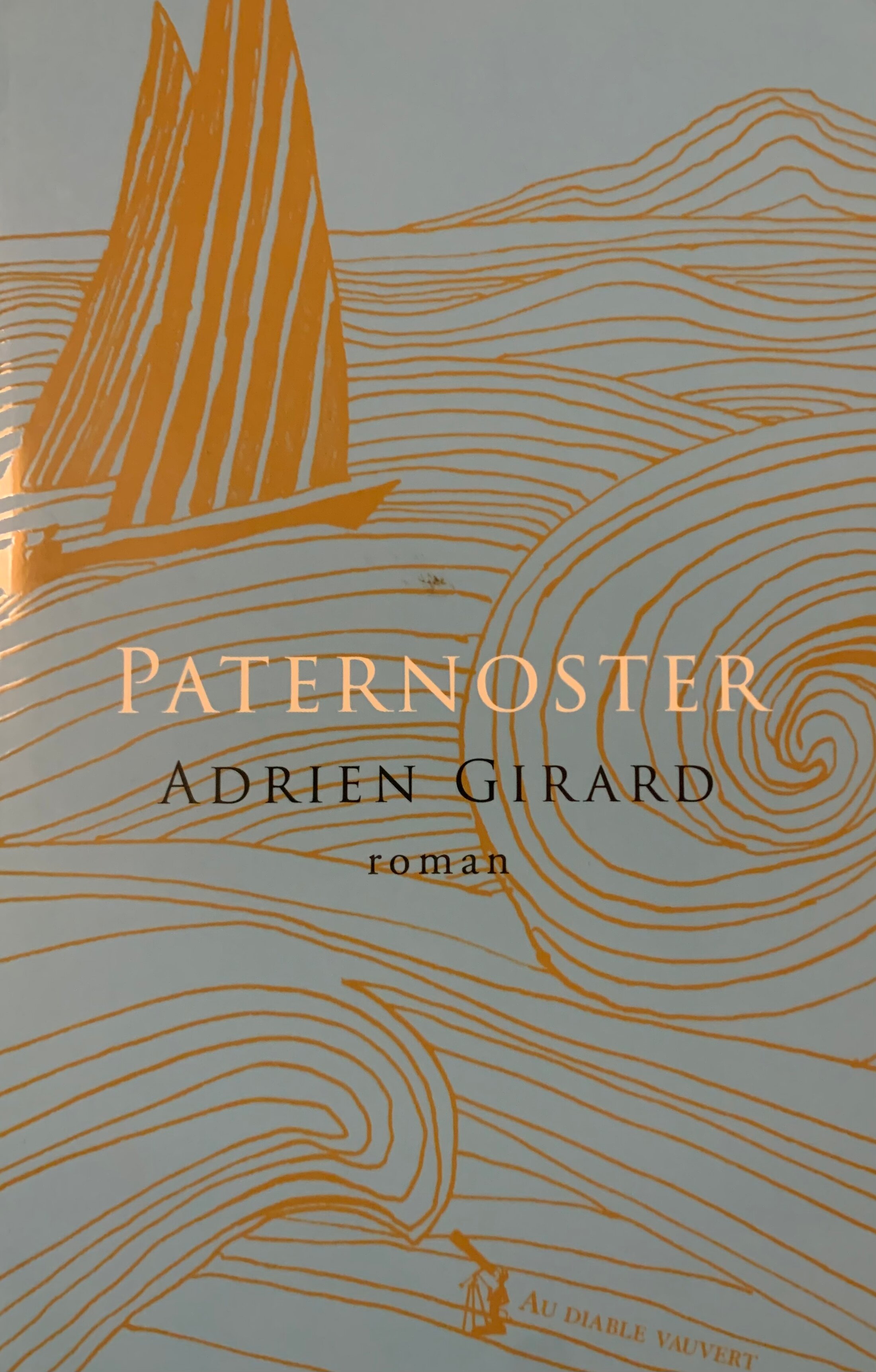
C’est l’histoire d’un père défaillant, un père qui se meurt à la bien mal nommée île de la Réunion.
Son fils vient à son chevet et s’abîme dans l’attente d’une mort qui refuse de mettre ses habits du dimanche. C’est la mort qui pue, qui gargouille, qui nous harcèle et qui nous tue. Bref, la mort dans son plus simple appareil, qu’Adrien Girard scrute au jour le jour dans cet hôpital où règne déjà l’épidémie de Covid. C’est la mort drôle comme dans les films et surtout comme dans la vie, où tout est cocasse, absurde, dérisoire et pourtant profond. Le rire n’en finit jamais de côtoyer le pire, et Adrien Girard sait rendre ce paradoxe avec un talent rare.
Lisez le premier chapitre à voix haute et vous verrez que ce roman s’installe dans des rythmiques très anciennes. C’est le chant du duende, celui qui se perd hors du temps, dans des virilités magiques et merveilleuses, comme les corps fins des toreros dansant dans la lumière.
Oui, je suis désolée pour celles et ceux que cet art révulse, il y a de la tauromachie dans ce roman qui tente d’apprivoiser la mort au cours d’une danse brève. Il ne faut ni un mot, ni un geste de trop pour faire vivre l’indicible. A chaque phrase de "Paternoster", j'ai été prise par l’angoisse d’un coup de corne fatal qui emporterait le narrateur dans son au-delà mythique.
Parce que je suis féministe et que la tauromachie était, contre mon gré, la passion de ma mère, je ne peux m’empêcher de voir dans ce roman la mort du père, et partant, celle du patriarcat.
Au moment où l'on fête le solstice, ce livre est un parcours entre ombre et lumière qui se lit tout seul.
C'est mon cadeau de Noël avant un dernier billet prévu pour demain, un recueil de poésie au titre merveilleux : "Rage tendre", de Jérôme Bertin.



