Aborder la personnalité d’un être tel que Guy Debord nécessite d’innombrables prudences, et implique de jouer avec une double contrainte : d’une part, celle de s’appuyer sur le réel pour échapper aux tentations affectives, qu’elles soient hagiographiques ou qu’elles témoignent d’un rejet plus ou moins violent. Tout en se méfiant d’autre part du matériau disponible, tant il a subi les biais du mythe que le penseur et écrivain situationniste a construit pour lui-même.
Auteur de sa propre légende[1], Debord l’a été dès l’enfance, et c’est au berceau, voire avant, que Jean-Marie Apostolidès tente de le saisir pour sa biographie Guy Debord, le naufrageur parue chez Flammarion en octobre dernier. Car le « moi mythologique » construit par le penseur s’origine dans une histoire singulière, peuplée de figures de femmes ambiguës, où le manque du père joue un rôle marquant et où la quête de légitimité va prendre des proportions mégalomaniaques telles qu’elles contribueront au renouveau de la pensée des années 60. Ce parti pris implique une approche empruntée à la psychanalyse mais qui, ici, se défie des outils de ce même langage et les évite pour n’en garder que la démarche intuitive.
Autre difficulté de l’exercice, la volatilité du matériau disponible. Jean-Marie Apostolidès n’a pas connu Debord personnellement, et l’on peut en déduire qu’il a ainsi échappé au magnétisme perturbateur et générateur de subjectivité que l’homme exerçait sur quiconque entrait dans son orbite. Il a en revanche connu nombre de ses proches, et dès lors l’examen de l’homme à partir de l’impact qu’il a eu sur autrui – à travers lettres et témoignages directs ou indirects – offre un point de vue tout à fait original. Les déclarations inédites, notamment, de Patrick Labaste, demi-frère de Debord, ainsi que l’exploitation minutieuse des archives, disponibles depuis peu, de la bibliothèque Beinecke à Yale, constituent un apport considérable à la connaissance de la figure du penseur et dévoilent une réalité saisissante de perversité et de puissance.
La plupart des biographies, nous dit Jean-Marie Apostolidès, en ce qu’elles veulent cerner l’image de Guy Debord, en font un personnage monolithique, insusceptible de la moindre évolution. Alors que le biographe voit en Debord avant tout un stratège habile, voire machiavélien, qui s’adapte pour construire sa légende (très inspiré dans sa maturité par L’Art de la guerre de Sun Tzu, il a même inventé un jeu de stratégie qu’il aurait voulu commercialiser). Contrairement à ce dont il aurait rêvé, Guy Debord fut un inspirateur plutôt qu’un homme d’action ; un moraliste au sens du XVIIe siècle, plutôt qu’un révolutionnaire rebelle. Il fut, surtout, un homme acharné à défendre la nécessité de mettre en cohérence ses idées et ses actes, tout en menant une existence en fréquente contradiction avec sa pensée – sauf peut-être dans son geste ultime, celui de se donner la mort.
La figure de Debord n’est jamais fixée. Ses proches semblent ignorer qui il était réellement tant son image échappe et fuit. Ce n’est pas faute, pour l’un comme pour les autres, d’avoir voulu la contrôler. À commencer par les archives qui, d’après Jean-Marie Apostolidès, sont filtrées dans le but de maintenir une représentation bien spécifique de Debord ; lequel a lui-même exercé un contrôle total sur son propre mythe afin de créer un mécanisme de fascination dénué de toute possibilité de mise à distance. Fascination que Jean-Marie Apostolidès attribue à tous ceux qu’il nomme, sans concession, les « dévots ». Il note en outre que la plupart des artistes et intellectuels ayant fait partie de l’Internationale situationniste ont été humiliés ou blessés par Guy Debord ; en dépit de cela, ils sont restés muets, entérinant la légende positive du « maître ». Ils ont cependant, pour certains, conservé leurs archives, qui sont parfois accablantes et dont Jean-Marie Apostolidès affirme avoir adouci le propos…
Le sujet, on le sait, est sensible ; il engendre d’inévitables tensions entre les « dévots » précités et les anciens « pro-situs » déçus et/ou meurtris, en position de rejet vis-à-vis de l’idole, mais surtout entre, d’une part, ces deux polarités extrêmes d’un rapport affectif à la figure de Debord et, d’autre part, ceux-là qui tentent d’approcher une presque impossible objectivité. S’il est si sensible, c’est aussi parce qu’il a malgré tout joué un rôle, qu’il soit ou non factice, dans la construction de la pensée de l’époque, avec les répercussions que cette période de l’histoire de la pensée a eues sur les modèles intellectuels contemporains. Le succès du situationnisme en tant qu’idéologie (rejetée par Debord lui-même assez vite), tel que l’analyse Jean-Marie Apostolidès, tient essentiellement à ce qu’il a réussi à faire croire à toute une génération qu’il était possible de changer la société, de fonder un nouveau rapport à l’art et au monde.
Le travail de Jean-Marie Apostolidès tend à démêler en quoi ce succès a pu avoir lieu alors même qu’il ne reposait sur rien ou presque. Position radicale, qui tient dans le titre : celui-ci fait en effet référence à ces habitants des zones côtières qui attiraient les navires sur les rochers en vue de les piller, plaçant pour ce faire des lanternes, balises trompeuses, sur les épaules de leurs bêtes. Ce qui, suggère l’auteur, n’a sans doute jamais existé – comme beaucoup de ce que Guy Debord a prétendu faire et qui aurait eu des conséquences sur la société. Ainsi, le rôle du situationnisme dans les événements de Mai-68 est-il largement minoré par le biographe, qui y voit une construction a posteriori appartenant à la légende.
Pour Jean-Marie Apostolidès, la dimension sectaire du programme debordien tient, d’abord et surtout, au fait qu’il n’admet aucun recul vis-à-vis de son modèle idéologique ; Debord fait d’ailleurs lui-même référence aux sectes, dans un contexte de fascination pour ce qu’il perçoit comme une Apocalypse à venir, à propos de laquelle il serait le seul à détenir la vérité. Pour alimenter la thèse de la secte, le biographe souligne également l’importance que la question du financement – qu’il s’agît de celui du mouvement situationniste ou de son train de vie personnel – avait pour Guy Debord, et son rapport complexe aux femmes et à la sexualité.
En particulier, cette dernière notion est largement traitée dans Guy Debord le naufrageur. La « révélation » du livre a trait à la relation incestueuse entre Debord et sa demi-sœur Michèle Labaste, et plus généralement aux comportements déviants de l’écrivain vis-à-vis des femmes, avec lesquelles il entretenait une relation ambiguë et souvent violente. Le thème de la sexualité sert là encore à illustrer le caractère autoritaire de Debord, en particulier lorsqu’est évoqué le « droit de cuissage » imposé par Debord à certains de ses disciples[2].
Il ne faut toutefois pas voir dans le projet de Jean-Marie Apostolidès un portrait exclusivement à charge, qui viserait par essence à déboulonner l’idole. Guy Debord n’est pas dépeint comme une supercherie, au sens où il aurait mis en place une imposture consciente : il reste un personnage fascinant, tyrannique et fragile à la fois, qui n’a pas su dépasser les frustrations d’une enfance compliquée et qui a eu besoin, pour se construire en tant qu’individu légitime, de créer des systèmes satellitaires dont il lui fallait être la planète. La structure même de Guy Debord, le naufrageur reflète cette nécessité, puisque ses chapitres déclinent une typologie de groupes aux dimensions et aux enjeux divers : la famille, la bande, le mouvement, la secte, la horde, l’armée. Jean-Marie Apostolidès définit Debord comme un « homme-groupe », dans le sens où les gens qui l’entouraient étaient lui, une expression objectivée de lui-même, de son moi intime, d’où la nécessité de contrôler leur présence par l’emprise, ou leur absence par l’expulsion.
Ivan Chtcheglov, figure presque irréelle dans son pseudonymat à laquelle Jean-Marie Apostolidès a consacré un livre[3], a constitué une exception en ce qu’il a longtemps résisté à l’emprise de Debord, tout en en conservant les faveurs. Quant à Isidore Isou, créateur du lettrisme et modèle de la première heure, il a fonctionné comme un support pour la construction du moi mythologique de Debord, mais rapidement l’élève surpassera le maître en matière – notamment – de tyrannie. Enfin, la référence à André Breton, celui notamment de la deuxième période de l’aventure surréaliste qui, sous couvert d’une démocratie factice, adoube et exclut à tour de bras les membres de ses cercles de disciples, est à signaler. Jean-Marie Apostolidès rappelle d’ailleurs judicieusement que Breton était de la même génération que le père de Guy, Martial Debord[4].
La question se pose bien sûr de la nécessité d’une nouvelle biographie, notamment après celle très complète de Christophe Bourseiller[5] et les nombreux ouvrages publiés sur le sujet. Mais cette publication se justifie à la fois par son approche originale, et par son apport considérable à la connaissance du personnage de Guy Debord, notamment grâce aux documents que Jean-Marie Apostolidès est le premier à exploiter. Surtout, il semble bien qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur cet homme singulier qu’était Guy Debord, figure centrale d’un microcosme intellectuel dont les idées ont influé de manière substantielle sur la manière dont la société est perçue aujourd’hui par les instances de la pensée, qu’elles soient sociologiques, philosophiques ou politiques.
Jean-Marie Apostolidès est enseignant et chercheur à l’université Stanford de Californie. Auteur de romans et de théâtre, il a également publié de nombreux essais, sur des sujets aussi variés que Tintin ou Cyrano de Bergerac, dont le très remarqué Héroïsme et victimisation, Une histoire de la sensibilité (2003). Il est enfin l’auteur des Tombeaux de Guy Debord, publié chez Flammarion en 2006.
Guy Debord, le naufrageur
Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 2015
592 pages, 28 euros
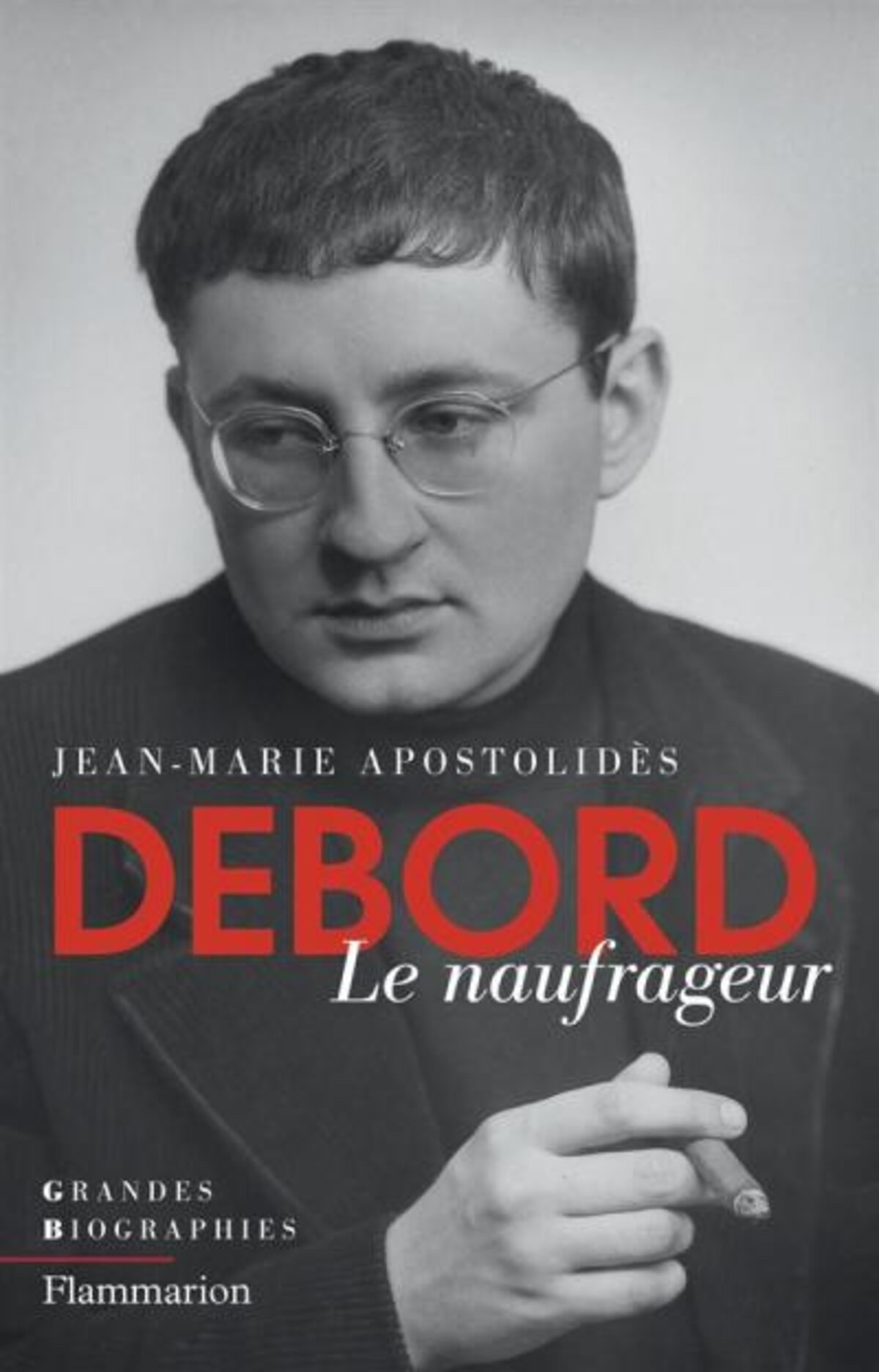
Agrandissement : Illustration 1
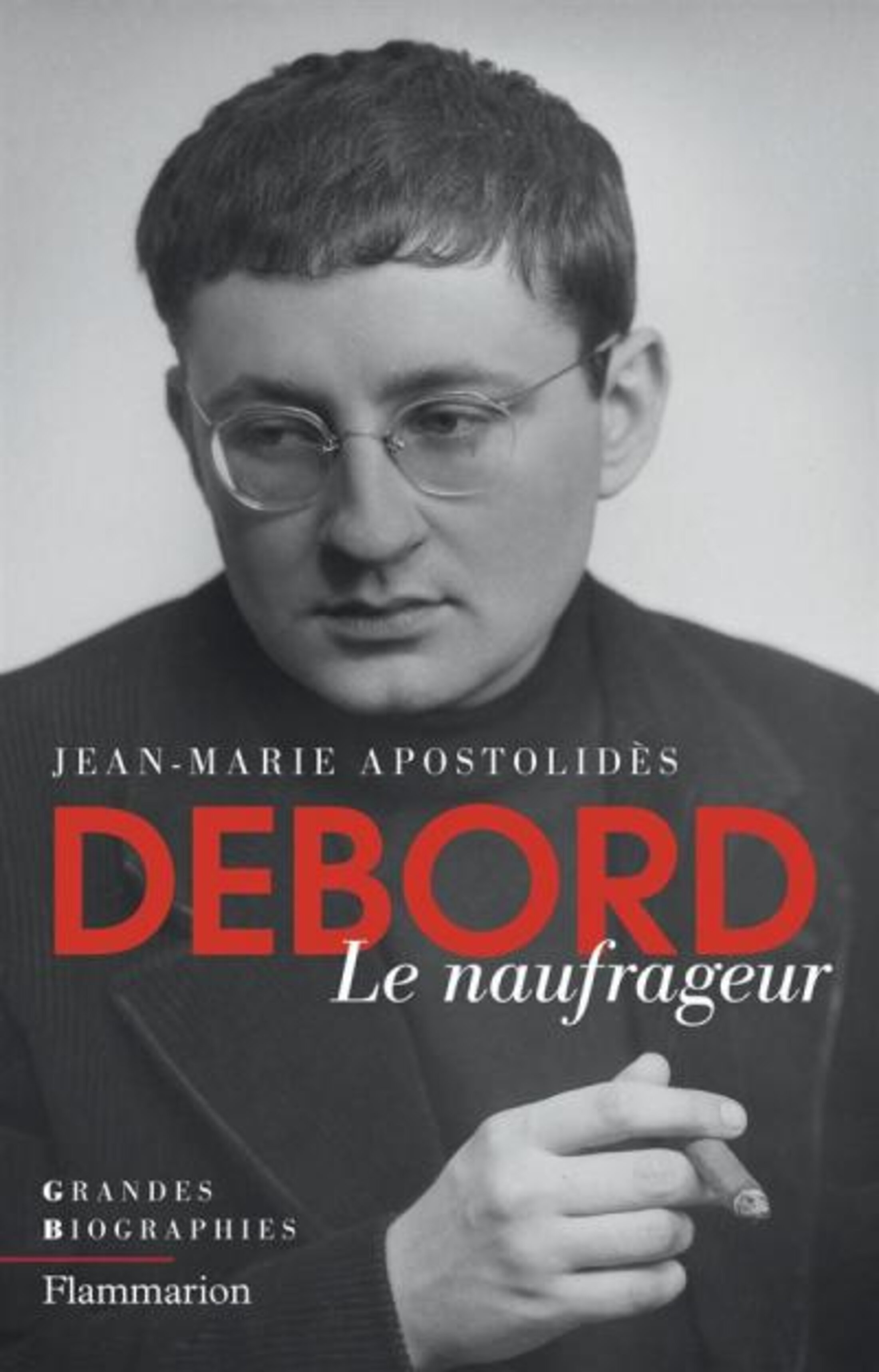
[1] Cette « automythographie » dont parle Yalla Seddiki dans sa thèse à ce jour inédite, Guy Debord automythographe, soutenue en Sorbonne en 2012.
[2] Voir notamment page 300.
[3] Avec Boris Donné : Ivan Chtcheglov, Profil perdu, éditions Allia, 2006.
[4] Page 30.
[5]Vie et mort de Guy Debord : 1931-1994, Paris, Plon, 1999.



