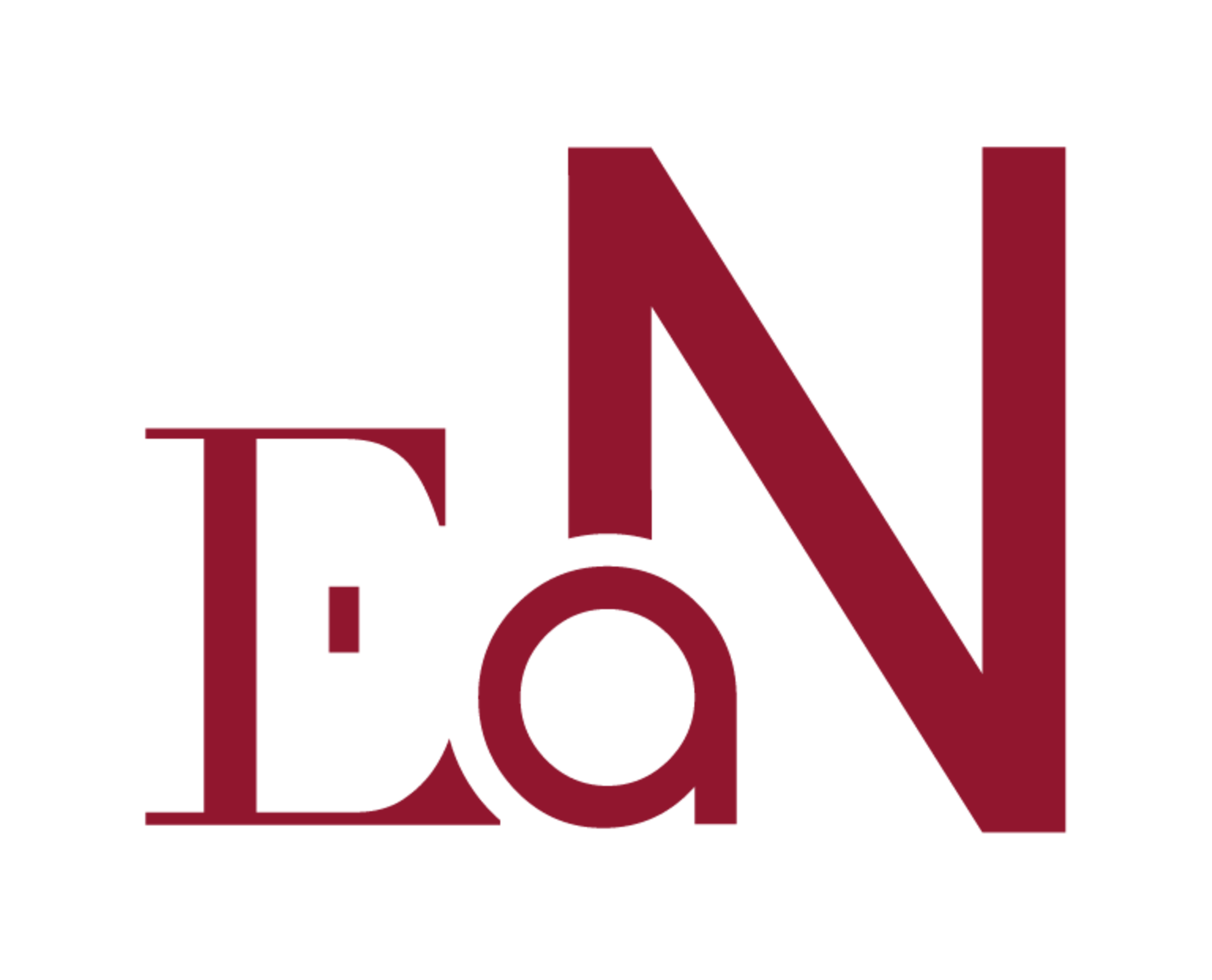Mercredi 31 octobre (Halloween)
« Sauver de plus en plus de gens, est-ce bien raisonnable ? »
12 h, scène Shayol (planète qui, dans Les Seigneurs de l'Instrumentalité, cycle classique de Cordwainer Smith, est le séjour infernal de condamnés transformé en banque d'organes. Ce choix de nom n'est pas anodin : de nombreuses tables rondes dissèquent le transhumanisme et l'homme augmenté).
Phrase entendue au vol et qui pousse à s'asseoir et à écouter. Jean-Claude Dunyach, écrivain de S.F. : « Les dirigeants des grandes entreprises de la Silicon Valley atteignant ou dépassant la quarantaine se préoccupent d'immortalité – la leur – et consacrent à la recherche sur le transhumanisme des sommes correspondant au budget d'un État africain. Actuellement un auteur de science-fiction américain fait de la pub sur Facebook pour un cocktail de médicaments. Il affirme que ça marche : il prétend n'avoir vieilli que de cinq ans en dix ans. Certains sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour ne pas vieillir. Et à transgresser la morale : aujourd'hui, le trafic d'organes provenant d'enfants africains est une réalité. Le transhumanisme donnerait nécessairement une société très différente.
Une autre question se pose : l'immortalité pour tous conduirait très rapidement à la mort pour tous, par épuisement des ressources. Nous sommes déjà dans un monde qui s'effondre sur lui-même par qu'il est surpeuplé. Médicalement, sauver de plus en plus de gens, est-ce bien raisonnable ? »
« Trop littéraire, ce n'est pas grave, mais trop religieux : non »
Steven Erikson et Patrick Couton dialoguent sur le roman du premier, que le second est en train de traduire. Rejoice. A knife to the heart narre l'intervention d'un triumvirat de civilisations extraterrestres venues sauver la Terre, y compris contre l'humanité.
Se pose la question de la traduction du titre et du sous-titre : Patrick Couton propose « Alléluia », ce que Steven Erikson trouve trop religieux. Il apprécie plus « Bonne nouvelle ». En revanche, que « Jusques au cœur » vienne de Racine ne le dérange pas.
À la question de savoir ce qui le plus difficile à traduire, la science-fiction ou la fantasy – Erikson a imaginé une série de romans remarquables, dans lesquels il utilise son expérience d'archéologue et d'anthropologue – Patrick Couton répond que pour lui, c'est la S.F., Rejoice. A knife to the heart traitant de thèmes économiques , religieux, philosophiques, géopolitiques et surtout scientifiques, dont il n'est pas familier.
Au contraire, cela demande davantage d'efforts à Steven Erikson d'écrire de la fantasy, parce que cela implique de créer tout un monde imaginaire et de réfléchir à une écriture suffisamment évocatrice pour le faire exister sans en décrire tous les aspects en détails. Tandis que Rejoice. A knife to the heart étant un roman de premier contact situé à notre époque, c'est plus facile et plus agréable à écrire.
La matière noire à l'honneur d'Halloween : « On a écarté les machos, on cherche des mauviettes ».
Depuis l'an dernier, le 31 octobre a été choisi comme Dark Matter Day. Trois physiciens des particules et un astrophysicien débattent.
La matière noire fut postulée pour la première fois par un astrophysicien suisse, Fred Zwicky, en 1933, pour expliquer que certaines galaxies ne soient pas expulsées de leurs amas malgré leur vitesse trop élevée. La théorie du Big Bang ne tient pas si on ne suppose pas qu'il y a dans l'univers 80 % de matière supplémentaire par rapport à celle qu'on voit.
Une théorie a proposée que la matière noire soit constituée de particules élémentaires non agglomérées en astres. On l'a donc cherchée. Dans des détecteurs à deux kilomètres sous terre pour se protéger de la radioactivité naturelle. Dans le LHC, le plus grand et le plus puissant collisionneur de particules du monde qui a permis de découvrir le boson de Higgs.
Comme le dit Nathalie Besson, physicienne des particules, après avoir écarté l'hypothèse des MACHO (Massive Compact Halo Objects : des astres sombres, c'est-à-dire paradoxalement des naines brunes, allez comprendre...), on cherche des « mauviettes », WIMP en anglais (Weakly Interacting Massive Particule), des particules massives très discrètes.
Pour trouver les mauviettes, Nathalie Besson cherche dans son détecteur « beaucoup de Rien et un quelque chose ». Elle suppose qu'un boson de Higgs pourrait se désintégrer en paires de mauviettes, « en tout un tas de trucs, dont du Rien ». Mais les physiciens des particules n'ont pour l'instant rien vu dans leurs détecteurs. Pas du « Rien » ; « rien ».
On cherche une « colossale, ancestrale relique de l'univers primordial », mais on n'arrive pas à la voir.
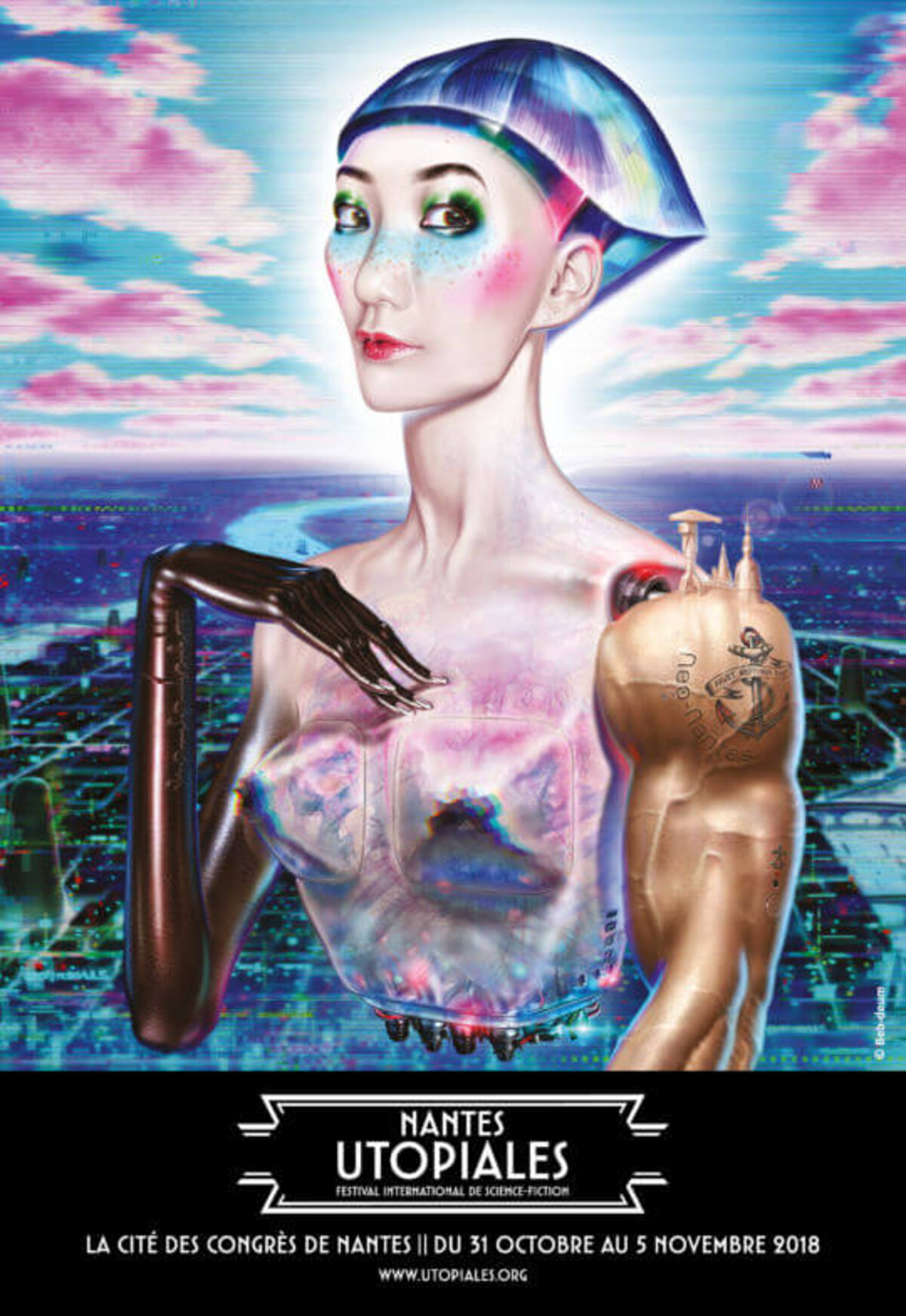
Agrandissement : Illustration 1
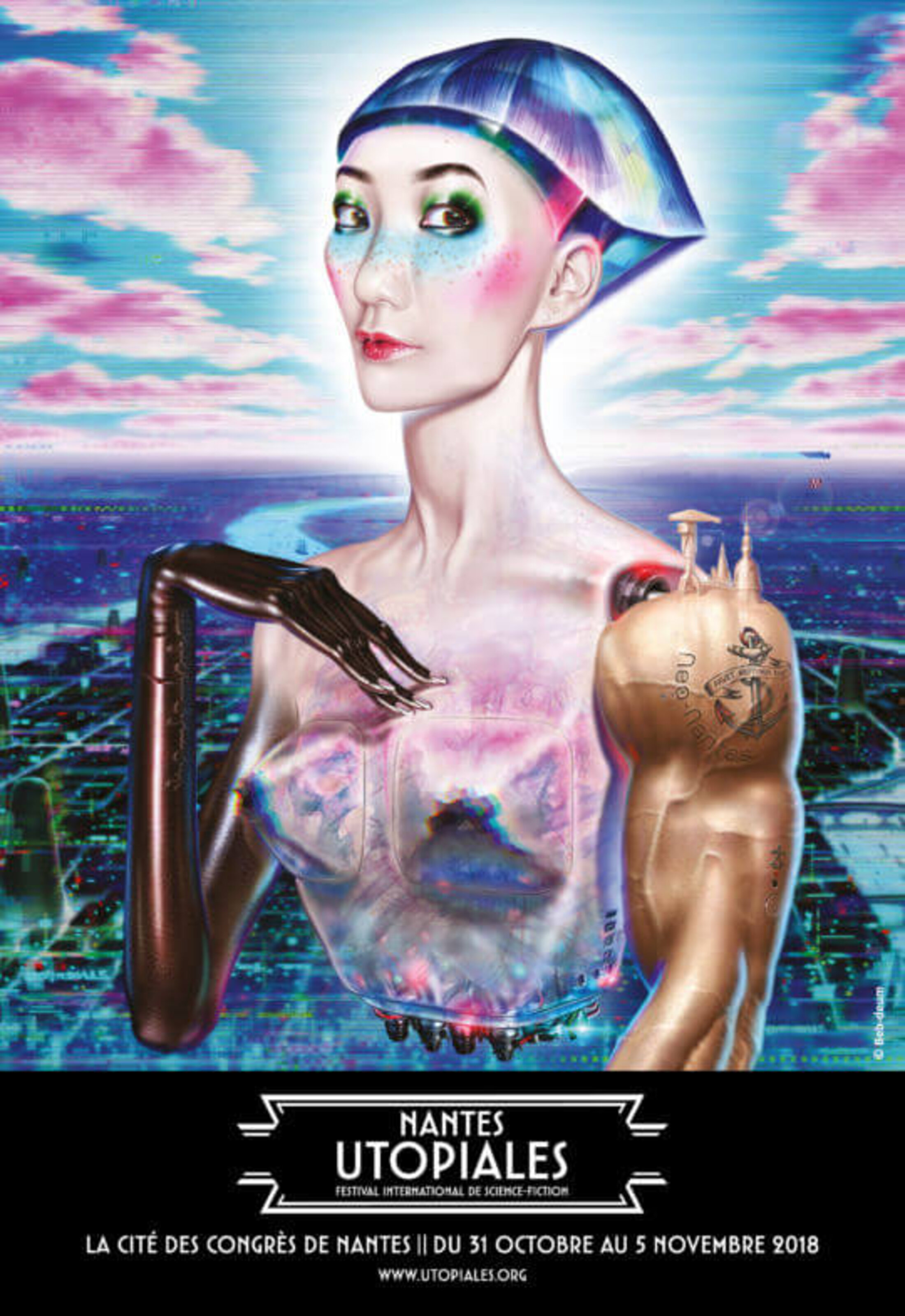
Les astrophysiciens sont donc déçus : « les détecteurs tournent dans les montagnes depuis quarante ans et on n'a rien trouvé », constate Jean-Marc Bonnet-Bidaud, cheveux blancs et chemise noire. Par conséquent, peut-être que la matière noire n'est pas la bonne piste. Elle n'existe peut-être tout simplement pas, et, pour expliquer les écarts entre la matière visible et la matière attendue, il faudrait plutôt changer la loi de Newton sur la gravitation.
C'est ce qu'a fait un astrophysicien israélien, avec la théorie MOND (Modified Newtonian Dynamics), et ça marche. Exit la matière noire donc ? Eh bien non, parce que ça ne marche pas complètement. Il faut quand même rajouter un peu de matière noire.
Au XIXe siècle, Urbain Le Verrier a deviné l'existence de Neptune uniquement grâce à l'observation de son influence sur l'orbite d'Uranus. Il a trouvé une planète qu'il ne pouvait pas voir, et qui fut effectivement observée peu après. Mais, à partir d'anomalies dans l'orbite de Mercure, Le Verrier a aussi déduit qu'il y avait une planète entre Mercure et le Soleil, il l'a baptisée Vulcain. Or, tout le monde le sait, Vulcain n'existe pas dans le système solaire. Après avoir inventé une planète au sens scientifique du terme, il l'a fait au sens de la science-fiction. Les anomalies de trajectoire de Mercure ont pu être expliquées par la théorie de la relativité générale d'Einstein.
Alors, la matière noire est-elle Neptune ou Vulcain ?
Selon les participants au débat, elle défie actuellement la démarche scientifique parce que son existence ne peut être vérifiée. Les modèles sont « spéculatifs », ils pullulent, les physiciens des particules parlent de « jungle de modèles », « d'univers à la limite entre science et S.F. ». Et Dominique Thers conclut : « On manque de S.F., d'un œil neuf ».
Jean-Marc Bonnet-Bidaud note que les modèles comme le Big Bang, ou la théorie des cordes sont des « représentations mentales », susceptibles de laisser plus tard la place à d'autres. Des « représentations mentales », n'est-ce pas la définition de l'œuvre d'art donnée par Léonard de Vinci selon Vasari : « una cosa mentale » ?
Fascinante impression de voir s'élaborer des œuvres de fiction à l'échelle de l'univers parce que, à un moment donné, c'est le seul moyen d''expliquer l'univers tel qu'il est – ou au moins tel qu'on le voit.
« Survivre est un boulot comme un autre : laborieux, répétitif, solitaire »
La journée se termine sur le très étrange film du canadien Justin McConnell, Lifechanger (2018, non encore sorti en France).
Son « héros », sous peine de se décomposer, est obligé de régulièrement vampiriser des gens de rencontre. Il prend leur apparence, mais aussi leurs souvenirs, leur voix, leurs attitudes, etc. Tout en restant lui-même, il devient aussi eux. Il est donc joué par plusieurs acteurs et actrices, tous excellents, mais reste cohérent grâce à leur jeu et à une voix off
Son corps pourrissant de plus en plus vite, toute son énergie doit être consacrée à chercher de nouveaux hôtes et surtout à faire disparaître discrètement leurs cadavres desséchés.
Parcours d'un serial killer par nécessité, éminemment solitaire puisqu'il ne peut partager son histoire, et que ses rencontres finissent toujours mal, Lifechanger est filmé presque uniquement en plans serrés, au plus près des corps. Une musique lancinante marque l'obsession funèbre du personnage, hanté par son déclin physique.
Celui qui pourrait n'être qu'un brute monstrueuse, sans être rendu sympathique – ce qui est plutôt bien – conserve son humanité par son amour pour une femme. Sous ses multiples identités, il la retrouve au comptoir du même bar, pour une scène de séduction toujours recommencée. Ce qui prend la forme d'un supplice de Sisyphe ou de Tantale confère au film une mélancolie remarquable. Avec peu de moyens, Justin McConnell fait de celui qui se rattache lui-même aux skinwalkers, aux changeurs de peaux », du folklore amérindien, un héros tragique pour qui la fin sera une amère expérience.
À la sortie de la Cité des Congrès, je croise un cortège de manifestants masqués qui me tendent des photos de vaches sanglantes surmontées du slogan : « Halloween, c'est tous les jours pour les animaux ». Et pour les skinwalkers.
Sébastien Omont
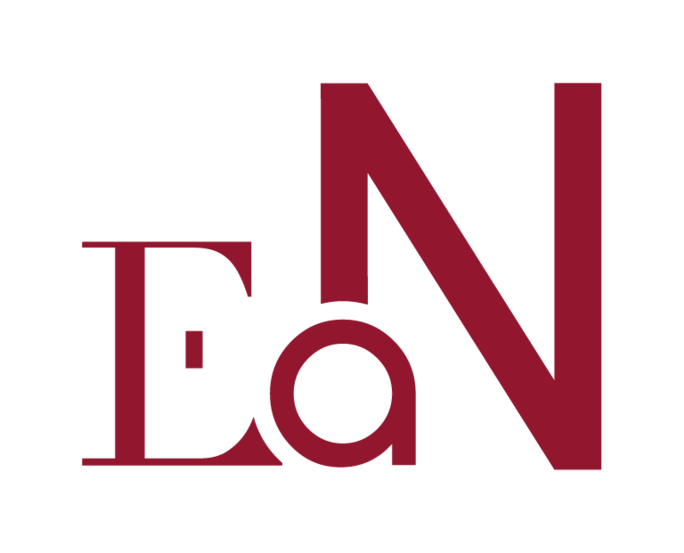
Agrandissement : Illustration 2