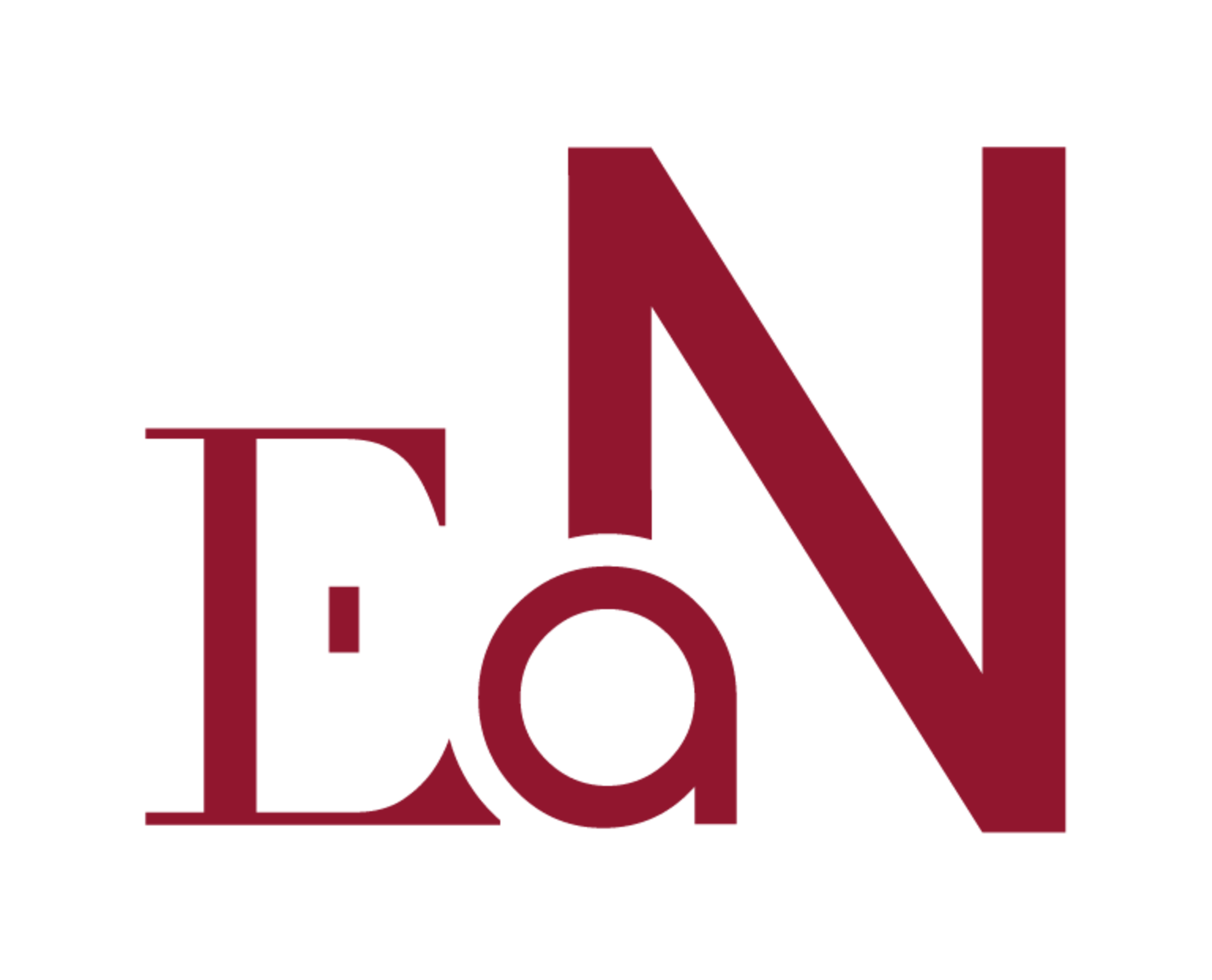Dans un article de fond Pascal Engel s’interroge sur la distinction entre l’esprit et le cerveau, entre « matière et mémoire », pour reprendre la formule bergsonienne. Les progrès impressionnants des sciences cognitives rendent-ils sans validité les interrogations spiritualistes ? Et à quelles fins ? Que deviennent les « valeurs de la raison » ?
La science conçue comme une exaltante aventure intellectuelle, voilà ce que Maurice Mourier retient du livre de Carlo Rovelli sur L’Ordre du temps. Il plaide à cette occasion pour la « vulgarisation » intelligente, pour une science « populaire », pour reprendre le terme du XIXe siècle.
Mais faut-il faire de la science la norme de toute connaissance ? Introduire dans les sciences humaines une scientificité inédite fut, un moment, l’ambition du structuralisme. La correspondance entre Lévi-Strauss et le linguiste Roman Jakobson nous fait pénétrer dans ce que Marc Lebiez appelle « l’atelier de la pensée », en redonnant sa dimension à cette entreprise.
Les mythes, notamment, dans l’analyse de l’anthropologue, révélaient toute leur subtilité intellectuelle. Mais nous disent-ils encore quelque chose aujourd’hui ? À quelques jours de l’ouverture du festival d’Avignon, Dominique Goy-Blanquet interroge le metteur en scène Thomas Jolly sur sa vision du Thyeste de Sénèque, qui nous fait replonger dans la violence extrême des Atrides, et son rapport à Shakespeare. « Sans une goutte de sang », dit-il.
Longtemps, face aux prétentions totalisantes de la pensée rationnelle, il fut commode d’opposer l’existence individuelle, irréductible, selon Kierkegaard. Pierre Tenne observe que la nouvelle édition de la Pléiade privilégie le Kierkegaard danois, engagé dans l’environnement culturel de Copenhague, par rapport à la riche réception philosophique en France à l’époque de Sartre, Jean Wahl et Gabriel Marcel.
Le responsable de cette édition (Régis Boyer) fut longtemps un défenseur des langues scandinaves, et son choix peut se comprendre. Il existe entre la pensée et la langue qui l’exprime des affinités qu’on ne se lasse pas de découvrir : dans un entretien avec Marie Étienne le poète Jacques Darras dit ainsi ce qu’il pense devoir non seulement à l’anglais, mais aussi aux langues du Nord de la France, à cette Picardie maritime où « coule la Maye » qui donne son nom à son œuvre : « une épopée du moi pluriel ».
J. L., 4 juillet 2018
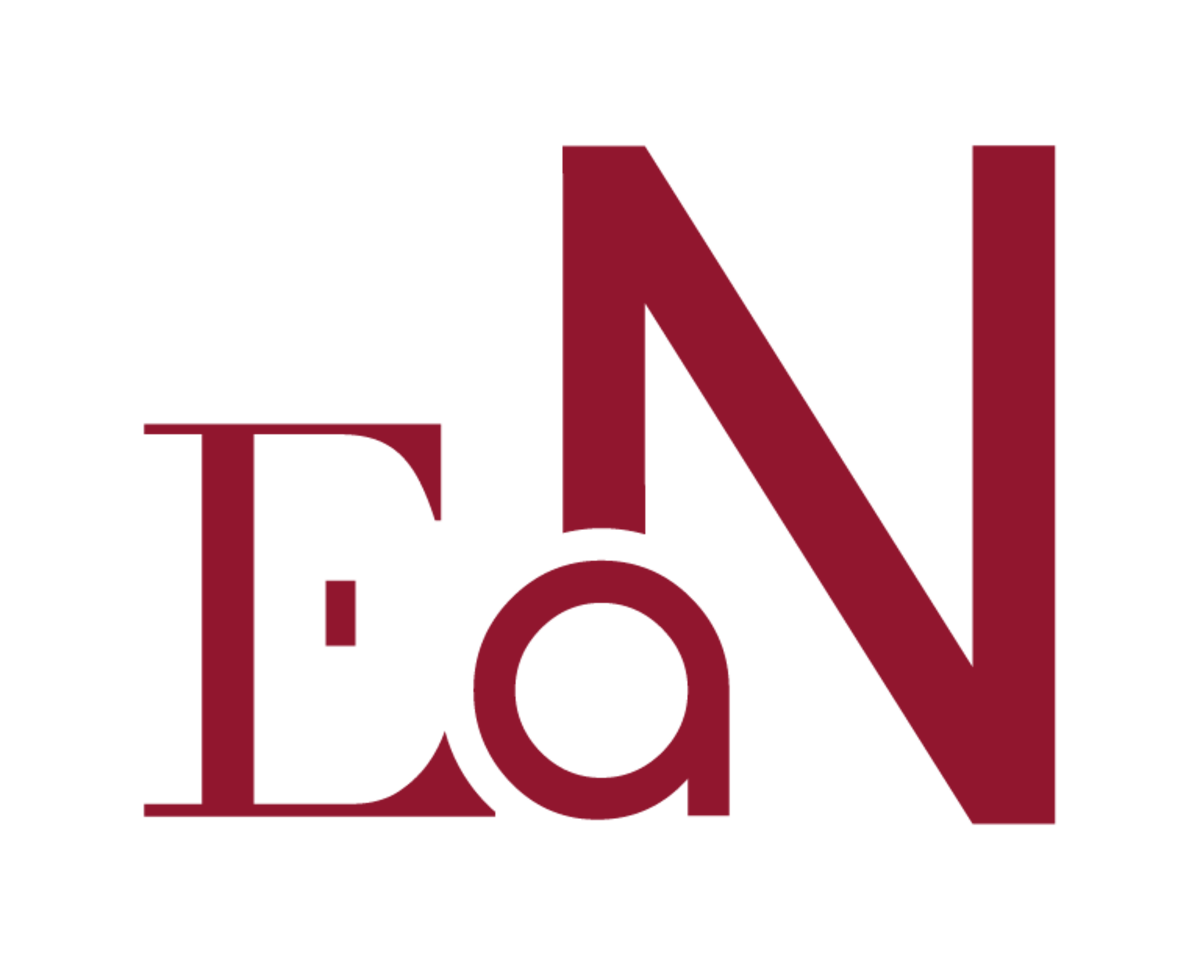
Agrandissement : Illustration 1