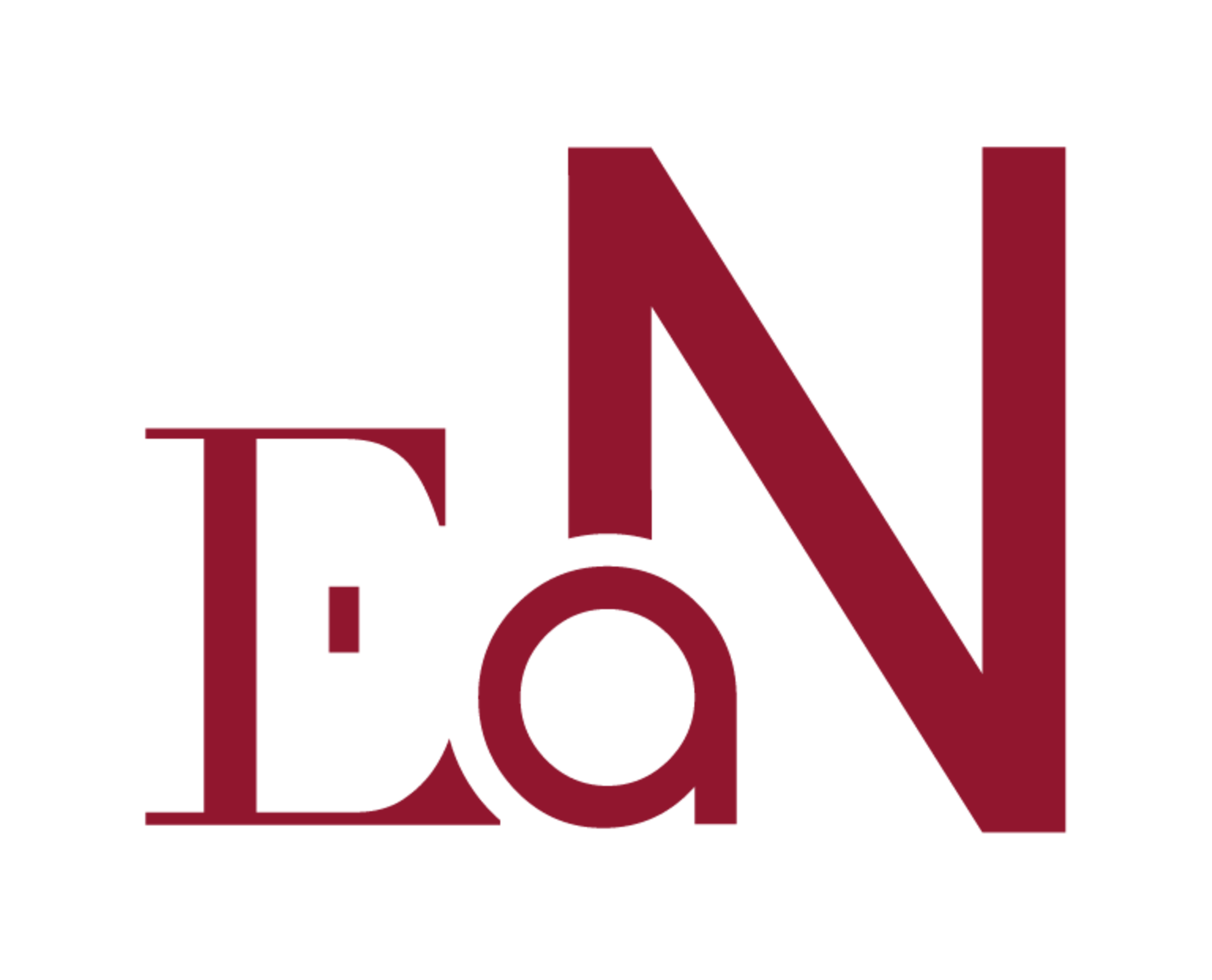Une vraie « mine » de 1.700 pages, même si elle refuse de considérer, comme les conceptrices de l’ouvrage, que « le vrai féminisme commence au XIXe siècle ». En prenant comme point de départ la Révolution française le livre négligerait les figures antérieures.
Par exemple Jeanne d’Arc ? « Bouter les Anglais hors de France »… Si ce projet a perdu de son actualité, puisqu’aujourd’hui les Anglais préfèrent quitter d’eux-mêmes le continent, la « Pucelle » – maltraitée par Shakespeare dans Henri VI – demeure en France une référence politique disputée. Dominique Goy-Blanquet revient sur le livre majeur de Gerd Krumeich, Jeanne d’Arc à travers l’histoire.
Brecht lui-même s’est intéressé à « Jeanne Dark », dans Sainte Jeanne des abattoirs, sombre évocation d’une grève dans les abattoirs de Chicago. C’est une pièce proche dans l’esprit, La résistible ascension d’Arturo Ui, que Katharina Thalbach, qui a passé son enfance au Berliner Ensemble, fait entrer à la Comédie-Française. Une œuvre classique et toujours inquiétante.
C’est au sein des familles que se joue le destin des femmes : Nathalie Skowronek, fille d’une famille juive polonaise, reconstruit l’histoire de plusieurs générations de tailleurs : ici, la couture est une raison de vivre, voire de survivre.
Charlotte Brontë anime une immense correspondance au sein d’une famille de « réfractaires, rebelles et indomptables » ; Marc Porée note cependant le fossé entre les hommes et les femmes de cette époque. Mais Charlotte sait faire preuve de patience et de confiance : « Il faudrait beaucoup plus qu’une mauvaise recension pour m’anéantir »...
Cécile Dutheil invite au contraire à lire Faire le garçon de l’écrivain suisse Jérôme Meizoz, qui, entre autres inventions, propose un petit roman sur un « gigolo », tandis que, dans ses Causes joyeuses et désespérées, Dominique Noguez, maître du contre-pied, prend la défense de François-Marie Banier dans l’affaire Bettencourt. Faut-il réhabiliter les « sigisbées » de Stendhal ? Aucune de ces finesses du langage ordinaire et des relations humaines n’échappait à Annie Saumont, décédée en début d’année. Gabrielle Napoli souligne l’importance des nouvelles de celle à qui l’on doit une traduction de L’Attrape-cœur.
Le philosophe et talmudiste Ivan Segré, s’aventure « en terrain miné », nous dit Gabriel Perez, en abordant le conflit israélo-palestinien du point de vue de la « nation » juive tandis que Jean-Paul Champseix présente, grâce au sobre récit d’ un instituteur au cœur de l’Anatolie, un rude témoignage sur la misère, l’archaïsme des mœurs et la mise au pas idéologique en Turquie.
« Parcourir le réel du sous-sol aux combles » : telle est l’ambition qu’Yves Peyré attribue à l’art défendu par Michel Thévoz, ancien directeur du Musée de l’art brut de Lausanne ; son article entre en singulière résonance avec celui de Gilbert Lascault sur Vivant Denon, le directeur des musées de Napoléon : un peu de folie et de fantasme chez cet administrateur.
J. L. 5 juillet 2017
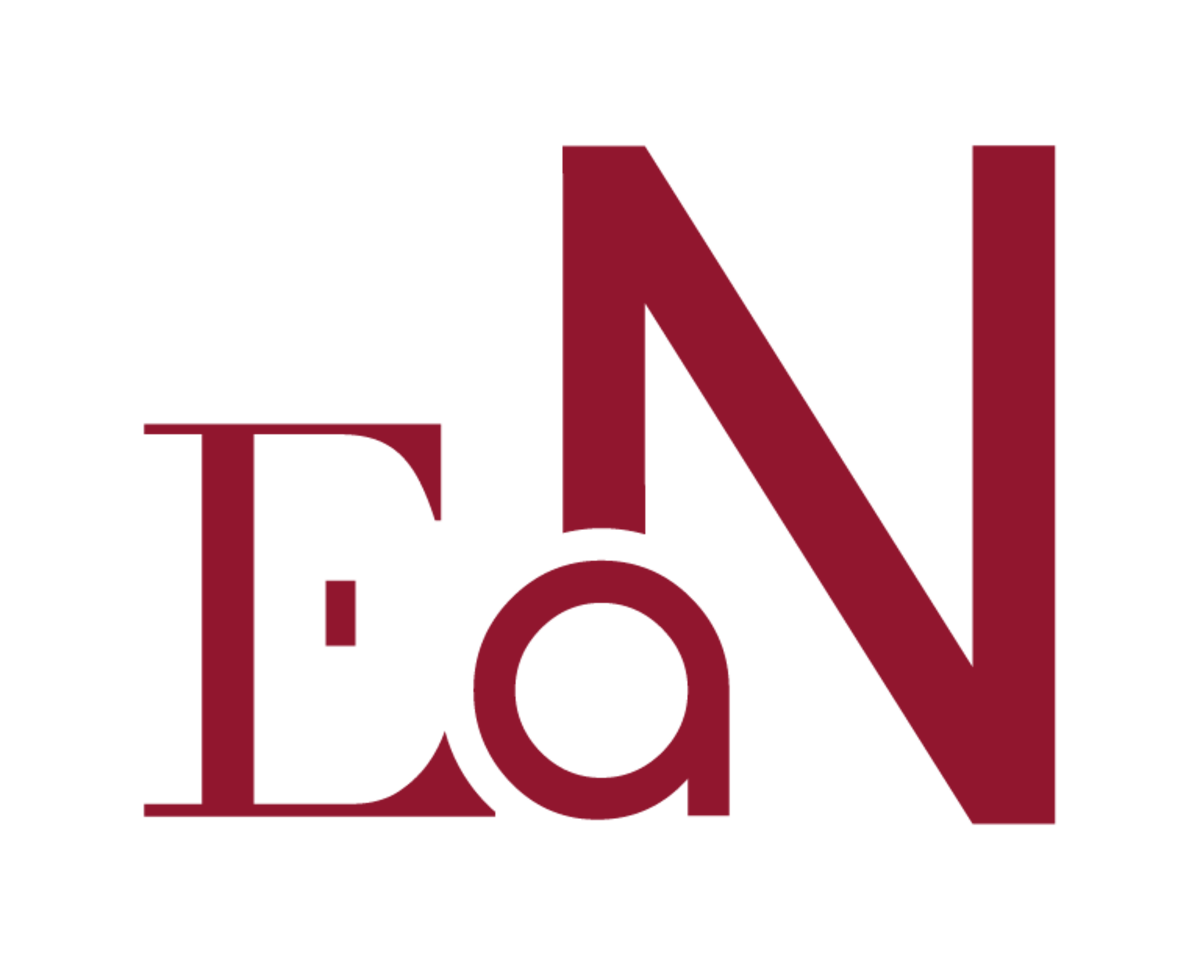
Agrandissement : Illustration 1