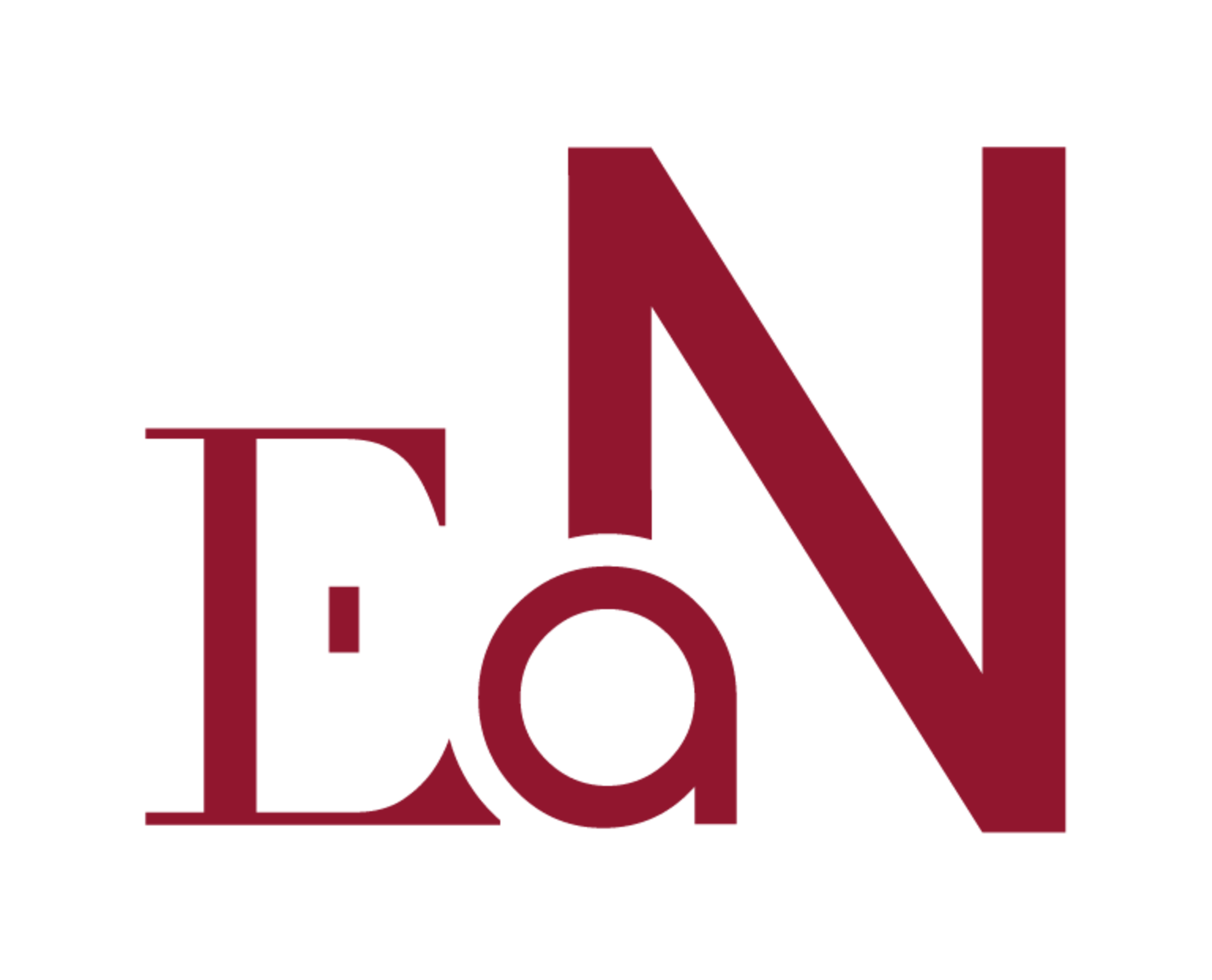Certains livres ont la vie dure. On les traîne dans la boue, ils se tiennent debout. On les réduit en cendres, ils continuent de se répandre. On les vole, ils s’envolent. On les biffe, ils se rebiffent. Il en est même qui récidivent, rusent avec le destin, paraissent, disparaissent, réapparaissent, telle cette Haggadah de Sarajevo qui a traversé les siècles, les pays, les villes, pour revenir à son point de départ, son histoire sans doute inséparable de l’histoire qu’elle raconte. Ode à l’exode…
Il n’y a pas de livre sauvé sans feu. Et feu de tout bois, en tous siècles, il y eut. Livres incendiés, frappés par la foudre, l’anathème, quand ce n’est pas une pluie d’obus qui leur tombent dessus ; livres injuriés, livres corrigés, mutilés, amputés. Et ça dure, perdure : il n’y a pas si longtemps, les autodafés nazis…
Parfois, le mal se voit, comme le nez au milieu de l’enluminure. On répare alors, on restaure, voire : on lessive, comme ces « anges de la boue » (Angeli del fango) à Florence en 1966, qui grattent le limon durci sur les couvertures, sèchent les pages une à une. Le fleuve Arno vient de sortir de son lit : 34 morts, plusieurs dizaines de milliers de familles sans abri, 61 500 volumes touchés, 22 500 coulés.

Agrandissement : Illustration 1

Mais le plus souvent, il faut s’approcher, peser, soupeser l’ouvrage, l’effeuiller, le déshabiller presque. C’est que le livre ne livre pas son secret comme ça. Voyez Le placard contre la messe (1534), quelques pouces carrés de papier dissimulés entre le cuir et la garde du Claudii Galeni opera omnia imprimé chez Cratander à Bâle en 1531 et découvert seulement en 1943. Les guerres de religion ne sont pas loin : sous la reliure, la vieille blessure de l’Histoire.
Les livres censurés forment le gros de l’exposition. Le Roi, l’Église, l’État s’en sont donné à cœur joie. Censure propre, nette, sans bavure : dura lex… et que dire de l’index ! Diderot en sait quelque chose, son Encyclopédie a failli ne jamais voir le jour, Étienne Dolet a payé sa liberté d’imprimer sur le bûcher, Les Damnés de la terre de Frantz Fanon est interdit sitôt sorti. Et puis il y a les censures personnelles, plus étonnantes, plus touchantes aussi. C’est le cas de Racine, son Britannicus, consciencieusement, savamment, délicieusement caviardé par une main anonyme : exeunt l’amour, le bonheur, la beauté, la bonté (entendez : le péché…).
C’est à la municipalité Front national d’Orange (1996) que revient peut-être la palme de la censure la plus insidieuse, la plus sournoise, grossière. Sortir des bibliothèques municipales tous les ouvrages d’inspiration progressiste, « gauchiste », mondialiste et faire entrer, à la place, des livres du cru (signés, la plupart, par des membres du FN). On ne saurait mieux résumer une idéologie : anti-tout-ce-qui-n’est-pas-nous.
Que dire encore des livres relus, revus, réécrits et corrigés par un proche de l’auteur ? Triste appropriation que celle de Nietzsche par sa sinistre sœur, antisémite notoire. Pensée coupée, découpée, faussée, dévoyée, tout y passe et c’est l’œuvre même qui faillit trépasser. L’affaire, paraît-il, n’est toujours pas close.
À qui appartient un livre ? C’est une des implicites questions que pose cette passionnante exposition. À son auteur ? À son éditeur ? À son libraire ? À son bibliothécaire ? À son lecteur ? À son éboueur ? Quelle histoire que celle de José Alberto Gutierrez, qui a trouvé son premier livre dans une poubelle d’un quartier de Bogotá : Anna Karenine… 25 000 ont suivi !
Walter Benjamin collectionnait les livres des autres : « Pour le vrai collectionneur, l’acquisition d’un livre ancien équivaut à sa renaissance. » Séparé de sa bibliothèque, il le fut comme de sa moitié, laquelle d’ailleurs, après divorce, emporta en Italie l’intégralité de sa collection de livres pour enfants. La bibliothèque de Benjamin continue de hanter plus d’un lecteur ; elle a disparu, comme lui, son corps que l’on n’a jamais retrouvé : autodafé d’une vie.
Y avait-il, parmi les dizaines de milliers de livres que Jenny Delsaux a contribué à restituer à leurs propriétaires, des ouvrages de Walter Benjamin ? Un rêve seul pourrait le dire. D’ailleurs, on ne connaît pas le visage de Jenny Delsaux, on sait qu’elle fut bibliothécaire de métier, puis nommée par André Masson à la tête de la sous-commission des livres à la récupération artistique. Elle accomplit sa mission avec la plus extrême diligence : sauveuse dans l’âme.
Ces noms, ces visages, ces métiers, Yann Damezin, un jeune illustrateur, les sauve à son tour, dans d’étranges et envoûtantes images, pleines de couleurs et de vie, des couleurs de la vie. Chaque dessin est comme un miracle de geste préservé, un mirage aussi : le sauveur sauvé. Yann Damezin, comme Katie Paterson et sa « Future Library », comme Marta Minujín et son installation « The Parthenon of Books », font partie, sans nul doute, des artistes-sauveurs des livres de demain.
L’exposition s’achève par où elle commence : les écrivains. Sylvain Tesson et sa bibliothèque de secours, Giorgio Van Straten et son Livre des livres perdus, Jacques Roubaud et son Grand Incendie de Londres, fragile monument d’écriture(s). De l’écrivain sauvé à l’écrivain sauveur, la boucle est bouclée, le livre peut enfin respirer. Et l’on se dit qu’il est peut-être maintenant, et pour longtemps, hors de danger.
Signalons, en outre, le remarquable livre qui accompagne l’exposition, illustré, documenté juste comme il faut, avec, notamment, un texte inédit de Kamel Daoud, que l’on dira « osé » : « Textures, ou comment coucher avec un livre ». (Bibliodyssées, 50 histoires de livres sauvés, Actes Sud, collection Imprimerie nationale/Arts du livre, 224 p., 29 €)
L’odyssée des livres sauvés, musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, Lyon, jusqu’au 22 septembre 2019
Roger-Yves Roche
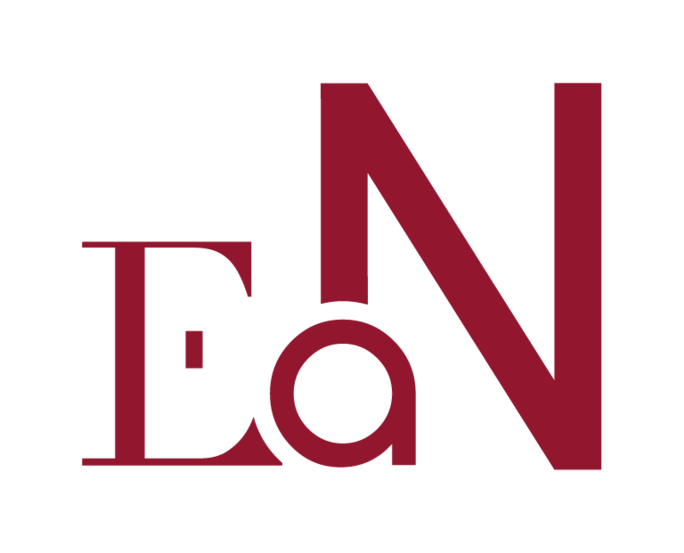
Agrandissement : Illustration 2