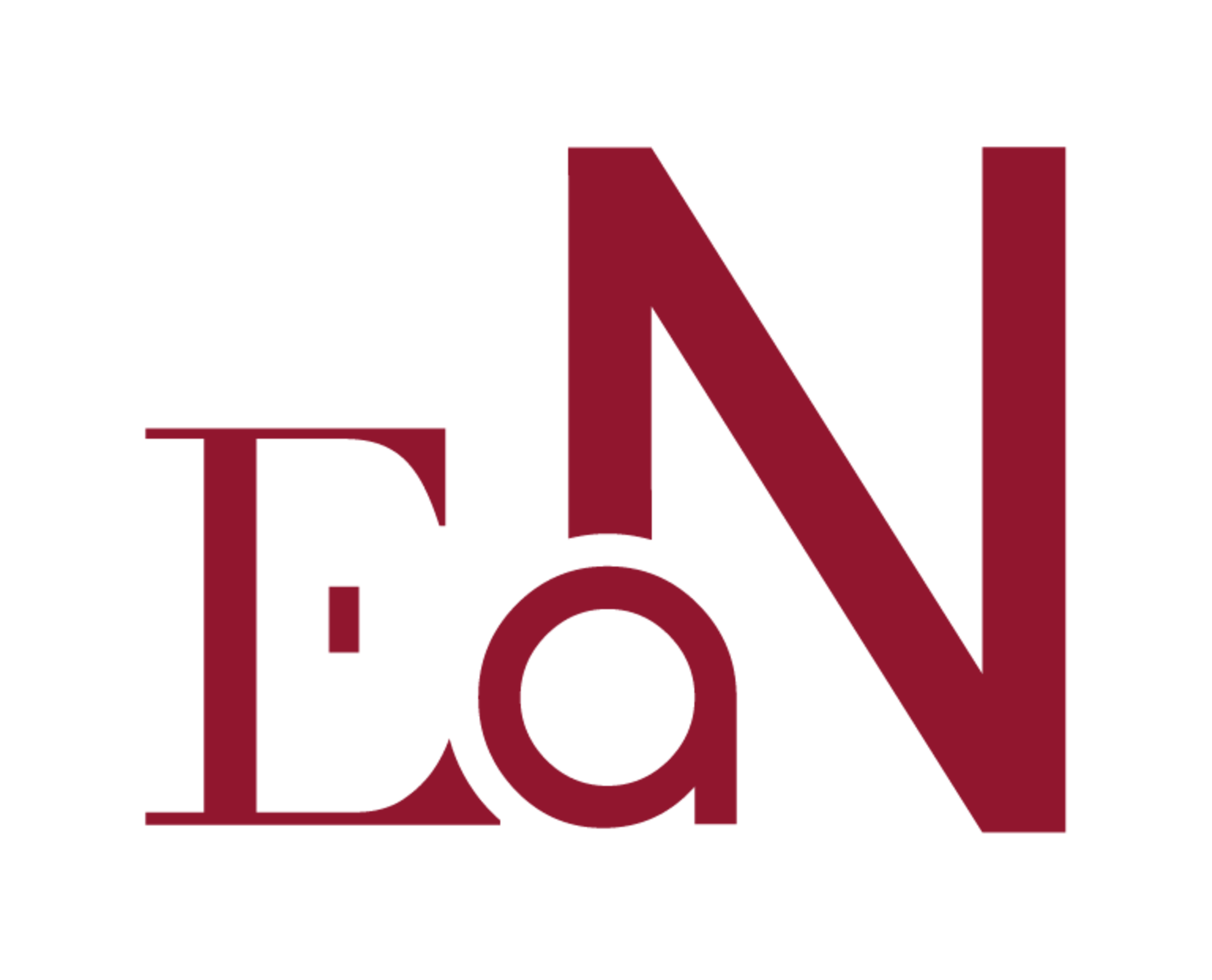Agrandissement : Illustration 1

Le CEA, l'Inserm et l'Inra sont partenaires du festival. Comment le lien entre science et science-fiction qui est caractéristique des Utopiales s'est-il constitué ?
Ce lien est caractéristique de la science-fiction, qui est née d'auteurs européens fascinés par les progrès scientifiques et techniques – Verne, Wells, Poe, Rudyard Kipling... – dans un siècle, le XIXe, où progrès humain signifiait progrès scientifique.
Le terme de « science-fiction » n'existait pas à l'origine. L'écrivain français Maurice Renard avait inventé l'expression « merveilleux scientifique », avec l'idée d'une merveille envisagée scientifiquement et d'une science poussée jusqu'à la merveille. Ensuite, la science-fiction a migré aux États-Unis où elle a pris d'autres chemins plus centrés sur l'émerveillement, le « sense of wonder ». Mais le lien entre science et science-fiction est resté très fort. La S. F. pioche toujours dans la science de son temps. Dans les années 1950 et 1960, l'atome et ses conséquences : les monstres géants, les radiations... Aujourd'hui, ce serait plus les manipulations génétiques, l'intelligence artificielle ou les soucis liés au numérique. Qu'on ait de la science dans un festival de science-fiction, n'est donc pas scandaleux, ne serait-ce que pour éclairer la science présentée dans les œuvres.
L'idée n'est pas de détruire une œuvre de fiction au prétexte que la science y serait maltraitée ou évoquée de manière imparfaite, mais plutôt de reprendre les thèmes scientifiques qui sont derrière les œuvres et de présenter l'état de la science actuelle, de préciser ce qui est impossible, difficile, plausible ou correct. De lever les ambiguïtés. Car les livres ou les films de fiction dégagent une émotion, une force, qui frappe beaucoup plus qu'un froid rapport technique sur le même sujet, ils peuvent donc aussi nourrir des fantasmes, des idées fausses.
Mais le plus intéressant, à mon avis, est de se pencher sur les question soulevées par le traitement dans la science-fiction du progrès scientifique. On le voit très bien avec des œuvres classiques de la SF, comme Le Meilleur des Mondes. Dans un monde où on est maintenant capables de faire des utérus artificiels et des expériences génétiques sur des embryons, les questions que pose Huxley dans son roman et les réponses qu'il y apporte – qu'est-ce qu'un monde où on est capable d'élever les humains en batterie et de les manipuler génétiquement dès l'embryon pour en faire des catégories distinctes ? – prennent une nouvelle force : veut-on vraiment des utérus artificiels ? La réponse ne va pas de soi. C'est la même chose pour tous les éléments techniques qu'on met dans notre corps. De l'homme réparé, on arrive vite à l'homme augmenté, puis à l'homme transformé. Se pose alors le problème d'une humanité à deux vitesses : ceux qui ont les moyens de se payer la technologie, et les autres. L'intérêt de tous ces questionnements est de se préparer à, ou idéalement éviter, des mondes non-désirables. D'une certaine façon, la science-fiction a un rôle de vigie.
Donc, pour des raisons historiques, et parce que l'humanité se transforme avec les techniques qu'elle invente, et qu'il est donc indispensable de les comprendre, il est à mon sens impossible de faire un festival de science-fiction sans éléments scientifiques.
Les Utopiales restent évidemment avant tout un festival de science-fiction. Mais avec des éclairages par la science.
Que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui certains des auteurs les plus intéressants de la SF, Peter Watts, Ken Liu, Liu Cixin, Greg Egan, écrivent de la Hard science, de la science-fiction exploitant de vraies théories scientifiques, comme l'intrication quantique, etc. ?
Greg Egan ou Peter Watts ont de solides formations scientifiques. Ils poussent la science dans ses retranchements, jusqu'à faire apparaître la merveille, l'extraordinaire. Dans la nouvelle « L'Histoire de ta vie », qui, adaptée au cinéma, a donné Premier Contact, Ted Chiang pousse à fond deux idées scientifiques : l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui soutient que notre cadre linguistique conditionne notre représentation du monde, et le principe de Fermat, un point de physique très précis. La combinaison des deux permet de créer des extraterrestres avec une perception du temps radicalement différente de la nôtre. L'ensemble donne une histoire d'une force incroyable.
Parfois, dans la Hard science, la science est mise trop frontalement en avant. La grande force des auteurs que nous avons cités, est de vraiment utiliser les sciences pour en faire une histoire humaine. Qu'est-ce que les extraterrestres, sinon des humains bizarres, d'autres humains ?
Il y a aussi des auteurs qui ont su ancrer leurs histoires dans l'Histoire. Serge Lehman, qui a une formation d'historien, a créé dans ses récits des liens très longs entre le passé et un monde futur.
On vit aujourd'hui au milieu de la science et de la technique. Sans qu'on s'en rende vraiment compte, elles nous forgent. On transforme, on déforme aussi notre monde avec la technique – il n'y a qu'à voir les problèmes climatiques et énergétiques. Donc l'interaction humanité-technique est fondamentale. Qu'elle soit questionnée par des gens qui savent de la science et qui veulent en utiliser des extrapolations plausibles pour rendre leur récit crédible, je trouve ça très fort. On essaie de garder aux Utopiales ce mélange, entre la science-fiction et les sciences molles et dures, ou, comme je dis, les sciences humaines et inhumaines.
Pourquoi avez-vous choisi le thème du corps pour cette édition ? Est-ce lié au fait qu'on parle de plus en plus du transhumanisme ?
C'est incontestablement un thème majeur de la science-fiction. Quand nous choisissons un thème, nous nous donnons plusieurs contraintes. La première est que le mot doit être suffisamment polysémique pour englober beaucoup de science et de science-fiction. « Le robot » serait un thème très fort, mais qui exclurait plein d'œuvres intéressantes, tandis qu'avec « Le corps », on peut aussi parler de robots.
Ensuite, nous avons aussi des contraintes externes parce que nous essayons d'intégrer Les Utopiales à l'écosystème culturel nantais. Si un événement culturel ou scientifique nantais est important, c'est assez logique que Les Utopiales y fassent écho. Par exemple, l'année dernière le thème du temps a été choisi, d'abord parce que c'était un bon thème de science-fiction, et deuxièmement parce qu'après deux ans de rénovation complète, le Muséum d'Histoire naturelle inaugurait sa nouvelle exposition permanente sur le thème de l'« Éternité ». Nous sommes en lien étroit avec Philippe Guillet, son directeur. Il y a d'ailleurs cette année aux Utopiales une exposition organisée par le Muséum, « Post Mortem et au-delà ».
L'année précédente, le thème était « Machines » parce que, la même semaine, se tenait à Nantes un grand colloque international sur les énergies de demain, notamment l'hydrogène. Un thème « Énergie » aurait été trop restrictif, mais « Machines » permettait de faire le lien. Dès ces deux années-là, je voulais faire « Le Corps », mais il m'a semblé de le repousser pour favoriser un écho avec la culture et la science de la grande région nantaise.
Le fait que Les Utopiales se déroulent à Nantes apporte-t-il quelque chose de particulier au festival ?
Je trouve positif que le festival ne se déroule pas à Paris, où il y a un bassin de population plus important, mais aussi, en raison de nombreux événements géniaux, un bruit médiatique beaucoup plus grand. Les Utopiales ont un retentissement très fort dans la région nantaise, dont environ 60 % du public est originaire.
On ne pourrait pas non plus tenir le festival dans une trop petite ville, où on serait obligé de tout importer de Paris. Le terreau scientifique et technique important à Nantes et dans toute sa région est essentiel. Des partenariats, des échanges, des invitations se font avec les scientifiques locaux des universités, de certaines entreprises, de l'Inserm. Beaucoup d'invités viennent de la région, même si Les Utopiales restent un festival international. Et ça permet aussi à d'autres gens de venir à Nantes, qui n'est qu'à deux heures de Paris. Par ailleurs, c'est la ville de Jules Verne.
Le transhumanisme, la révolution numérique, le rôle majeur des entreprises dans l'avancée scientifique au détriment des États... Les magnats de la Silicon Valley ont-ils tout piqué à William Gibson ? Sont-ils de mauvais auteurs de cyberpunks ?
Le cyberpunk est un genre tout à fait pertinent pour lire notre monde d'aujourd'hui. La science-fiction ne cherche pas à faire de la prospective, de la numérologie, de la divination. C'est un mode de discours sur le futur dans lequel il y a de l'imagination, de la subjectivité propre à l'auteur ou à l'autrice. La science-fiction ne cherche pas à faire une grande théorie du monde, mais le corpus de toutes les œuvres donne des idées sur ce qui est en train de se passer. Elle est la seule littérature qui s'intéresse explicitement aux conséquences du progrès scientifique et technique sur les humains. Dans la SF, la technologie sert de moteur à l'intrigue et même de déterminant à la façon dont les humains vivent. Tous les autres genres n'utilisent la technologie que comme décor. Le téléphone portable remplace le téléphone fixe, mais au fond rien ne change.
Le cyberpunk a anticipé de manière incroyable certaines évolutions. Pas internet ou les téléphones portables tels qu'ils existent aujourd'hui, mais l'idée d'une humanité en réseau. Il y a des textes étonnants contemporains des débuts de la télévision qui disent qu'on va pouvoir apprendre la plomberie avec la télévision. Or, c'est exactement ce qui se passe avec Wikipédia ou YouTube. L'idée était là. La possibilité de se faire réparer la jambe par une prothèse intelligente engendre tout de suite l'interrogation de savoir s'il y aura des gens qui voudront se faire couper la jambe volontairement pour la remplacer par un appareil supérieur à la jambe humaine. La science-fiction, ce n'est pas les bisounours, elle a toujours tendance à poser les questions qui font mal. De ce point de vue, c'est un genre génial.
Est-ce important que, dans la science-fiction, la science soit bonne ?
Non, ce n'est pas parce que la science est bien traitée que l'œuvre sera réussie. L'idée qui se trouve derrière est plus importante. La science est parfois maltraitée à juste titre, pour des raisons de narration – c'est plus visible au cinéma. Dans Sunshine, le soleil s'éteint. On envoie donc une expédition le rallumer à coup de grosses bombes nucléaires, ce qui est parfaitement grotesque du point vue astrophysique. Mais si on supprime cette idée, le film n'existe plus.
D'autres fois, l'histoire aurait été exactement la même avec de la bonne science. Par exemple, pour protéger un vaisseau spatial qui s'approche du soleil, on lui met à l'avant un bouclier thermique comme celui des capsules des astronautes, ce qui est absurde. Pour se protéger de la chaleur du soleil, provoquée par sa lumière, il aurait fallu mettre à l'avant du vaisseau un miroir. Cela n'aurait rien changé à la narration, le bouclier-miroir aurait été très beau, et il aurait montré que les auteurs avaient vraiment réfléchi à ce qu'ils faisaient. On peut être un peu déçu, même si ce n'est au fond qu'un détail pour scientifiques.
Propos recueillis par Sébastien Omont
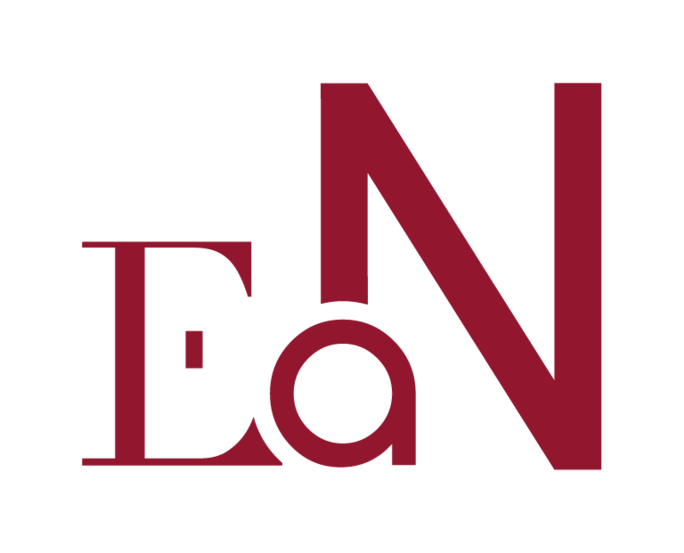
Agrandissement : Illustration 2