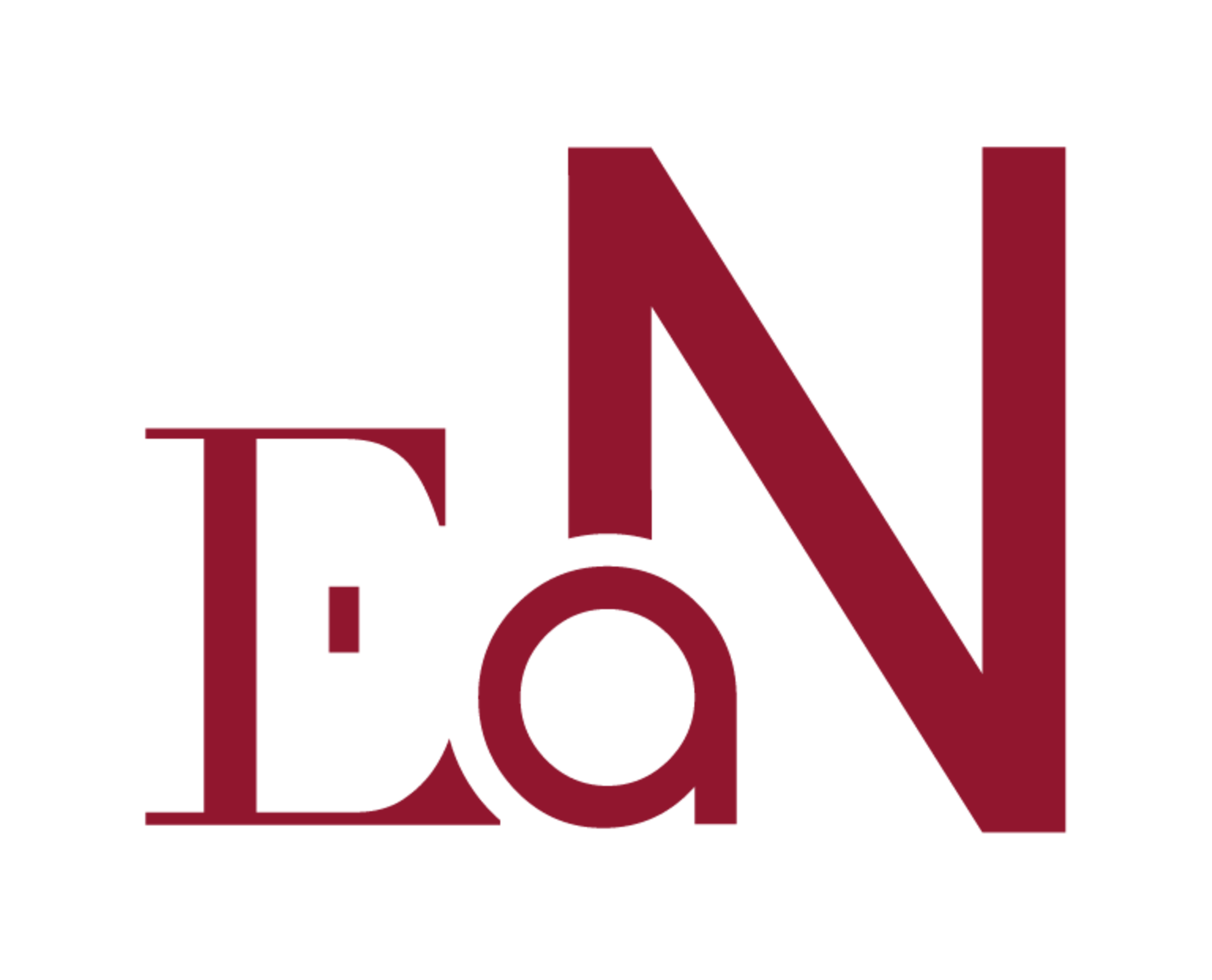Ainsi « le curieux – nous dit Linda Lê à propos d’un livre de Lázló Krasznahorkai – est projeté dans un monde où il entre avec la perplexité de celui qui est à la fois subjugué et désorienté, tant le troublent les perturbations auxquelles il s’expose ».
C’est l’adolescence qui est au cœur de L’éveil du printemps, la pièce de Frank Wedekind montée à la Comédie-Française et, selon Monique Le Roux, le metteur en scène, Clément Hervieu-Léger, assume à bon droit l’héritage de Patrice Chéreau ; ce n’est pas un hasard si l’un des jeunes gens fait au public « une adresse presque shakespearienne ». Dominique Goy-Blanquet souligne, en lisant le tome 1 du Journal de Chéreau, alors metteur en scène débutant, l’importance toujours plus grande de la relation à Shakespeare dans le cheminement politique et dramaturgique du metteur en scène.
L’île de la Tempête malgré sa sorcière, garde quelque chose de paradisiaque, comme un nouvel Éden ; de fait un jardin, quelle qu’en soit la configuration, est, pour Marco Martella, lu par Édith de la Héronnière, « un petit monde, un monde parfait », à la fois vital et menacé.
« O brave new world » : la formule est devenue synonyme de dystopie depuis le roman d’Aldous Huxley : Pascal Engel regarde en philosophe le dernier film de Wes Anderson, L’île aux chiens, dans lequel un jeune garçon veut sauver son chien de l’Enfer d’une île-dépotoir.
Quelle est donc cette si « belle humanité » qui enthousiasme Miranda ? Thierry Bonnot revient sur l’histoire méconnue du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, l’œuvre conjointe de Paul Rivet et Georges-Henri Rivière, dans les « années folles », à la grande époque de « L’Espèce humaine ».
Après avoir évoqué en 2008 les lynchages du Sud – le strange fruit de Billie Holiday – l’historien Joël Michel s’est intéressé à la place des pauvres Blancs dans la colonisation de l’Afrique. Ce déplacement original de problématique conduit Maïté Bouyssy à saluer un travail puissant, ambitieux, appelé d’emblée à devenir un classique.
Mais, au-delà de l’esclavage et de la colonisation, au-delà de Caliban, qu’en est-il de la notion moderne de servitude ? Christian Laval (dans un article de Pierre Tenne) confronte deux lectures concurrentes du « néolibéralisme », celles de Bourdieu et de Foucault ; Thibault Le Texier (dans un article de Philippe Artières) établit le « mensonge » de la fameuse expérimentation de psychologie de Stanford.
Ossip Mandestam fut, presque contre son gré, le « polisson » qui a défié Staline, mais cela ne doit pas faire oublier le poète. Odile Hunoult, à l’occasion d’une édition monumentale de l’œuvre, traduite par Jean-Claude Schneider, redonne sa vraie dimension au poète, lecteur de Dante.
J. L., 9 mai 2018
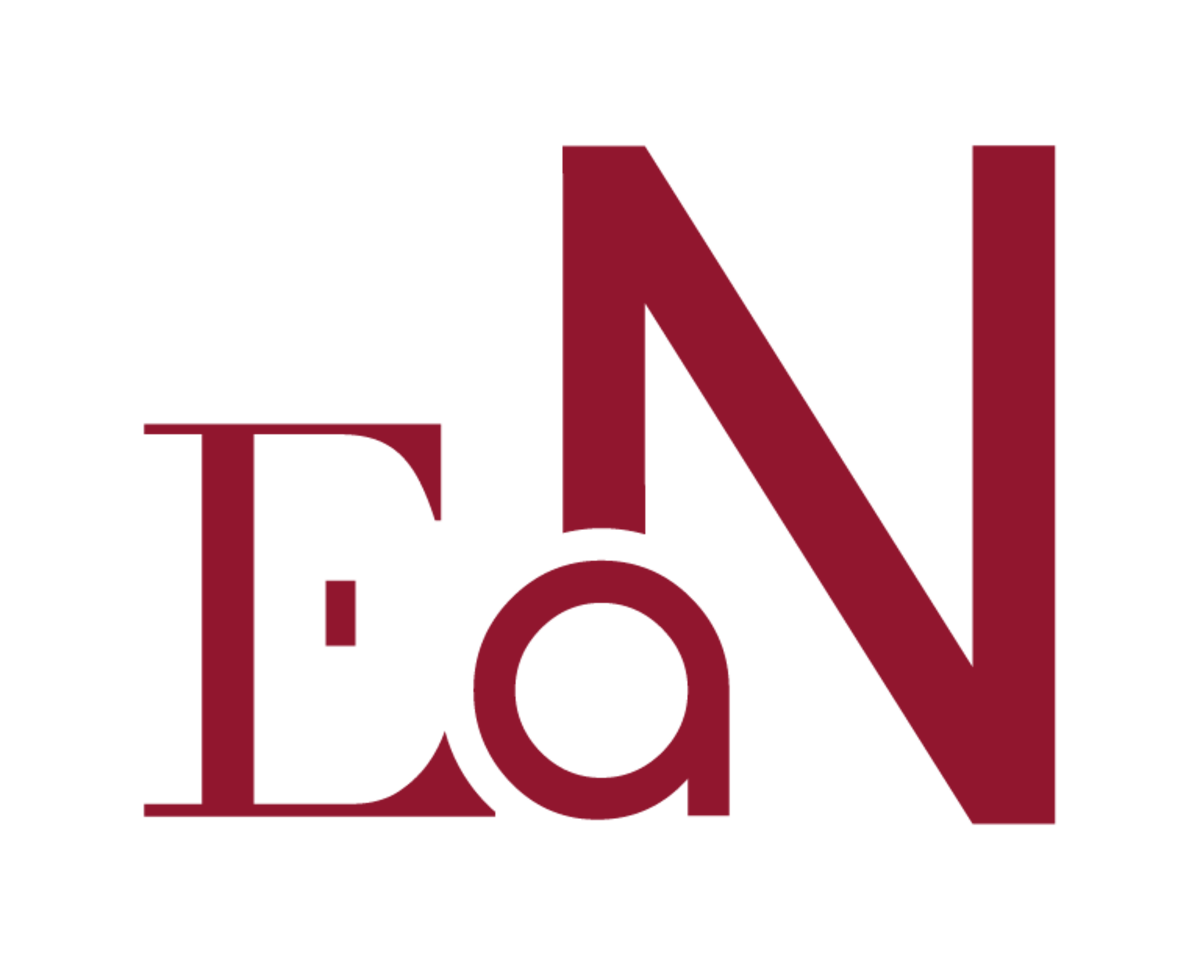
Agrandissement : Illustration 1