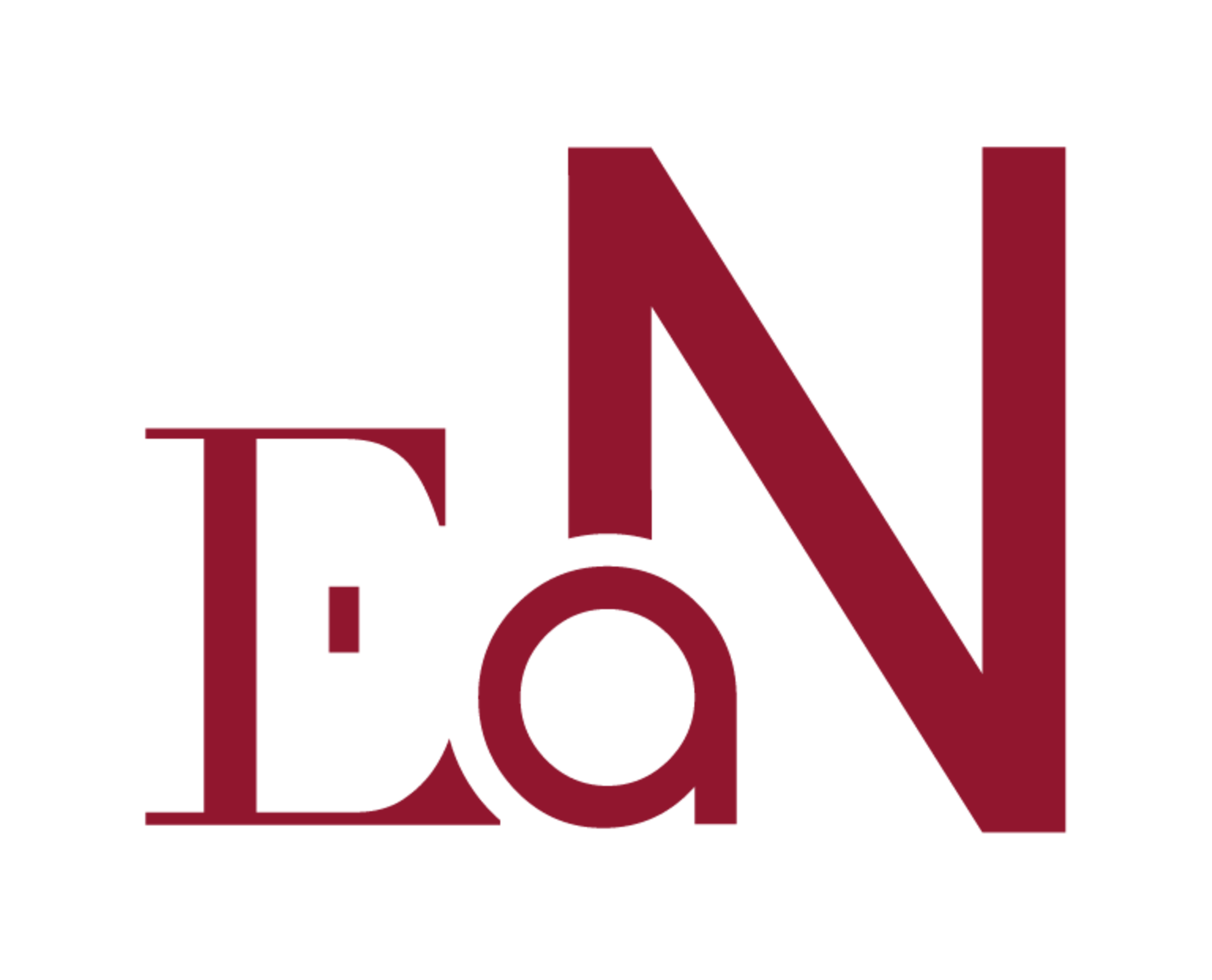La rapide disparition de l’Empire des tsars comme l’effondrement imprévu de l’URSS stalinienne ont apporté un démenti à cette prophétie d’un lecteur averti de Dostoïevski. Qu’en sera-t-il dans le futur ?
L’invitation à Paris vaut en tout cas, on imagine, moins pour le régime autoritaire en place que pour cette splendide et vivante culture millénaire, philosophique, littéraire, poétique dont EaN offre quelques échantillons à cette occasion : une brassée de « poèmes en prose » de Tourgueniev inédits, traduits par Christian Mouze – quelle humanité chez cet ami de Flaubert ! – ; de Christian Mouze encore un retour sur la pensée sans concession de Léon Chestov ; un article de Jean-Jacques Marie sur la figure étonnante d’Ivan Maïski, l’ambassadeur de Staline à Londres dans les années trente, une fonction risquée… ; la charmante correspondance de Nabokov avec sa femme Véra, dans la mélancolie d’un exil sur le lac Léman, loin de la langue russe ; des poèmes contemporains de Xenia Savina, inspirés par l’exil d’Ovide sur les bords de la mer Noire, et des réflexions sur le propre de la langue russe.
Mais encore ? Maurice Mourier et Tiphaine Samoyault donnent leur lecture personnelle des Misérables à l’occasion de la nouvelle édition du roman dans la Pléiade ; Steven Sampson conduit un entretien surprenant avec l’Américain Alexander Maksic, d’Hemingway à Nirvana ; Claude Grimal présente L’infinie patience des oiseaux de David Malouf, l’œuvre d’un romancier australien de premier plan qui évoque ici le sort des soldats de l’ANZAC lors de la Première Guerre ; Albert Bensoussan attire l’attention sur le roman de Fernando Aramburu consacré à la « saga sanglante » du pays basque ; Michel Plon nous décrit un Freud empêtré dans les chausse-trappes du contre-transfert tandis qu’Éric Loret s’interroge avec Noémi Lefebvre (Poétique de l’emploi) sur le surmoi des poètes. Quant à Ulysse Baratin, il trouve dans La journée de la vierge de Julie Marx un exact portrait de la précarité qui frappe les jeunes salariés.
On lira enfin l’article théorique de Maïté Bouyssy sur l’historien Hayden White, ce médiéviste qui a rabattu « toute écriture de l’histoire sur des modalités narratives, (métaphore, métonymie, synecdoque et ironie, les tropes bien connus) et interrogé la place de l’avenir dans l’étude du passé. »
J. L., 14 mars 2018.
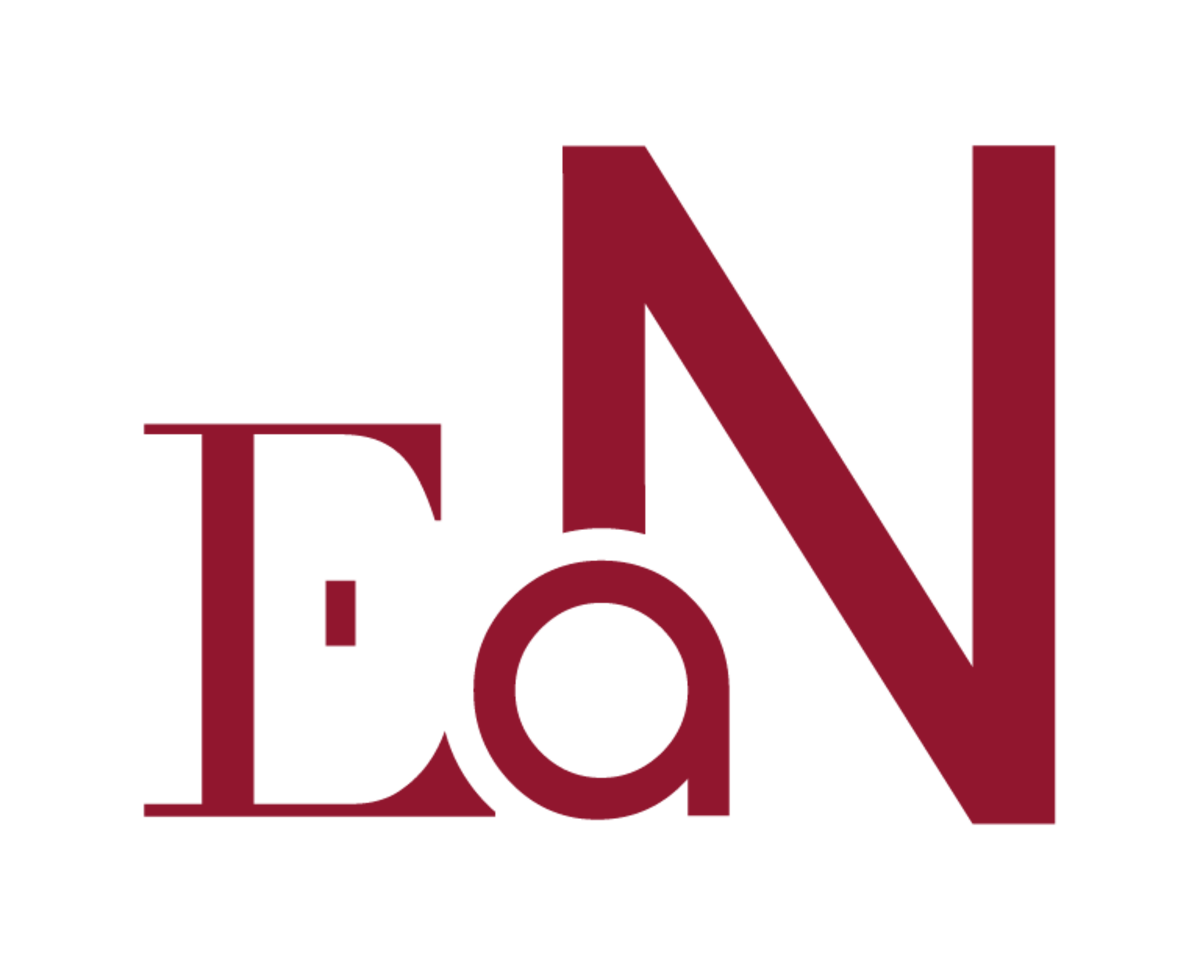
Agrandissement : Illustration 1