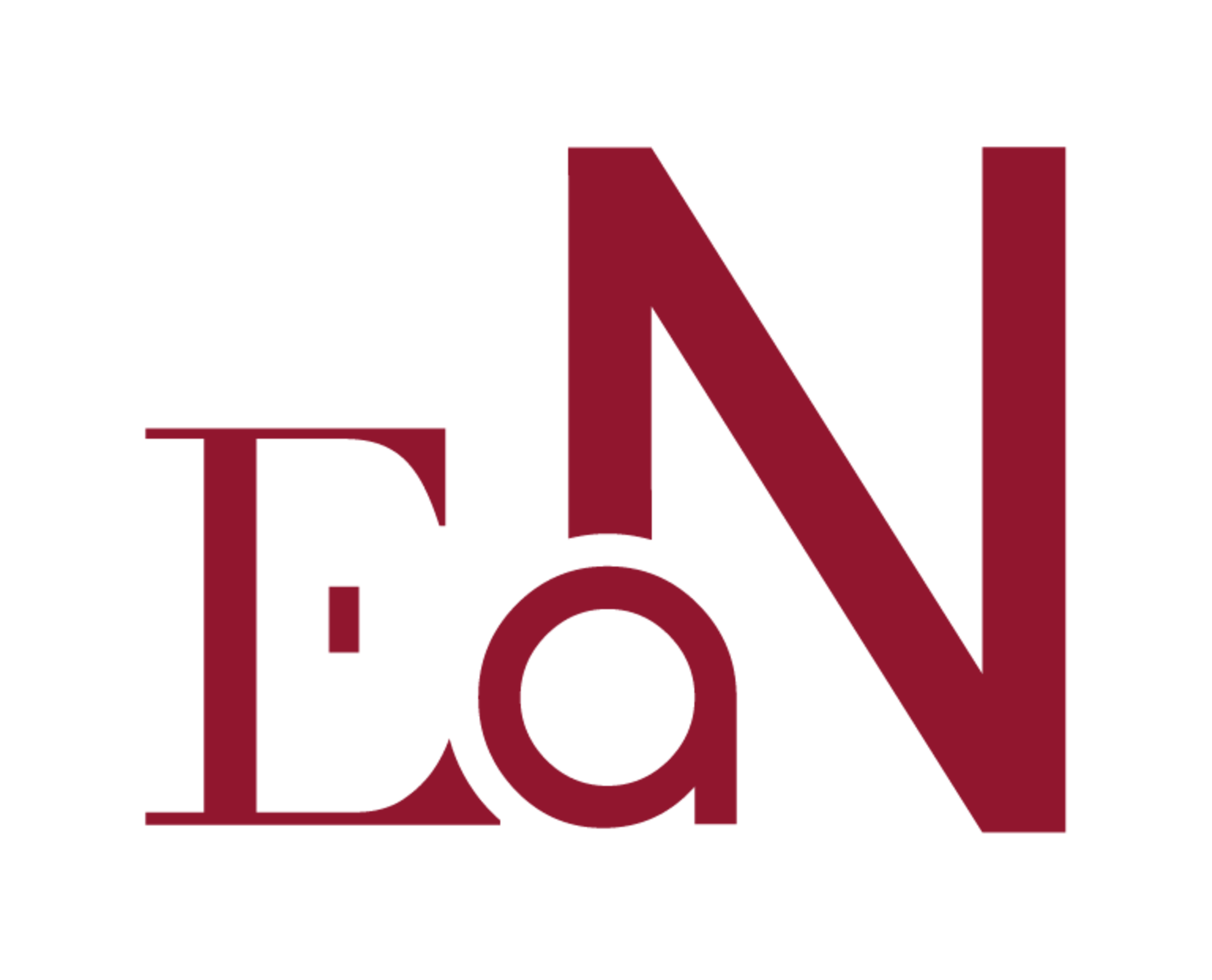La nouvelle du prix Nobel décerné à Bob Dylan a partagé notre rédaction, comme elle a partagé une bonne partie du monde, celle qui lit des livres et écoute de la musique. Parce que je me souviens de sa présence encore active dans les campus universitaires des États-Unis au moment de la guerre lancée par Bush en 2002 (où j’enseignais à ce moment-là), parce qu’il donnait une version acoustique particulièrement belle de « Masters of War » dans sa tournée de cet hiver, parce que ses chansons ont accompagné des moments importants de mon existence, parce qu’il reste politique et libre même en n’étant pas aussi actif qu’au début des années 1960 aux côtés de Joan Baez, parce qu’il est une référence que je partage avec beaucoup d’autres sans qu’il soit un produit de la culture mondialisée, je suis contente que l’Académie lui ait décerné le prix. Il y a le chant, il y a l’oralité, il y a le mineur, la culture rock devenue classique en si peu d’années, il y a la secousse et la douceur, la reprise, la réécriture, une langue anglaise que j’aime, des choses qui peuvent nous attacher à la littérature, même si on trouve aussi dans la littérature bien d’autres choses encore.
Le fait qu’il tarde à accepter son prix (ou qu’il le refuse) rappelle Sartre, mais aussi un épisode moins connu : en 1937, lorsqu’il a appris qu’il était l’heureux récipiendaire du Nobel, Roger Martin du Gard (certainement pas le plus grand écrivain du monde mais dont l’œuvre humaniste et les positions pacifistes correspondaient bien à l’idée que les jurys se faisaient de l’engagement littéraire à ce moment-là) s’est enfui dans les hauteurs de Nice : pendant deux jours, personne ne savait où il était, même ses plus proches. Ce fut, à une ère beaucoup moins médiatique, l’affolement général !
Et puis, si l’on y réfléchit, comment donner aujourd’hui un prix Nobel de littérature à un pays aussi central et hégémonique que les États-Unis ? Le jury n’a jamais récompensé ni les écrivains les plus reconnus ni les plus puissants (il y a des exceptions, mais elles sont rares). Récompenser un pays dominant et une langue dominante passe aussi par le choix d’un art décalé même s’il est rassembleur, et pour le symbole, ce n’est pas un mauvais choix.
C’est pourtant Bruce Springsteen, dont les Mémoires viennent de paraître en français, que cette dix-neuvième livraison d’En attendant Nadeau met à l’honneur ainsi que le combat d’une autre Amérique, que le folk rock des années 1960 a contribué à étendre. L’histoire des luttes noires de Caroline Rolland-Diamond nous rappelle que ce combat est loin d’être terminé.
En cette période de prix, nous mettons à l’honneur des livres sortis à la rentrée, comme Tropique de la violence de Nathacha Appanah, Boxe de Jacques Henric et L’administrateur provisoire d’Alexandre Seurat. Mais nous rendons compte aussi du dernier très beau livre de Marie NDiaye, La Cheffe. Roman d’une cuisinière. Pour la littérature étrangère, Emily Saint-John Mandel, Carlo Bonini et Giancarlo de Cataldo, Alain-Claude Sulzer… On se réjouit aussi de lire un article sur le pragmatisme et un autre sur la philosophie de l’amour, ainsi que notre chronique « théâtre ».
Au fil de la quinzaine, nous évoquerons, 60 ans après, la révolution de 1956 vue par les écrivains hongrois, le dernier livre d’Hubert Damisch sur la peinture, mais aussi La Science en cuisine et l‘art de bien manger de Pellegrino Artusi. Pour tous les sens, donc.
T.S., 26 octobre 2016
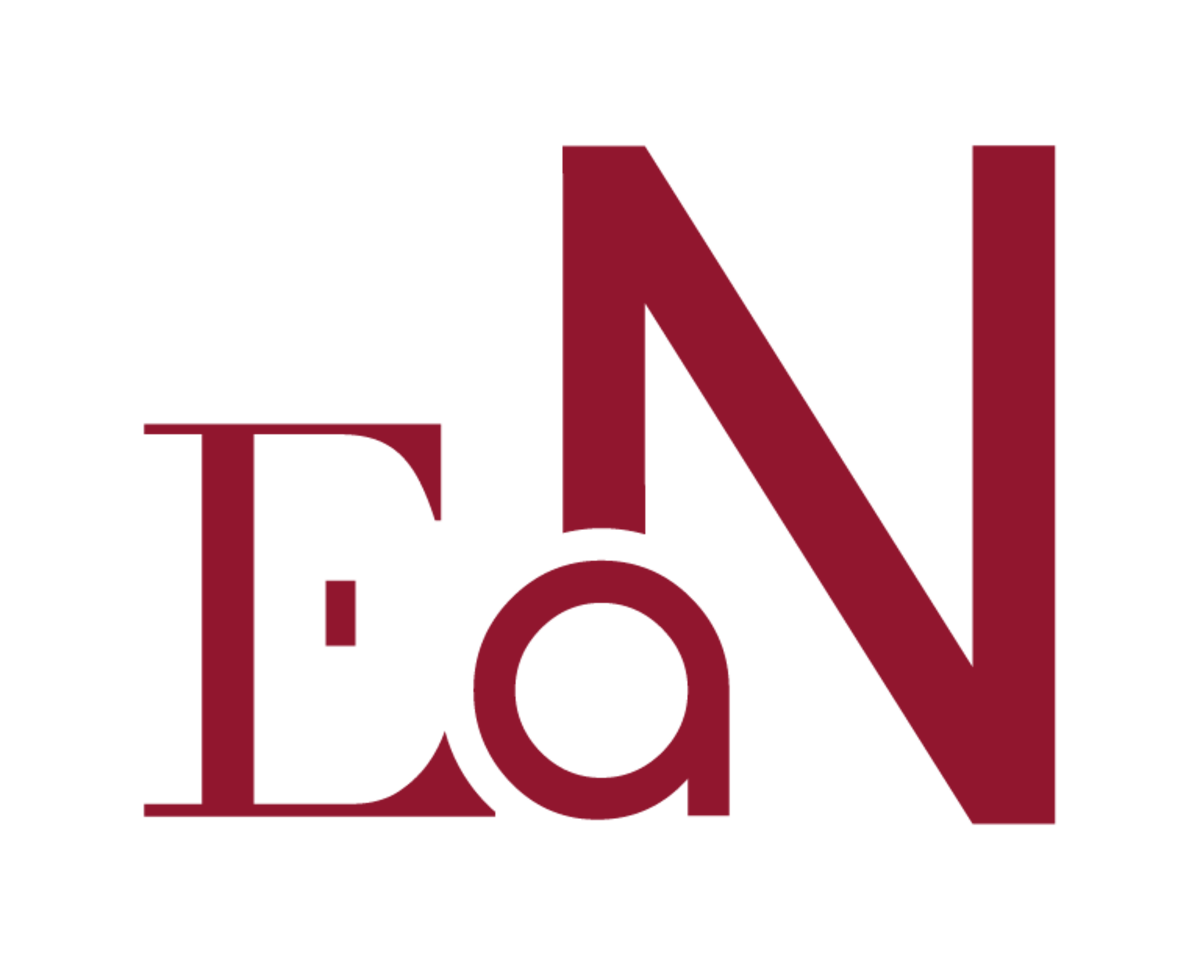
Agrandissement : Illustration 1