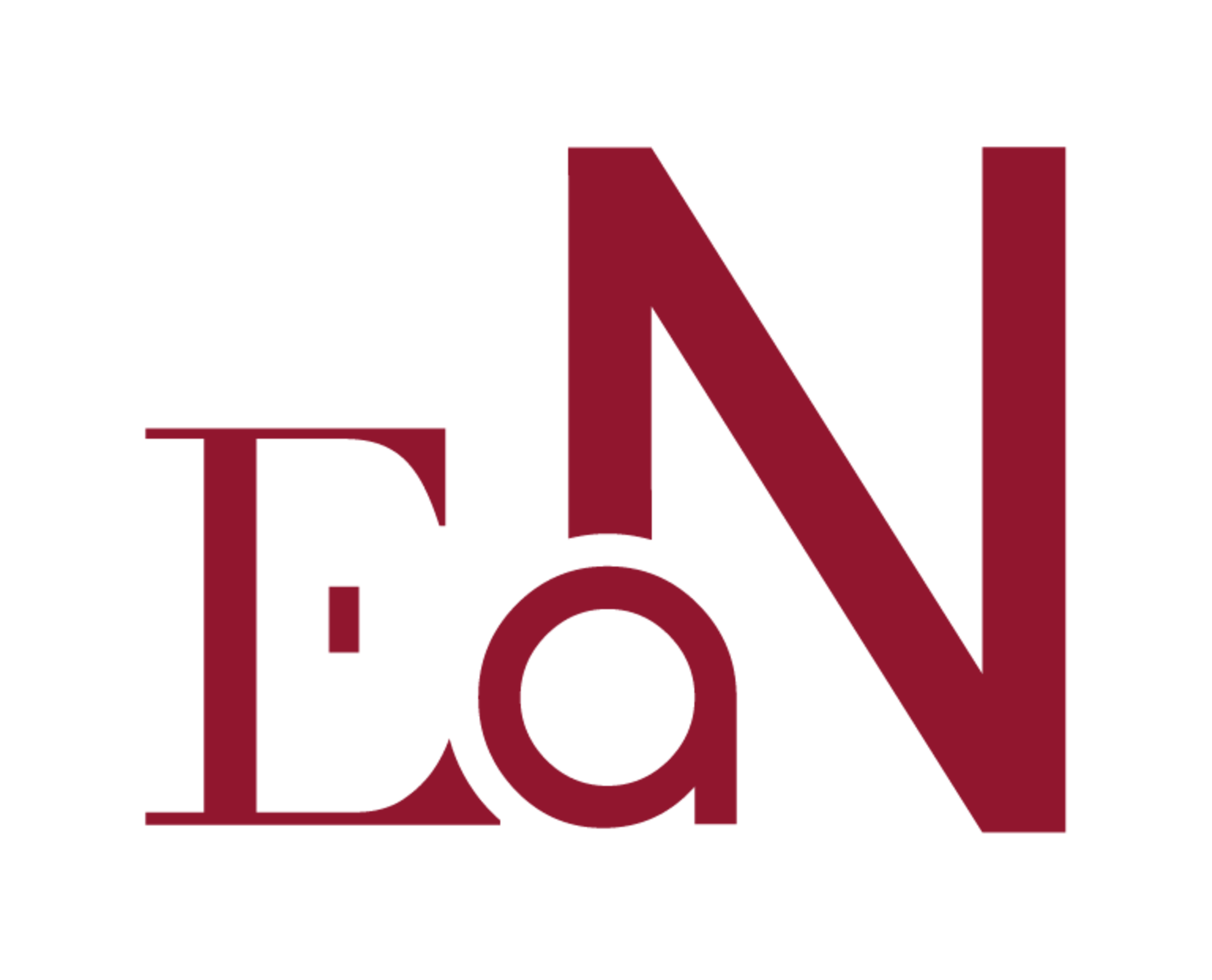Il existe déjà une revue spécialisée, semestrielle, Genesis, qui publie leurs travaux, mais cette chronique visera à évoquer un manuscrit, un fonds, une bibliothèque, un lieu de création, de façon aussi vivante que possible. Un article de Jean-Pierre Orban sur le fonds André Schwarz-Bart illustre de façon très encourageante les débuts de cette forme nouvelle.
Il est également question de genèse, et même de la genèse textuelle par excellence dans l’article que Marc Lebiez consacre au livre passionnant de Ron Naiweld sur la genèse du monothéisme et qui sera dans quelques jours à la Une de notre journal. Où l’on apprend que le Dieu de l’Ancien Testament se dit de double façon. Étrange dualité…
C’est à Ambroise de Milan, un père de l’Église charismatique du IVe siècle, « personnage essentiel » voire « titanesque » de la formation institutionnelle du christianisme (« inventeur – nous dit Pierre Tenne – de la fonction épiscopale, et théoricien de la pastorale », entre autres) que s’est intéressé Patrick Boucheron dans La trace et l’aura. Il s’agit d’échapper à l’hagiographie et aux « souvenirs glorieux » pour retrouver « les artifices mémoriels » : une genèse si l’on veut, mais critique.
D’un monothéisme à l’autre… Comment se radicalise-t-on en adhérant à un islam politique ? Par quelles voies politiques, religieuses, familiales ? Selon quelles gradations ? Cette question de la genèse d’une radicalité appelle une démarche prudente, selon un spécialiste, Ariel Planeix.
Maïté Bouyssy s’intéresse, quant à elle, à l’émergence récente du phénomène assez insaisissable des « gilets jaunes », à cette expression spontanée d’attentes et de frustrations qui ont fini par se coaguler en un évènement imprévu, sinon imprévisible, dont personne ne semble en mesure de pleinement saisir la vraie portée, et qui échappe en tout cas aux références et aux modèles anciens. « Un ordinaire de sédition qui ne se résorbe pas » observe-t-elle.
Comme souvent, la littérature peut peut-être nous éclairer, avec ces deux romans retrouvés de Jules Vallès, qui mettent en scène les espérances déçues de bacheliers venus du prolétariat, tandis que Linda Lê, à l’occasion de la réédition de L’Indésirable de 1925, nous rappelle qui fut Louis Guilloux. Et Lilian Kerjan, dans un article dont les lecteurs de Mediapart ont eu la primeur, met en lumière tout l’intérêt politique du journal qu’a tenu Steinbeck au moment où il a écrit Les Raisins de la colère. Peut-on cependant, comme Éric Vuillard dans la suite de ses romans, jouer littérairement avec l’histoire ? Alban Bensa a été en partie séduit par la vigueur de cette évocation de la « révolte des pauvres » de Thomas Münzer
J. L, 27 février 2019
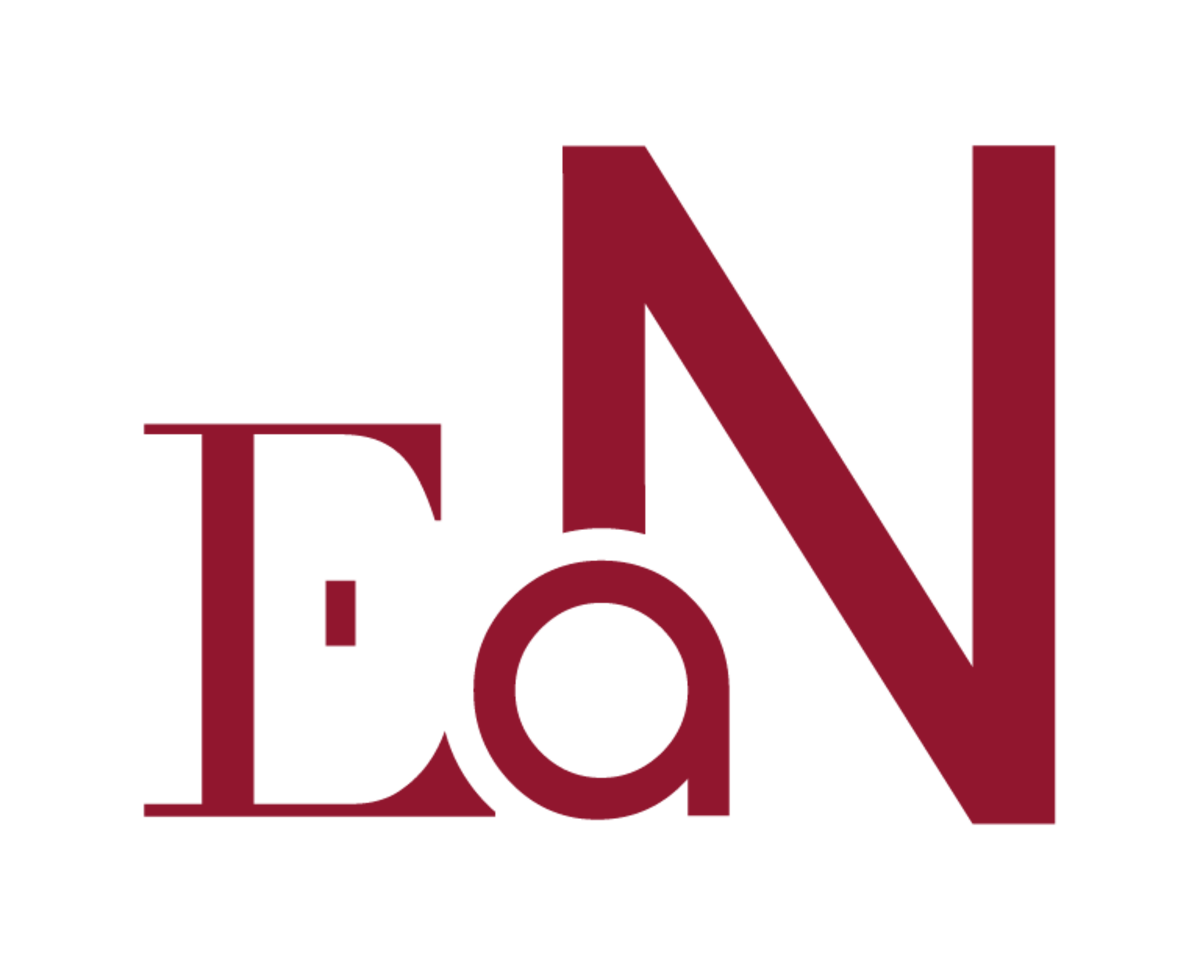
Agrandissement : Illustration 1