Les Économistes atterrés viennent de publier un ouvrage qui s’intitule « De quoi avons-nous vraiment besoin ? ». Fruit d’un travail collectif – nous sommes 19 auteurs à y avoir contribué –, nous y débattons de la question des besoins sociaux, question qu’il est indispensable de mettre au cœur des débats que nous avons à mener.
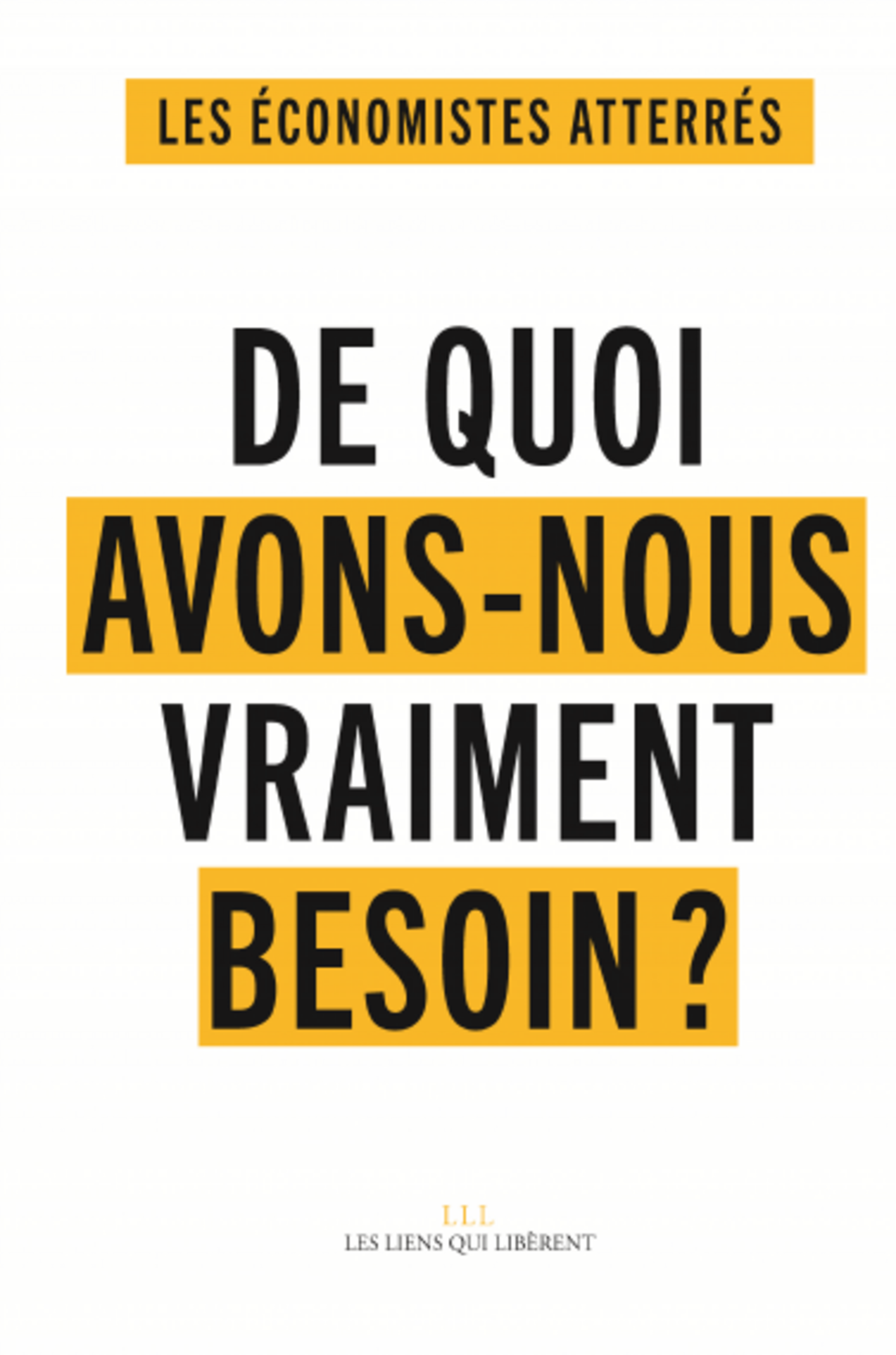
Au moment où la COP, qui en est pourtant à sa 26ème édition, a une nouvelle fois accouché de mesures timides au regard des enjeux en cours, ce livre ouvre un débat pour le monde d’après, pour penser la bifurcation sociale et écologique urgente et incontournable. En partant de ce qui compte, de ce dont nous avons vraiment besoin, nous renversons la logique qui prévaut habituellement et réaffirmons qu’il convient de sortir d’une forme « d’économisme » où la satisfaction de nos besoins essentiels dépendrait de supposées lois économiques immuables. Dans ce livre, nous montrons au contraire que l’économie doit être subordonnée aux exigences sociales et écologiques de notre temps. Elle n’est qu’un moyen au service d’objectifs qui la dépassent.
A ce titre, nous faisons le pari que le choix de redéfinir collectivement ce dont nous avons besoin sera une question au centre des débats à venir au sein de la société. Ce choix devrait d’ailleurs être au cœur de la campagne présidentielle à venir.
Les besoins tels qu’ils sont habituellement exprimés structurent nos 5 premiers chapitres : « se nourrir » ; « se soigner » ; « s’éduquer » ; « faire culture » ; « se loger et se déplacer ». Mais dans notre livre, nous dépassons la vision traditionnelle qui en fait de simples besoins matériels. Ces besoins n’étant pas satisfaits de la même manière partout dans le monde, ils sont liés aux modes de vie, à la culture et donc aux institutions sociales qui fondent le « vivre ensemble » que nous abordons dans notre dernier chapitre, sans oublier les contraintes de domination d’une classe sur les autres.
Par exemple, produisons-nous la même chose lorsqu’un service de santé résulte d’une organisation privée et à but lucratif, gouvernée par des objectifs quantitatifs abstraits et soumise à une logique industrielle basée sur la rentabilité économique à court terme, ou lorsque celui-ci est produit par des hôpitaux publics ou des maisons de santé de proximité, administrés par les soignants en lien avec les usagers ?
On le voit, ce sont donc des choix politiques qui conduisent à satisfaire tel besoin plutôt qu’un autre, à choisir la manière de les satisfaire ainsi que les personnes et les classes qui les verront convenablement satisfaits.
La période néolibérale, qui s’inscrit dans un capitalisme de plus en plus financiarisé, en accroissant fortement les inégalités, a clairement favorisé les classes sociales les plus aisées au détriment des classes populaires. La question du vivre ensemble telle que nous la posons est porteuse d’espoir. Elle est aux antipodes des délires identitaires et racistes actuels.
Sortir de la logique mortifère actuelle suppose de redéfinir nos modes de production, question que nous abordons dans les chapitres « produire ensemble » et « travailler ensemble ».
Changer notre modèle productif passe en particulier par l’introduction de plus de démocratie dans les entreprises ; par la relocalisation, à chaque fois que c’est possible, d’une production industrielle plus sobre en technologie, intégrant dans un même lieu la majorité du processus de production pour une consommation sur le territoire ; cela passe aussi par le développement de modèles productifs coopératifs (comme les sociétés coopératives et participatives (SCOP) par exemple).
Mais il convient aussi de revaloriser le travail, malmené par le néolibéralisme et menacé par la révolution du numérique, ce qui passe par la réduction du temps de travail pour réduire le chômage et accroître la qualité des emplois et celle du travail, le tout en lien avec l’objectif écologique ; cela passe aussi par la garantie de l’emploi par la collectivité pour répondre à des besoins non satisfaits.
A l’occasion de la crise sanitaire, les inégalités de classe sont apparues de manière encore plus flagrante avec les « premiers de corvée » sans qui tout se serait effondré. C’est pour cela que la question des inégalités est centrale.
Au final, deux conclusions s’imposent : il est tout d’abord important de noter que transition écologique et baisse des inégalités sont indissociables. Les considérations environnementales ne peuvent être traitées séparément des questions sociales ; mais il est aussi important de répéter que c’est par la coopération, et non par la concurrence, que nous pourrons satisfaire ces véritables besoins et construire une réelle alternative sociale et écologique au capitalisme néolibéral actuel.
Source: d'après https://www.lacledesondes.fr/article/renverser-le-systeme-economique-et-si-on-partait-des-besoins-de-la-societe.



