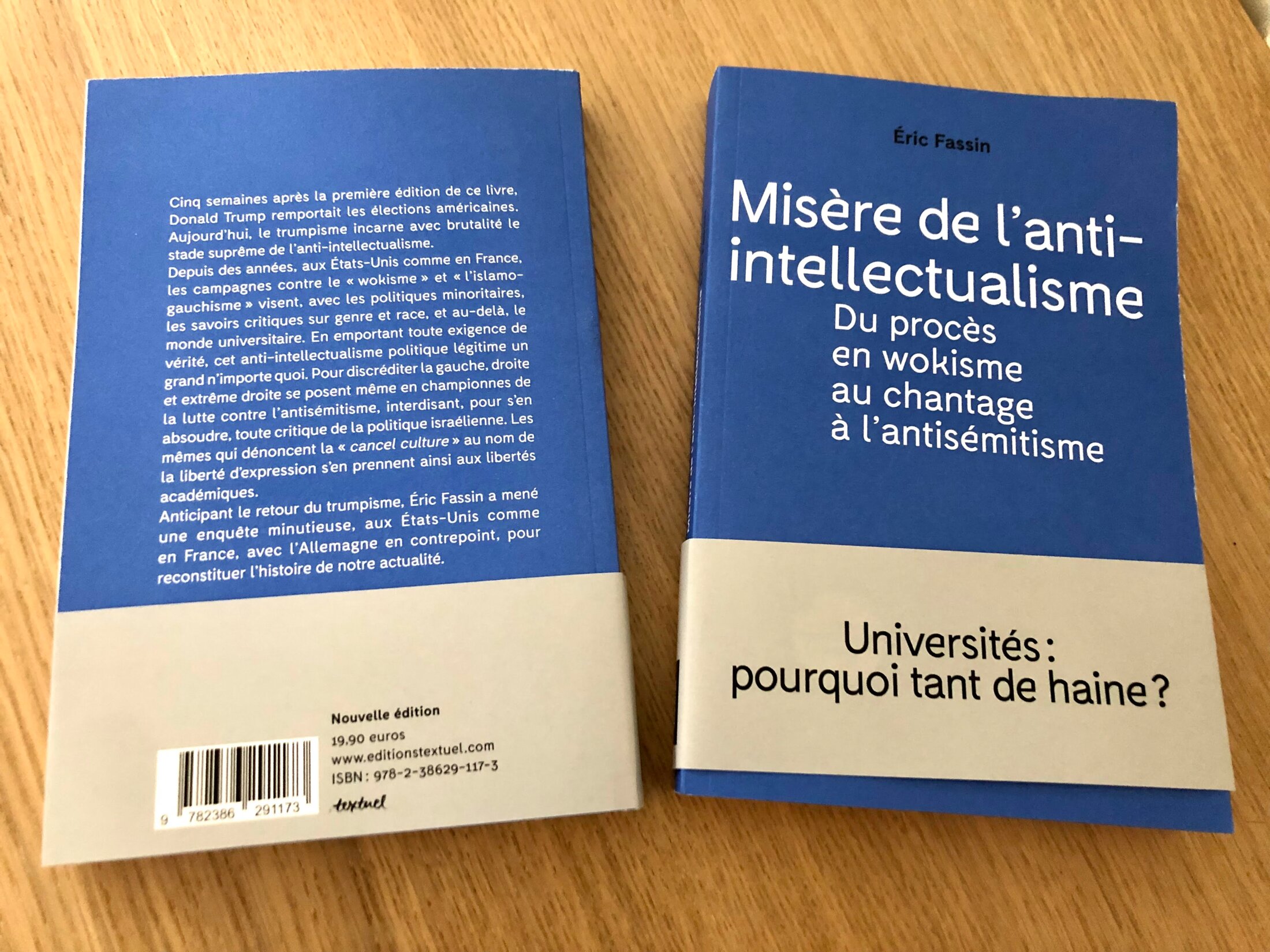Avant-propos
La première édition de cet ouvrage est arrivée en librairie le 2 octobre 2024. Il était parti à l’imprimerie le 19 août, jour où s’ouvrait aux États-Unis la convention démocrate : Kamala Harris pouvait encore espérer la victoire. Du côté français, on savait seulement qu’Emmanuel Macron, au mépris des résultats d’élections législatives qu’il avait pourtant convoquées, refusait de choisir un Premier ministre dans les rangs de la gauche. Mon introduction annonçait un programme : « penser l’actualité ». Il ne s’agissait pas seulement de récapituler des développements récents, des deux côtés de l’Atlantique. Cet essai sociologique avait l’ambition de donner des clés pour comprendre ce qui prenait forme sous nos yeux. Pendant la fin de campagne, le candidat républicain accusait les migrants, dans l’Ohio, de manger chiens et chats. Contre ces alternative facts, que valait alors le fact checking ? C’était l’apothéose du bullshit politique – le grand n’importe quoi.
Or, cinq semaines après la parution du livre, Donald Trump remportait l’élection aux États-Unis. Force est de le constater : mon titre, Misère de l’anti-intellectualisme, a bien été validé par les cent premiers jours de ce second mandat. Dès son investiture, le 20 janvier, le président prenait un décret pour « défendre les femmes contre l’extrémisme de l’idéologie du genre et restaurer la vérité biologique dans l’État fédéral », et un autre pour « mettre fin au gâchis et à la radicalité de programmes de diversité et de politiques préférentielles dans l’administration fédérale ». L’anti-intellectualisme s’attaque en premier lieu aux politiques minoritaires, taxées de wokisme. Comme lors des attaques républicaines contre les présidentes d’universités auditionnées à la Chambre des Représentants depuis décembre 2023, il se drape dans la lutte contre l’antisémitisme. Les manifestations pro-palestiniennes servent de prétexte pour expulser des étudiants étrangers, écarter des professeurs, et sous la pression d’enquêtes annuler des financements fédéraux pour obtenir la capitulation d’universités d’Ivy League placées sous le contrôle du régime. Le nouveau vice-président, J.D. Vance, l’avait déclaré sans ambages en 2021 : « Les universités, voilà l’ennemi. »
En France, Patrick Hetzel, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche nommé en septembre 2024 par Michel Barnier, avait demandé quelques mois plus tôt à l’Assemblée nationale la création d’une commission d’enquête sur les « dérives islamo-gauchistes » dans l’enseignement supérieur. C’était reprendre le projet auquel l’ancienne ministre Frédérique Vidal avait dû renoncer. Quelques jours avant la date anniversaire du 7 octobre 2023, Patrick Hetzel inaugurait sa fonction nouvelle en condamnant « des manifestations et prises de position de nature politique, en lien avec le conflit au Proche-Orient », qui iraient, à l’en croire, « à l’encontre des principes de neutralité et de laïcité du service public de l’enseignement supérieur. » Les mobilisations ne parlent pourtant ni d’islam ni de judaïsme ; l’alibi républicain sert juste à neutraliser (au sens policier) le monde universitaire. C’est qu’à la différence des États-Unis, l’anti-intellectualisme avance souvent masqué. D’ailleurs, les mesures contre les universités s’y autorisent volontiers, non d’une idéologie, mais d’une rationalisation néolibérale : ce peut être au nom de l’évaluation des politiques publiques et de la rigueur budgétaire que sont visés, sans qu’il soit besoin de les nommer, les savoirs critiques.
Ainsi, début 2025, le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) a rendu des avis défavorables sur de multiples licences et masters, surtout en philosophie et sciences sociales (y compris dans ma propre université). Or on apprenait bientôt que beaucoup de ces avis, susceptibles d’entraîner la fermeture de diplômes, contredisaient ceux des évaluateurs sollicités par cette instance. Démentant son indépendance supposée, le HCERES s’était ainsi permis, à l’insu de tous, de rayer d’un trait de plume, avec leurs conclusions, le principe même du jugement des pairs qui est un des piliers des libertés académiques. La révélation de ce contrôle politique entraînait un vote de l’Assemblée nationale, le 10 avril, pour la suppression de cette instance. Pourtant, le nouveau ministre, Philippe Baptiste, n’hésitait pas à protester… au nom de « l’autonomie » et de la « liberté académique ». Ce n’est sans doute pas un hasard si des soutiens intellectuels de l’offensive anti-intellectuelle contre un prétendu islamogauchisme, dès l’annonce en 2021 par Frédérique Vidal d’une enquête, avaient justement proposé de confier celle-ci au HCERES, « institution indépendante du ministère », pour lutter « contre la contamination du savoir par le militantisme ». On retrouve la convergence des logiques néolibérales et néofascistes : pour les premières, les savoirs critiques sont inutiles ; pour les secondes, ils sont dangereux.
Toutefois, la France apparaît quelque peu en décalage, voire en retrait par comparaison avec la radicalisation trumpiste. Dans les recherches bénéficiant d’un financement fédéral, le président des États-Unis a établi une liste de centaines de mots suspects ; y figurent non seulement « diversité » ou « intersectionnalité », ou encore « antiracisme », « race et ethnicité », qui organisent pourtant le recensement, et certaines de ses catégories, comme « noir » ou « Native American » (mais pas « blanc »); non seulement « LGBT » ou « trans », et bien sûr « genre », ou encore « féminisme », et même « femmes » (mais pas « hommes »). La purge ne s’arrête plus au « wokisme ». Le soupçon pèse aussi sur « discrimination » et « privilège », « inégalité » et « injustice », ou encore « inclusion » et « exclusion », et même « handicap » ou « santé mentale ». Outre « Golfe du Mexique », c’est la « science du climat » qui passe à la trappe, sans oublier « biais » ou « à risque ». Bref, la cible est la vérité scientifique en tant que telle.
Quant à la justification de la répression anti-universitaire par la lutte contre l’antisémitisme, sa crédibilité est quelque peu entamée par le salut, pudiquement qualifié de « romain », affiché le jour de l’investiture du président par son favori, Elon Musk. Que Steve Bannon, son rival dans le camp trumpiste, l’imite un mois plus tard n’a fait qu’en confirmer la signification. L’hebdomadaire allemand Die Zeit a d’ailleurs tranché (en pastichant Gertrude Stein) : « un salut hitlérien est un salut hitlérien est un salut hitlérien ». Pourtant, le président de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, censé lutter contre l’antisémitisme, n’a voulu y voir qu’« un geste maladroit, dans un moment d’enthousiasme, pas un salut nazi. » Pourquoi s’en étonner ? Ce livre apporte un éclairage. D’un côté, Elon Musk a favorisé l’expression suprémaciste sur X, allant jusqu’à reprendre à son compte la version antisémite de la « théorie » du grand remplacement, et de l’autre, cela n’a pas empêché le même Jonathan Greenblatt d’applaudir son engagement après l’interdiction de slogans pro-palestiniens sur son réseau social. Bannir le mot « décolonisation » pour parler d’Israël est un gage d’antiwokisme qui dédouane des accusations d’antisémitisme. Au moment même où celles-ci pleuvent contre la gauche, le néofascisme qu’elles épargnent peut avancer à découvert.
La résonance de ce livre avec une actualité qu’il paraît anticiper explique probablement l’épuisement de son premier tirage, six mois seulement après sa sortie. Cet accueil d’un public désireux de mieux comprendre interroge d’autant plus sur le silence qui a prévalu jusqu’à présent dans les médias : une seule recension, dans Le Soir, en Belgique ; deux entretiens en vidéo, l’un pour Regards, revue de gauche, l’autre pour SQOOL TV, chaîne consacrée à l’éducation. Ni le premier anniversaire du 7 octobre, coïncidant avec sa sortie, ni le nouveau mandat de Donald Trump n’ont suffi à éveiller l’intérêt journalistique. Comment l’interpréter ? Les deux premières phrases du livre apportent une première réponse : « On ne peut plus rien dire » a cédé la place à : « Taisez-vous ! » Son annulation dans les médias privés ou publics qui vont de l’extrême droite au macronisme confirme donc l’argument de cet ouvrage. Face à des analyses qui invalident un discours dominant sur l’antisémitisme qui s’emploie à diaboliser la gauche pour mieux dédiaboliser l’extrême droite aux portes du pouvoir, la prudence journalistique le dispute à l’embarras.
On peut ajouter que ce silence est l’effet d’une logique médiatique qui amène à discuter surtout ce dont on parle déjà. Or, aujourd’hui, ce n’est plus la gauche qui donne le la : l’hégémonie idéologique est passée à droite. En conséquence, les pamphlets de droite accaparent l’attention, fût-ce pour les critiquer. De fait, la plupart des médias continuent de faire comme si l’on pouvait débattre de tout avec n’importe qui – y compris pour dire n’importe quoi. C’est croire que l’on vivrait encore dans un espace public libéral où les opinions pourraient s’affronter lors d’échanges argumentés. Mais s’il défend des valeurs, Misère de l’anti-intellectualisme n’est pas à proprement parler un livre d’opinion. C’est un travail sociologique qui mobilise des faits empiriques et des outils conceptuels pour appréhender la configuration politique renouvelée par le trumpisme. Sans doute un essai polémique eût-il été la cible d’attaques. Contrairement à mes craintes, ce n’a pas été le cas : ce livre n’a pas suscité d’écho médiatique, même négatif. Dans un contexte d’anti-intellectualisme, le savoir subit bien sûr des formes de silenciation. Le public rencontré par ce livre, malgré l’annulation par les médias, confirme néanmoins l’amoindrissement de leur pouvoir prescripteur, en particulier dans les jeunes générations qui sont au cœur de cet ouvrage. Reste à espérer que des médias suivent l’intérêt des lecteur∙ices, à défaut de le dicter.
Finalement, la non-réception médiatique du livre peut donc s’expliquer, non pas malgré son actualité, mais à cause d’elle. Le contexte nouveau, dans son incertitude, crée en effet un malaise dans l’antiwokisme. En France, le Rassemblement national, qui a tant œuvré pour gagner un certificat de dédiabolisation, peut-il emboîter le pas à la radicalisation trumpiste ? Certes, il n’est pas surprenant que Marion Maréchal, Sarah Knafo et Éric Zemmour aient bénéficié d’une invitation à Washington pour les cérémonies d’investiture présidentielle, et non Marine Le Pen. Encore la condamnation de celle-ci en justice pourrait-elle entraîner son revirement : Donald Trump ne lui a-t-il pas manifesté sa solidarité ? À l’entendre, « c’est le même scénario qui a été utilisé contre moi ». Le trumpisme triomphant pourrait-il donc enfoncer un coin, en France, entre la minorité au pouvoir et l’extrême droite dont le soutien tacite, depuis la parution de ce livre, a été la condition nécessaire de survie des gouvernements choisis par Emmanuel Macron ? Il est vrai qu’à l’instar de J.D. Vance, Washington ne cache pas son mépris pour l’Union européenne ; celle-ci ne menace-t-elle pas de sanctions des oligarques comme Mark Zuckerberg et Elon Musk lui-même ? Il serait pourtant prématuré d’en conclure que, face à la coalition d’autocrates qui se dessine entre Donald Trump, Vladimir Poutine, et tant d’autres, la France et l’Europe renoueront avec un modèle libéral mis à mal par le recul des libertés publiques et le durcissement des politiques xénophobes, mais aussi, sous de multiples formes, par la privatisation de la puissance publique.
En tout cas, face à l’antiwokisme de Trump, la France ne saurait sérieusement se prétendre woke. Lorsque l’ambassade américaine à Paris exige des entreprises françaises qu’elles renoncent à toute politique de diversité, beaucoup s’offusquent d’une telle ingérence. « Quel toupet ! ». Cela dit, comme le souligne un dessin de Colpacano (Le Monde, 6 avril 2025) : « on n’a jamais eu de politique inclusive ! » L’ironie redouble dans l’image : un technicien de surface noir et une secrétaire qui apporte le café aux patrons indignés encadrent silencieusement ces deux hommes blancs. Cependant, les pourfendeurs européens du « totalitarisme woke » sont actuellement confrontés à un dilemme : la haine de l’Europe professée par le trumpisme les condamne-t-elle à sacrifier l’antiwokisme ? Il en est pour le reconnaître, ce combat n’est plus une priorité ; et de préconiser la « nuance », plutôt qu’un antiwokisme primaire. Mais il leur serait coûteux de devoir renoncer aux séductions de la notoriété éditoriale et médiatique qui accompagne l’incessant ressassement de leurs opuscules et tribunes. Pour ne pas renoncer aux gratifications de cette prolifique polémique, ils n’hésitent pas à plaider que, si le wokisme sert de « repoussoir » commode au poutinisme et au trumpisme qui le répriment, les wokes seraient en même temps les « alliés objectifs » de Poutine et Trump, communiant dans la détestation de l’universalisme occidental. « Hitler a déshonoré l’antisémitisme », écrivait Georges Bernanos en 1944. Trump finira-t-il par discréditer l’antiwokisme, ou bien celui-ci sera-t-il sauvé, en Europe comme aux États-Unis, par le chantage à l’antisémitisme réservé à la gauche ?
Misère de l'anti-intellectualisme. Du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme, Textuel, 2e édition, 4 juin 2025
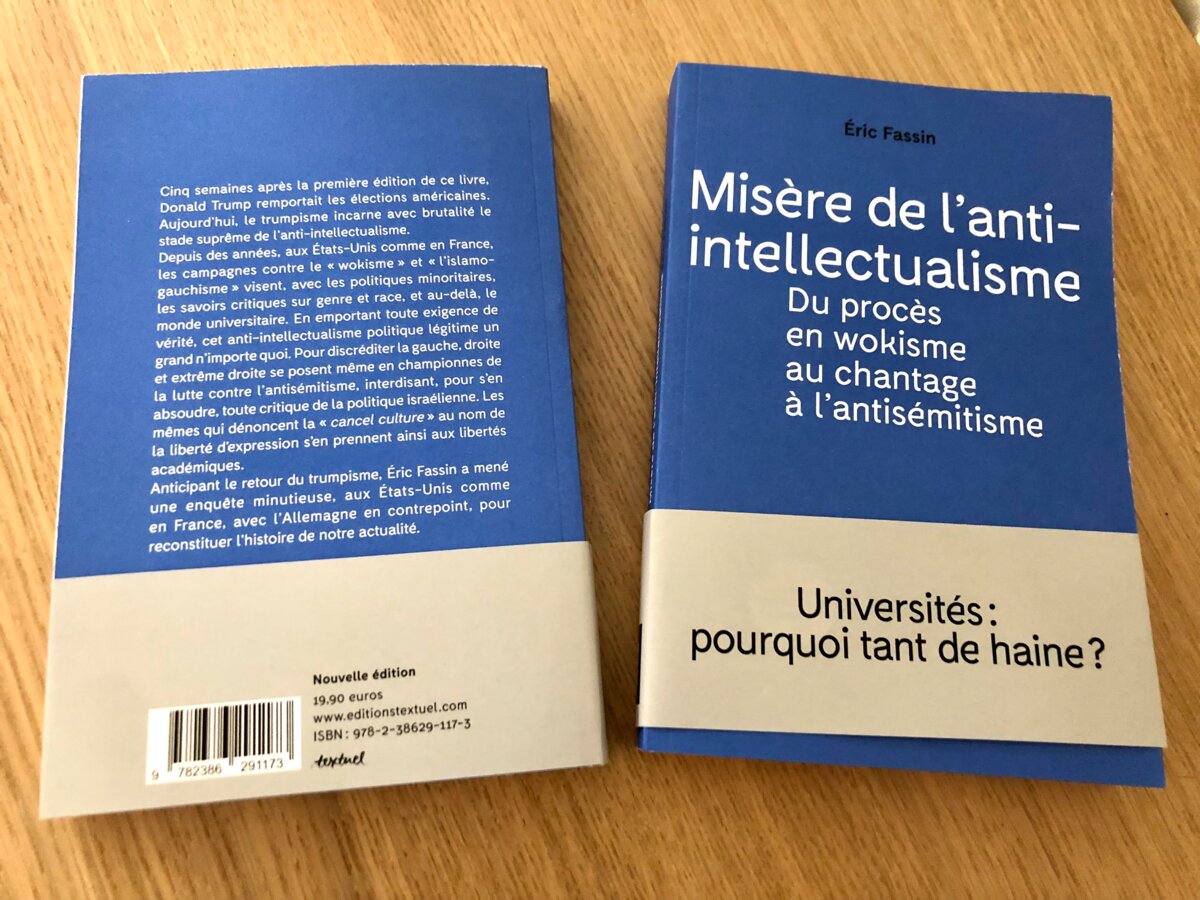
Agrandissement : Illustration 1