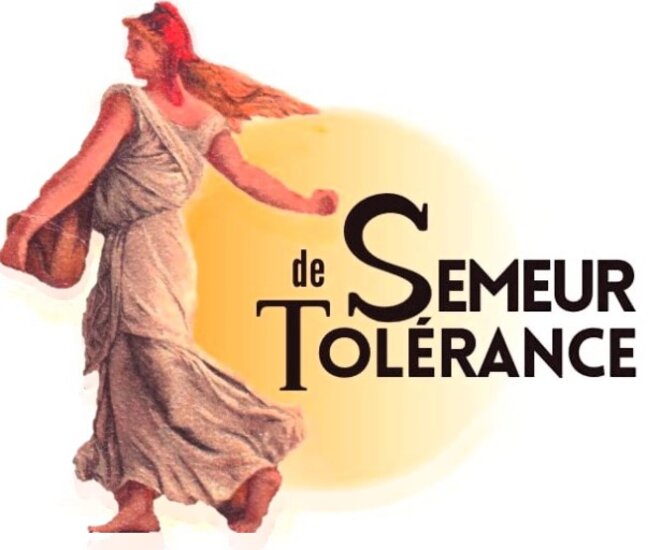« Maintenant, ici, voyez-vous, il vous faut courir aussi vite
que vous pouvez pour rester à votre place. Si vous voulez
aller ailleurs, il vous faut courir au moins deux fois plus vite »1
Quand une dizaine de cadres de l’animation sont interrogés2 sur les changements qu’ils ont connus ces dernières années, la question du rapport au temps semble être centrale sans être rigoureusement questionnée. Cet article ambitionne donc d’éclairer les différents aspects de ce sujet complexe. De quel temps parlent-ils quand ils se plaignent du « manque de temps » ? Quels en sont les présupposés ? La signification sous-jacente de ces lamentations ? Et les effets probables sur leurs métiers, les risques inhérents ?
Tout d’abord, il faut noter l’aspect polysémique du terme temps - le Dictionnaire Larousse ne mentionne pas moins de 22 définitions de ce mot3 - , comme le rappelle Étienne Klein4 :
« On l'utilise pour dire le temps mais aussi d'autres choses comme le changement, la vitesse, la simultanéité, la succession, le devenir… Et donc, quand on parle du temps, on n'est jamais sûr du sens qu'il faut mettre derrière ce mot, d'autant plus que on ne sait jamais dire à quel type d'entité on a à faire »
Ainsi, une grande partie des expressions en rapport au temps le considère comme un objet extérieur à l’individu5. Or, il n’y a pas d’extériorité au temps. C’est pourquoi beaucoup de sociologues ont démontré que le rapport au temps est une construction sociale6. C’est dans cette filiation qu’il faut appréhender les discours sur le temps des cadres de l’Éducation Populaire.
Un nouvel esprit associatif ?
Avant d’analyser les particularités de ces discours sur le rapport au temps, il faut rappeler que les associations d’Éducation Populaire (EP) font partie des organisations apprenantes7 . Celles-ci ont une main d’œuvre très autonome, capable d’apprendre des choses nouvelles et qui effectue des travaux variés, exigeant de bonnes compétences cognitives. Ce système, au temps de travail souvent important pour les salariés, peut également les affecter s’ils doivent composer avec une hiérarchie peu au fait des réalités de terrain ou des injonctions paradoxales.
En effet, les entretiens avec les cadres de l’Education Populaire donnent une description relativement homogène d’un quotidien où ils doivent être polyvalents, très autonomes sur leurs postes, mais sont employés par une hiérarchie composée d’administrateurs bénévoles - peu au fait de la réalité du travail prescrit - et confrontés régulièrement aux multiples injonctions contradictoires que sous-tendent ces postes à responsabilités.
Cette polyvalence et la constante adaptation demandées aux cadres de l’EP fait écho aux modifications du travail insufflées par « le nouvel esprit du capitalisme »8 depuis les années 90 où, dans une vision du monde orientée sur le « projet », le professionnel - pour être reconnu « comme un bon » - ne doit pas s’enfermer dans une spécialité, doit pouvoir accéder à des ressources sans en dépendre et s’engager dans un projet tout en gardant la capacité d’en commencer un autre. Ainsi, il semble y avoir une porosité des associations d’EP au nouveau discours capitaliste développé depuis 30 ans pour répondre aux critiques.
De plus, les discours sur le manque de temps sont anciens. Il importe donc de discriminer les discours perpétuels inhérents au champs que représente le travail social et ceux des acteurs à un moment donné, dans une configuration particulière - « actualisée ». Écartelé entre la volonté de bien accompagner les publics et un manque de moyens - c’est à dire une rationalisation de ceux-ci - , le milieu du travail social crée une frustration entraînant une plainte sur le manque de temps présent de longue date, presque normatif. Néanmoins, les discours des professionnels semblent démontrer l’aggravation de ce sentiment qui mérite d’être enquêté.
Hors de ces effets de champs, le cœur de cette analyse privilégie les cadres de l’animation comme axe d’étude. Par conséquent, le secteur de l’animation semblera être uniquement un construit social résultant des discours, de la dynamique des acteurs et de leurs luttes pour une forme de reconnaissance et pour l’autonomie via une sociologie de l’interaction sociale.9
Le contexte étant posé, les discours des cadres du secteur de l’EP peuvent être analysés.
« On a nos limites ! »
Sans être exhaustif sur les innombrables mentions au « manque de temps », les différents éléments significatifs de ces discours peuvent être catégorisés :
- la distinction entre le temps des administrateurs et celui des salariés, tous les deux contraints ;
« Je le rabâche aux administrateurs depuis des années : effectivement, vous n’avez pas le temps et vous ne savez pas faire… Donc vous embauchez des salariés pour vous aider à mettre en place ce que vous décidez. »10
- la réduction des temps de formation induisant une perte de sens et de vision globale ; le manque de temps pour accompagner les apprentis sur le terrain ;
« On est encore dans l'histoire du temps : on a créé un CPJEPS11 ou un CQP12, des espèces de « diplôme accéléré du pauvre » En fait, c'est un BPJEPS13 accéléré. […] On érode nos convictions [...] pour faire rentrer des triangles dans des ronds, ou des carrés dans des losanges ! »14
En parlant de l’apprentissage : « Oui, ils apprennent des choses… Ils apprennent peut-être à rédiger un projet, mais [...] il leur faudrait encore quelqu'un qui les accompagne en disant "Enfin c'est quoi vraiment tes valeurs et comment tu veux le mettre en pratique et c'est quoi ton projet" ? » 15
- les injonctions des institutions à faire et à répondre à de trop nombreux appels à projet dans une logique de cofinancement ;
« On est obligé de s’adapter aux financeurs… On coule vers de l'appel à projet mais on a l'impression que pour eux, on n’a pas de limite ! [...], on peut être corvéable parce que c'est eux qui nous donnent de l'argent ! Sauf qu'à un moment donné, il faut […] qu'on puisse affirmer qu’on a nos limites ! »16
- l’impératif de présentiel inhérent aux cadres encadrant des équipes salariées.
« On évalue aussi le job du directeur à être là avant les autres et à être là après les autres »17
Force est de constater que ces témoignages sur le manque de temps couvrent de manière indifférenciée la totalité des missions d’un directeur de MJC, cadre associatif qui comporte 6 grandes familles d’attribution18 :
- Responsable du projet de l’association.
- Garant du fonctionnement associatif.
- Responsable de l’information et de la communication.
- Mandataire du Conseil d’Administration.
- Directeur du personnel.
- Responsable de la gestion et de l’administration générale.
Si les cadres sentent une contrainte temporelle renforcée sur l’ensemble de leurs missions, c’est que la problématique ne peut se résumer à une explication unique, un aspect particulier de l’organisation du temps de travail, ou encore un domaine spécifique. Ainsi, c’est une analyse englobante qu’il faut réaliser pour remonter aux origines de ces discours des professionnels.
De l’autre côté du miroir
Leurs paroles donnent de la consistance à l’analyse appelée « l’accélération du temps »19. Selon Rosa, cette contraction de l’horizon temporel comporte trois dimensions fondamentales : le raccourcissement des délais pour la prise de décision (accélération technologique / économique) ; l’augmentation de la fréquence des épisodes d’action par unité de temps (le nombre de décisions à prendre par jour) ; le rétrécissement de l’horizon de calculabilité (contraction du présent, moins de facilité à se projeter dans l’avenir).
Ces dimensions sont transversales à toutes les missions des cadres associatifs, les emmenant à faire l’expérience de ce qui est appelé le « phénomène de la Reine Rouge »20, en hommage à un passage de Lewis Carrol21 cité en début d’article, où la Reine Rouge répond à Alice qui s’étonne que, courant avec elle de plus en plus vite, le paysage reste inchangé.
Ainsi, par analogie, les directions de MJC courent après les subventions – sans forcément les rattraper - , sans prendre le temps d’essayer de changer un système qui ne va qu’en s’accélérant. Cette « course » pour rester dans la course est aggravée par une période difficile pour les associations qui se débattent pour leur survie22.
En dehors de ces analyses, il faut mentionner quelques aspects spécifiques à cette « accélération » au sein de l’EP. Le temps du bénévole n’étant pas celui du cadre associatif. Celui-ci doit trouver des plages horaires pour travailler avec ses administrateurs, ce qui induit un temps de travail allongé (soir ou week-end). De plus, le numérique (via les mails, démarchages automatisés, dossiers en ligne, manque d’interlocuteurs physiques...) aggrave ce ressenti. Enfin, la qualité du travail empêchée peut être une source de frustration chez ces professionnels.
Certains considéreront que ce rapport au temps vient d’un problème de moyens financiers, entraînant un déficit de ressources humaines supporté par les personnes en postes. D’aucuns avanceront que c’est un problème de priorisation, une question de choix ou d’organisation du travail. Pourtant, ce phénomène semble dépasser les moyens ou l’organisation individuels des acteurs.
Un besoin de réfléchir
Ce constat fait, il reste à affiner l’observation de ce que cela induit chez les professionnels faisant face à ce temps « accéléré ». Il faut tout d’abord noter que « l’urgence de faire » empêche ces salariés de bénéficier de moment de Skholé23 pourtant essentiels à l’exercice de leur activité :
« La situation scolastique [...], en tant que mise en suspens de l’urgence, [...] et de la pression des choses à faire, [...] incline à considérer « le temps » comme une chose avec laquelle on entretient un rapport d’extériorité, celui d’un sujet en face d’un objet. Vision renforcée par les habitudes du langage ordinaire, qui font du temps une chose que l’on a, que l’on gagne ou que l’on perd, dont on manque ou dont on ne sait que faire, etc… ».24
Ainsi, redonner une extériorité au temps permet de réfléchir sur celui-ci. Or, les témoignages attestent de la disparition de ces temps réflexifs sur la praxis dans le champ de l’EP :
« Alors ça nous mange du temps et ça nous empêche de réfléchir, mais ça nous empêche même de réfléchir en tant que tel ! C'est-à-dire que ça nous contraint à regarder les choses de façon extrêmement partielle, tout le temps ! »25
Cette « impossibilité de réfléchir » empêche d’analyser les relations aux institutions, les évolutions du champ professionnel et leurs causes. Ne disposant plus de temps réflexif, se sentant écartelés par de multiples sollicitations et injonctions paradoxales, les cadres de l’EP pourraient se tenir pour responsables d’une organisation défaillante de leur propre activité, ne voyant pas que le phénomène est plus large que leur propre écosystème de travail. Or, pour des cadres se débattant avec leur quotidien et une charge mentale importante, cet environnement pourrait devenir aussi un terreau fertile à de potentiels risques psycho-sociaux.
Vers une ressource temps ?
Pour se protéger de ces risques, certains nient le problème par manque de temps ou de recul (Skholé), en trouvant des excuses :
« Parce que c'est l'excuse générale toujours : "on a des manifs, on n’a pas le temps" »26
D’autres semblent s’installer dans une forme de résistance passive en refusant de jouer le jeu des injonctions institutionnelles :
« J'en suis arrivé à un point de dire : " il y a des subventions qu'on ne demandera pas parce que ça nous coûte plus cher par que ça nous rapporte ! " [...] Tu fais des dossiers à tire-larigot, tu passes un temps fou à les faire, et pendant ce temps là, tu ne fais pas autre chose ! [...] donc oui ça c'est très preignant, et ça c'est venu avec le côté moderne des choses » 27
D’aucuns envisagent de se préserver en changeant de secteur d’activité si les conditions de travail ne changent pas à moyen terme :
« Si je pars, […] je pense que j'essaierai de chercher un boulot où je peux négocier l'articulation entre vie pro et vie perso »28
En dehors des discours individuels, les pistes d’amélioration pourraient s’inscrire dans une forme de délégation associative29 (encore à définir) inspirée de la délégation syndicale afin que des plages de travail salariés-administrateurs puissent être prises en charge. Une autre piste serait de s’appuyer sur le rapport, relativement oublié, de l’Assemblée Nationale sur la simplification associative30 de 2014 proposant (P.110) entre autres de :
« permettre aux associations de ne déposer qu’une seule fois sous forme dématérialisée les pièces nécessaires à une demande de subvention. Je sais que la recherche de financements est consommatrice de temps et d’énergie. Plus une association a de financeurs plus elle a de risques d’être déstabilisée par les évolutions de ces financements et les services de l’Etat ne se coordonnent pas sur ces évolutions. [...] Nous allons donc créer un « webservice » spécifiquement dédié aux demandes de subventions des associations »
Dix ans après, ce service centralisé des subventions n’a pas encore vu le jour.
Mais, surtout dans un contexte de plaidoyer pour le soutien aux associations d’EP, c’est un temps collectif de réflexion, de « Skholé » dont les cadres de ce secteur semblent avoir besoin pour réaliser qu’ils ne sont pas personnellement responsables de la situation, et d’interroger le rapport au temps de ce champs professionnel. Cela pourrait conduire à des propositions concrètes31 susceptibles d’être défendues au plus haut niveau de l’État par un rapport de force, forcément politique.
Pour conclure, deux réflexions sont possibles. Il faut reconsidérer le rapport au temps de l’Éducation Populaire, l’extérioriser pour le mettre à l’étude, mais aussi pour le construire comme une ressource mobilisable (ou pas) pour les professionnels. Ce temps se doit aussi d’être mieux partagé entre les professionnels (temps salarié), les administrateurs et les bénévoles (temps redistribués) et les adhérents (temps libre) aux risques d’un isolement des professionnels, et d’une désaffection de ce secteur par des cadres, militants certes, mais épuisés.
Cette rédaction d’article n’aurait pas été possible sans la disponibilité des personnes interrogées et les conseils avisés des relecteurs. Un grand merci pour leurs contributions.
1 Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. De l’autre côté du miroir, Paris, Livre de Poche, 2010 P. 143
2 Article basé sur 6 Entretiens exploratoires et 5 Entretiens semi directifs réalisé de novembre 2023 à Avril 2024
3 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/temps/77238
4 2021 - Etienne Klein - 4. Que penser du temps ? (conférence disponible sur Youtube)
5 À titre d’exemple, l’expression « le temps passe » présuppose qu’il est possible de le regarder « de l’extérieur »
6 Alfred Gell, dans son important ouvrage, L'anthropologie du temps, propose d'ailleurs une analyse des conceptions du temps depuis Durkheim jusqu'à Bourdieu. Alfred Gell, The Anthropology of Time. Cultural Constructions of Temporal Maps and Images, Oxford, Berg, 1992
7 Lorenz, E. H., & Valeyre, A. (2005). Organisational Innovation, Human Resource Management and Labour Market Structure : A Comparison of the EU-15.
8 Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Editions Gallimard.
9 Aballéa, F. (1996). Crise du travail social, malaise des travailleurs sociaux. Recherches et PréVisions/Recherches et Prévisions, 44(1), 11‑22. https://doi.org/10.3406/caf.1996.1734
10 Entretien Exploratoire Alpha novembre 2023
11 Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
12 Certificat de Qualification Professionnelle
13 Brevet Professionnel Jde la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
14 Entretien Exploratoire Bêta novembre 2023
15 Entretien Exploratoire Zêta novembre 2023
16 Entretien Exploratoire Zêta novembre 2023
17 Entretien Exploratoire Zêta novembre 2023
18 Fiche de poste directeur, Fédération Française des MJC
19 Rosa, H. (s. d.). Politique, histoire et vitesse du changement social : Vers une théorie critique de l’accélération sociale. Cairn.info. https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2010-1-page-105.htm&wt.src=pdf
20 Nom donné par le biologiste Leigh van Valen
21 Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. De l’autre côté du miroir, Paris, Livre de Poche, 2010
22 cf la campagne d’Héxopée https://www.hexopee.org/publication/1922 relayée par les fédérations d’Éducation Populaire et la campagne des Centres sociaux https://www.centres-sociaux.fr/appel-aux-coresponsables-de-la-cohesion-sociale/
23 « temps libre et libéré des urgences du monde qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences, et au monde » (Bourdieu, P. (2016a). Méditations pascaliennes. Livre de Poche., p. 10)
24 Bourdieu, P. (2016a). Méditations pascaliennes. Livre de Poche, P. 299
25 Entretien Exploratoire Êta novembre 2023
26 Entretien Exploratoire Êta novembre 2023
27 Entretien Semi-directif Xi avril 2024
28 Entretien Exploratoire Zeta décembre 2023
29 « C'est pour ça qu’à l'époque de Jean Laurain, […] l'idée qu'il [voulait] mettre en place […] c'était l'idée d’un temps associatif, dans le même esprit que le temps de formation syndicale : il y a un temps de gestion pour les présidents des maisons quoi ! Dans les entreprises, les gars qui sont responsables d'une grosse association en tant que bénévole seraient libérés... Comme des heures de délégation syndicale : des heures de délégation associative » Entretien Semi-directif Phi avril 2024
30 Associations.gouv.fr. (2017, août 18). Remise du rapport de l’Assemblée nationale sur les difficultés du monde associatif – Associations.gouv.fr.https://www.associations.gouv.fr/remise-du-rapport-de-l-assemblee-nationale-sur-les-difficultes-du-monde-associatif.html notamment les Pages 105, 110 et 130
31 À ce titre, lire la préconisation 8 du rapport du CESE sur les métiers de la cohésion sociales de juillet 2022 (page 6) « Considérer tous les temps de travail comme productifs : Prévoir dans les financements publics, l’ensemble des temps consacrés à la réflexivité, au travail d’équipe, à l’analyse des situations et à la préparation des actions à mener. »