« Bien avant d’être un militant socialiste et un dirigeant révolutionnaire communiste, Gramsci est un journaliste », écrit Jean-Yves Frétigné dans sa biographie de l’intellectuel italien, connu pour avoir été jeté par Mussolini en prison, où il a rédigé des fragments de texte dont la richesse et l’originalité nourrissent encore aujourd’hui la pensée critique. « Ceux qui l’ont fréquenté régulièrement, poursuit-il, le décrivent les poches remplies de manuscrits, penché sur sa table de travail en train de relire et de corriger avec soin son texte. »
Les vues d’Antonio Gramsci sur cette activité sont justement l’objet du petit recueil publié par les Éditions critiques, Le Journalisme intégral. Comme l’explique bien Fabien Trémeau dans la préface, cette pratique professionnelle n’a pas été qu’un gagne-pain pour le penseur marxiste. Ce dernier l’a envisagée comme un des rouages de l’effort culturel, et de la « persuasion permanente », auxquels devaient travailler les intellectuels associés aux classes subalternes, elles-mêmes appelées à renverser l’ordre social.
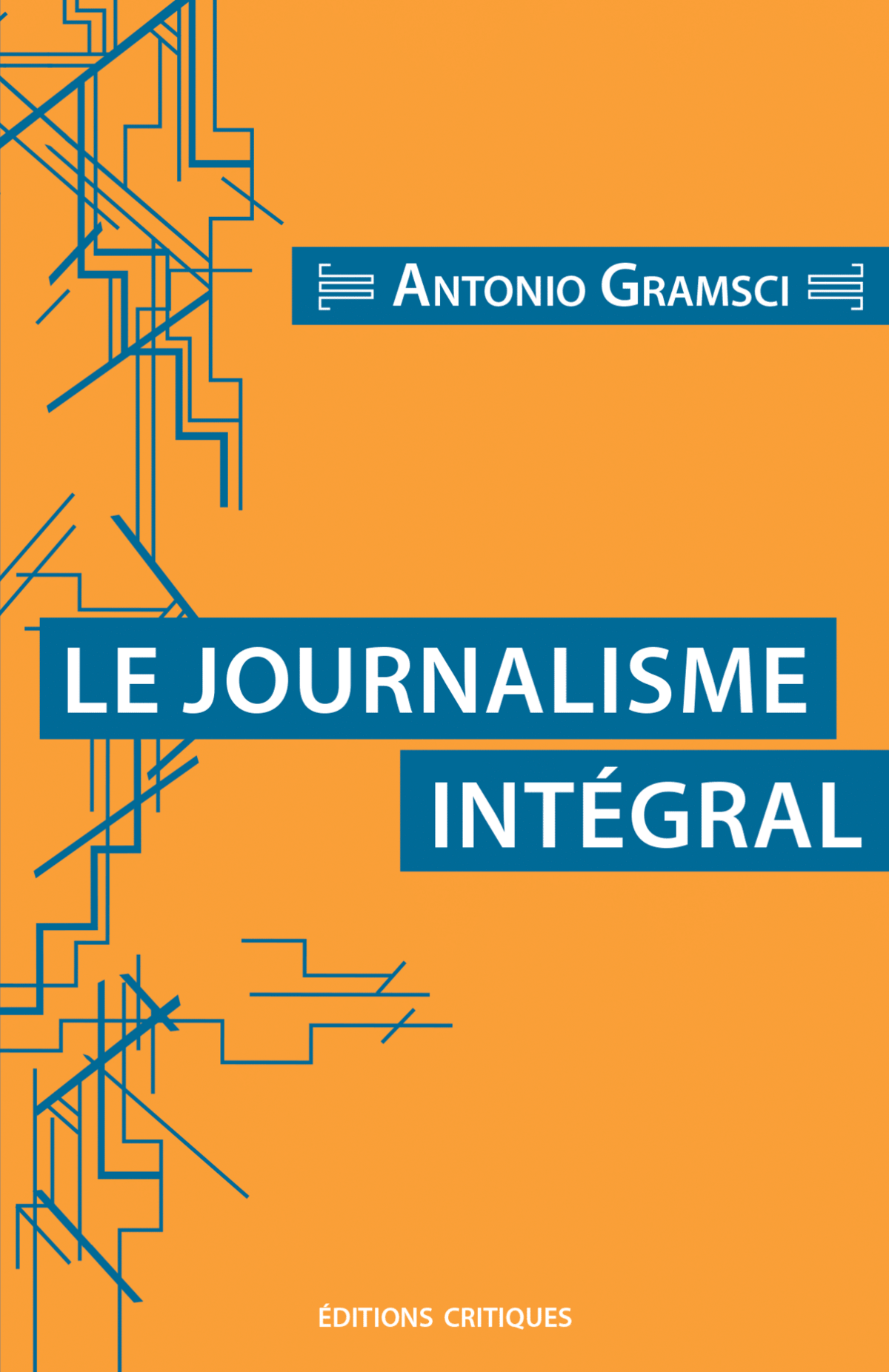
Agrandissement : Illustration 1
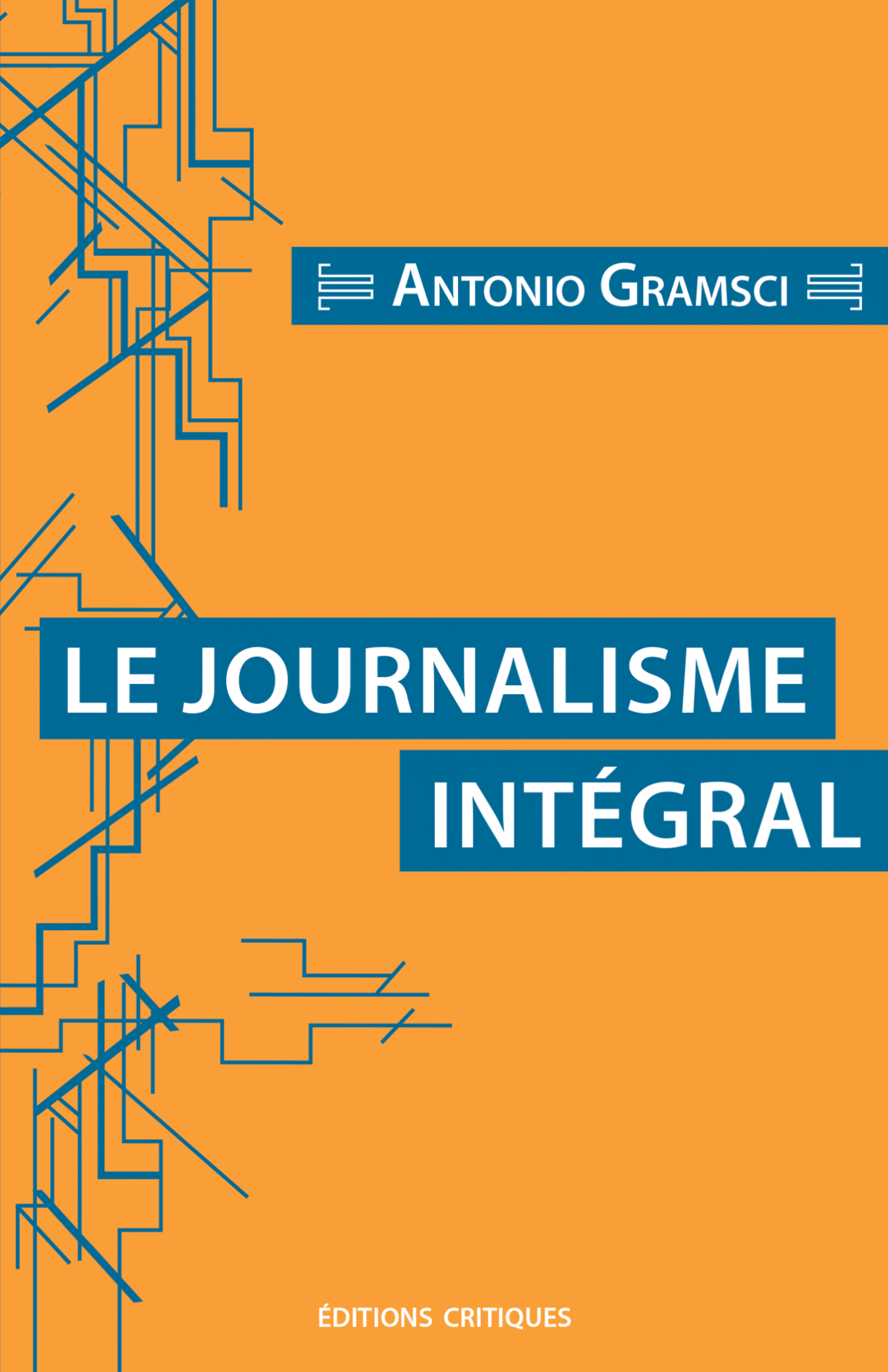
Ce qui saute aux yeux à la lecture du recueil, c’est en effet à quel point la visée transformative de la société commande toute l’approche de Gramsci. Rien de mieux que le retour à sa propre prose, pour se rendre compte de l’inanité des réappropriations contemporaines qui ont réduit son message à la préconisation inoffensive de « mener la bataille culturelle ».
De fait, certains s’en sont revendiqués à l’extrême droite pour décrire la manière de diffuser leurs idées en débordant la sphère de la compétition politique, tandis que d’autres y ont trouvé une référence chic pour habiller leurs préconisations de marketing électoral. Mais tous ont évacué l’idée centrale que la conquête de l’hégémonie, dans l’optique gramscienne, consistait pour les classes dominées à devenir les protagonistes d’un nouvel ordre social. Et que cet ordre social devait avoir pour maxime : « possibilité de réalisation intégrale de sa propre personnalité humaine accordée à tous les citoyens ». « Si cette maxime se concrétise, commentait Gramsci lui-même, tous les privilèges tombent du même coup. »
Les premiers textes du recueil sont tirés du journal socialiste Avanti !. Gramsci y égratigne la presse dite « bourgeoise » – même si plus tard, dans les Cahiers de prison, il reconnaîtra à certains titres de qualité, comme le Corriere della serra, une fonction pédagogique. Cette presse, dénonce-t-il, s’appuie sur le « désir de savoir » qui existe dans les masses, mais sa présentation des faits est biaisée et distordue en fonction des intérêts des classes dominantes. Sa conclusion ne fait pas dans la dentelle : « Ne donnez pas d’argent à la presse bourgeoise, qui est votre adversaire : tel doit être notre cri de guerre ».
D’un médium et d’une époque à l’autre, on serait tenté de reprendre, à propos des émissions et des chaînes fondées sur la polémique facile et le commentariat désinformé, son exhortation sans équivoque : « Boycottez-les, boycottez-les, boycottez-les ! »
« Une discipline permanente de culture »
Selon Gramsci, le désir de savoir doit être satisfait autrement, par des intellectuels fournissant une grille de lecture critique de la société, sans jamais lui asservir les vérités de fait. Cette culture commune antagoniste est d’autant plus nécessaire que l’ambition est bien de s’emparer du pouvoir concentré par les classes dominantes, afin de le partager et de l’exercer autrement.
Voilà pourquoi Gramsci est tout sauf démagogue. « La conquête des huit heures laisse une marge de temps libre qui doit être consacrée au travail de culture en commun, écrit-il dans L’Ordine Nuovo. Il est nécessaire de convaincre les travailleurs et les paysans qu’il est dans leur intérêt de se soumettre à une discipline permanente de culture, et de se forger une conception du monde, du système complexe et enchevêtré des relations humaines, économiques et spirituelles, qui donne une forme à la vie sociale du globe. »
Il assume, dans cette même parution, que certains écrits soient longs et difficiles. « Nous continuerons [d’en publier], affirme-t-il, chaque fois que l’importance et le sérieux des sujets l’exigeront ». Il y voit à la fois une nécessité révolutionnaire mais aussi une marque de respect pour son public : « Dans le domaine de la culture, les ouvriers et les paysans ont été et sont encore considérés par la plupart comme une masse de nègres qui peuvent facilement se satisfaire d’une pacotille, de fausses perles et de fonds de verre, réservant les diamants et autres biens de valeur aux élus. Il n’y a rien de plus inhumain et antisocialiste que cette conception. »
Dans le même temps, les journalistes engagés contre la « société mercantile » ne doivent pas rester en vase clos, dispensant leur savoir depuis le haut de leur chaire. La reproduction d’un rapport de domination, fondé sur une compétence intellectuelle valorisée, n’aboutit qu’à de la « pédanterie » et à la formation d’une « caste », écrira-t-il plus tard dans les Cahiers de prison. Évoquant le lancement de L’Ordine Nuovo au cœur des expériences conseillistes de 1919, Gramsci souligne que les articles « n’étaient pas de froides constructions intellectuelles » mais découlaient de rencontres et d’échanges : « ils élaboraient les sentiments, la volonté, les passions réelles de la classe ouvrière turinoise, qui avaient été éprouvés et provoqués par tous ».
L’objectif d’un journal « irremplaçable »
Parce qu’elle est en lien avec l’expérience vécue mais propose une connaissance critique déliée des intérêts bourgeois, la presse socialiste est à la fois attractive et unique, souligne Gramsci, qui appelle à la fierté de cette singularité, en dépit de la concurrence tape-à-l’œil subie de la part des titres que l’on dirait aujourd’hui mainstream.
D’ailleurs, le théoricien socialiste réfute l’idée de concurrence : « L’Avanti ! est un journal unique, sans concurrents, c’est le “produit” nécessaire que vous achetez parce qu’il est nécessaire, parce qu’il est irremplaçable, parce qu’il correspond à un besoin intime […] Qui achète l’Avanti ! ne choisit pas, ne peut pas choisir : on choisit entre deux choses semblables, différentes seulement par les degrés de perfection, entre deux chevaux, entre deux maisons, entre deux bâtons, entre deux journaux bourgeois. […] Il sait que l’Avanti ! n’est pas une société capitaliste […] mais représente, dès aujourd’hui, au milieu d’une société mercantile, le principe anti-mercantile, le principe communiste, qui impose la sincérité, la vérité et l’utilité essentielle même quand cela semble immédiatement dommageable. »
Dans le cahier 24 de son œuvre de prisonnier, Gramsci continue à réfléchir à la fonction du journalisme. C’est là qu’il le baptise « intégral », en imaginant dans le détail les différents types de revues, et leur contenu, qui pourraient participer d’un « travail éducativo-formateur » des subalternes. Il y aborde la notion de « sens commun », comme le précipité traduit, digéré et passé dans la vie quotidienne, de connaissances initialement élaborées par des intellectuels spécialisés.
En ce sens, comme le résume le préfacier Fabien Trémeau, le journalisme intégral de Gramsci est un des outils permettant de forger une « nouvelle hégémonie », annonciatrice de « la cité future ».



