[Paru dans le n°129 de la revue Politique]
Comme des poules avec un couteau. Cela fait un peu plus d’un an que les responsables politiques français se débattent avec une absence de majorité absolue, ou de majorité relative confortable, à l’Assemblée nationale.
En décembre 2024, pour la première fois depuis les années fondatrices de la Ve République, un gouvernement, celui de Michel Barnier, a chuté après s’être exposé à une censure des députés. La survie politique de son successeur, François Bayrou, semble bien précaire, tandis que l’incertitude plane sur une éventuelle nouvelle dissolution à partir de l’été prochain [depuis, l’annonce d’un vote de confiance ingagnable le 8 septembre a de fait scellé le sort du leader historique du Modem].
Ce qui se joue est tout à la fois une crise du régime et son entrée dans une nouvelle phase de son histoire – la troisième, après la cohérence trouvée par la droite gaulliste et ses alliés, puis la découverte et la routinisation de l’alternance droite/gauche.
1958-81 : les années fondatrices
Pour le comprendre, il faut revenir aux commencements du régime voulu par le général de Gaulle. En 1958, celui-ci s’est vu confier le soin de trouver une issue à la guerre de décolonisation en Algérie, entamée quatre années plus tôt. La IVeRépublique s’est en effet retrouvée dépassée par ce conflit, et c’est sous la menace d’une sédition militaire que ses dirigeants ont consenti à remettre son sort dans les mains du « plus illustre des Français ».
Coup de force légalisé, son retour au pouvoir lui a permis de jeter les base d’un nouvel arrangement entre les institutions du pays, son économie politique, et le rôle proposé à la nation sur la scène mondiale[1]. Ce triptyque peut se résumer de la façon suivante : la primauté et l’autonomie de l’exécutif sur le législatif ; une promesse de modernisation aux bénéfices (relativement) partagés ; et une politique de « grandeur » à l’échelle internationale, en dépit de la clôture de l’ère impériale-coloniale.
Devenu clef de voûte du régime, le président de la République peut compter sur un État fort qui constitue un arsenal nucléaire, lance des grands projets industriels, urbanise la France et transforme son économie paysanne en économie agricole. Le tout ne va pas sans contestations, mais les ménages voient globalement leur niveau de vie augmenter, et trouvent une forme de « réassurance collective » dans la place particulière que prétend occuper la France dans l’Alliance atlantique face au monde communiste.
De ce point de vue, une certaine unité caractérise les présidences du général de Gaulle (1958-69), de Georges Pompidou (1969-74) et de Valéry Giscard d’Estaing (1974-81)[2]. La vie politique devient alors de plus en plus clairement bipolaire, entre une droite et une gauche engagées dans des alliances au détriment forces centristes autrefois incontournables pour bâtir des majorités. Mais sur toute la période, c’est bien la droite qui monopolise le pouvoir national.
1981-2017 : alternances récurrentes et premiers dérèglements
Un deuxième âge de la Ve République commence en 1981. Politiquement, c’est l’année de la première alternance à l’Élysée et à l’Assemblée, au bénéfice de la gauche et du président socialiste François Mitterrand. En dépit de nouveaux droits et conquêtes sociales, la nouvelle majorité échoue cependant à ouvrir une troisième voie entre d’un côté un modèle capitaliste à la peine, que l’offensive néolibérale s’apprête à radicaliser au détriment du salariat, et de l’autre la faillite des bureaucraties autoritaires à l’Est.
Sur plus de trois décennies, un lent désassemblage de la cohérence initiale du régime s’est alors produit. La relance de l’intégration européenne, par le marché et la monnaie uniques, a contribué avec d’autres facteurs au crépuscule de l’État dirigiste, devenu « anesthésiste social » d’un capitalisme davantage extraverti et financiarisé. Le grand mouvement de réduction des inégalités s’est ralenti, au détriment des actifs modestes et des plus jeunes générations. Et sur la scène mondiale, le déclin relatif de la France, de plus en plus ramenée à sa condition de puissance moyenne, s’est confirmé.
Cela signifie que la captation du pouvoir par l’exécutif n’a plus été compensée par autant de résultats tangibles que par le passé. Signe de l’insatisfaction latente de la population, gauche socialiste et droite post-gaulliste n’ont cessé de se succéder l’une à l’autre à chaque scrutin national, qu’il soit présidentiel ou législatif. Un cas de figure inédit s’est par conséquent produit à plusieurs reprises, à savoir une cohabitation entre un chef de l’État et un chef de gouvernement aux appartenances politiques distinctes.
Mais ce qui n’a pas changé, c’est la possibilité pour chaque camp de monopoliser la majorité parlementaire, sans partager le pouvoir. La classe politique, en 2000, a même modifié la loi et la Constitution pour s’assurer d’une coïncidence entre quinquennat présidentiel et quinquennat législatif. Une façon de prolonger au forceps la domination présidentielle, au détriment du parlementarisme et de la participation citoyenne.
Il en a résulté la fragilisation croissante des deux grands partis de gouvernement, Les Républicains (droite) et le Parti socialiste (gauche), qui ont pour la première fois été éjectés du pouvoir national en 2017.
Depuis 2017 : les tribulations chaotiques de l’entreprise de sauvetage macronienne
Il s’ouvre alors, avec la transformation significative du système partisan, un troisième âge de la Ve République. Emmanuel Macron, mêlant centre-droit et centre-gauche compatibles avec le néolibéralisme, fait advenir l’équivalent d’une grande coalition à la française, mais sans contrat de gouvernement, puisque sous le patronage du monarque républicain dont il a revêtu les habits avec gourmandise.
La poursuite de la modernisation de la société française contre elle-même génère cependant des mouvements sociaux inédits par leur ampleur et/ou leur durée. Et si Emmanuel Macron parvient en 2022 à décrocher un second mandat, à l’issue d’une campagne apathique, menée dans la foulée de la pandémie de Covid et aux tous débuts de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Vladimir Poutine, le scrutin législatif qui suit le prive de majorité absolue. Le sort de son camp s’aggrave encore davantage après la dissolution de l’Assemblée nationale à l’été 2024.
Au-delà du macronisme, dont la boussole idéologique s’est de plus en plus déréglée vers la droite pour conserver le pouvoir, la scène politique tout entière sombre dans la confusion. Non seulement parce que les acteurs partisans doivent s’adapter à une situation inédite depuis six décennies, dans la mesure où ne prévalent ni le présidentialisme majoritaire, ni la cohabitation avec majorité absolue. Mais aussi parce que les dispositions de la Constitution n’aident en rien ces acteurs à trouver des formules gouvernementales stables et légitimes.
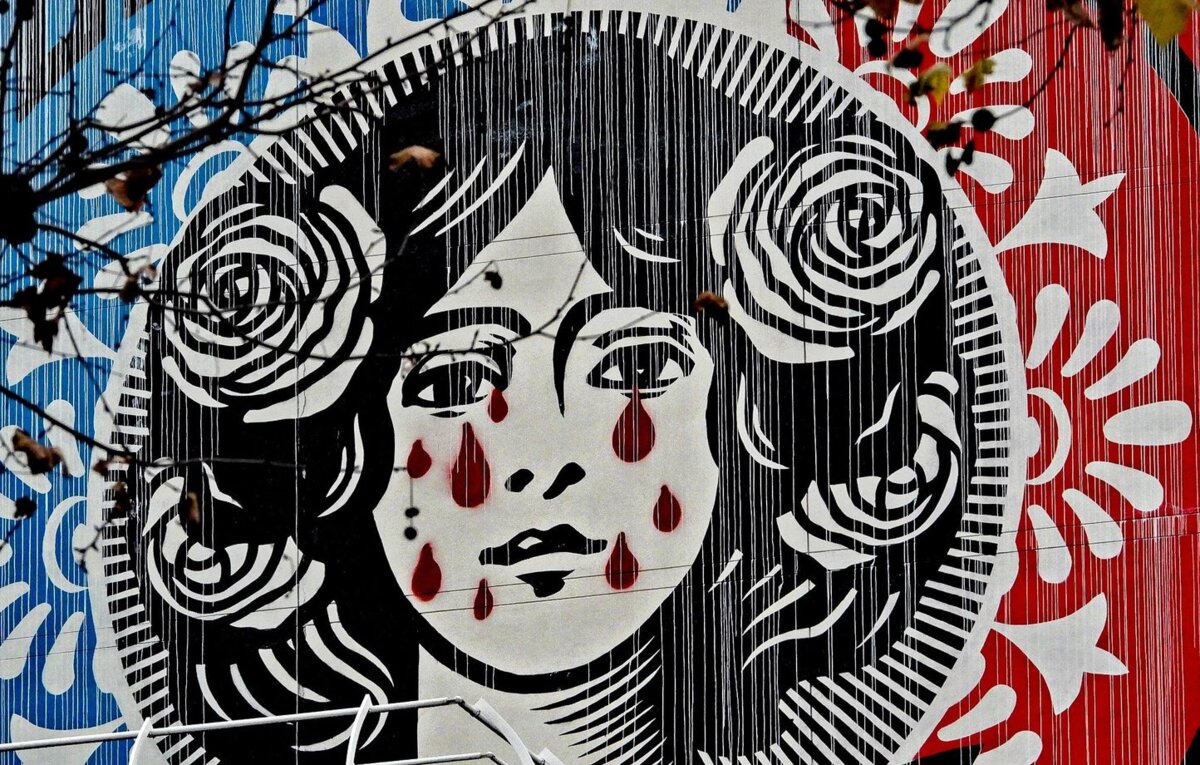
Agrandissement : Illustration 1

L’absence de proportionnelle, mais aussi l’horizon de la prochaine présidentielle où le gagnant peut espérer tout rafler, empêchent des coopérations entre les trois pôles qui structurent aujourd’hui la compétition politique : la droite radicale et nativiste hégémonisée par le Rassemblement national (RN), un camp présidentiel initialement défini par son attachement au paradigme néolibéral, et des gauches à la recherche d’une synthèse entre défense de l’État social, transition écologique et démocratisation du régime. Or, dans l’arène électorale, il est très peu probable que même avec le mode de scrutin actuel, l’un ou l’autre de ces pôles soit assez fort pour gouverner seul, à supposer que ce soit souhaitable.
Conjurer le risque de bascule autoritaire
L’avenir nous dira les caractéristiques dominantes de ce troisième âge du régime, dont nous ne vivons que l’amorce. L’impuissance collective qui se dégage aujourd’hui est d’autant plus alarmante, pour un grand État membre de l’UE comme la France, que la scène mondiale se recompose à grande vitesse. À la connivence entre les puissances révisionnistes russe et chinoise, s’ajoute désormais la « boule de destruction » trumpiste de l’ordre international. Le nouveau pouvoir états-unien ne se contente pas de « lâcher » l’Europe mais se pose en adversaire de son modèle politique libéral.
Le défi est énorme pour les républicains français, à gauche comme dans ce qu’il reste du centre-droit. Car le RN et ses alliés, vierges de tout exercice du pouvoir, proposent une issue claire et lisible à la crise de régime, qu’auront beau jeu de soutenir toutes les grandes puissances ayant intérêt à la déstabilisation du continent européen. Cette issue vise une unité tronquée de la nation, par la brutalisation et l’exclusion de toutes les minorités non conformes à une conception étroite et intolérante de l’identité française.
Bien entendu, le périmètre des personnes visées est appelé à s’élargir au fur et à mesure que l’inefficacité de ces remèdes immoraux sera évidente. Sous prétexte d’indépendance nationale, cette issue nativiste et autoritaire impliquera un triste avenir de vassalité envers les États néo-impériaux se partageant des sphères d’influence.
L’alternative résiderait dans une VIe République, fondée sur une relativisation de la figure présidentielle, une Assemblée élue à la proportionnelle et dotée de davantage de moyens, et des capacités accrues d’intervention citoyenne dans les processus de décision.
Mais la martingale n’est pas qu’institutionnelle. Si le régime de la Cinquième trouvait sa cohérence initiale dans la promesse de modernisation et l’horizon symbolique fixé au pays, des républicains de progrès doivent s’efforcer de bâtir des protections sociales et écologiques face aux vulnérabilités contemporaines, et de réinventer un rôle français au service de la défense du continent et de ses valeurs les plus universalisables.
[1] Sur les débuts de la Ve République, je me permets de renvoyer à ma série d’articles « Aux origines de la (bientôt) doyenne des Républiques » publiée sur Mediapart. Quant à la notion élargie de « régime » que je vais déployer dans la suite de l’article, je l’ai forgée dans mon essai Une République à bout de souffle (Éditions du Seuil, 2023).
[2] C’est ce que s’attache à démontrer le récent premier volume de l’Histoire de la Ve République (Robert Laffont), sous la direction d’Éric Roussel et Frédéric Turpin.



