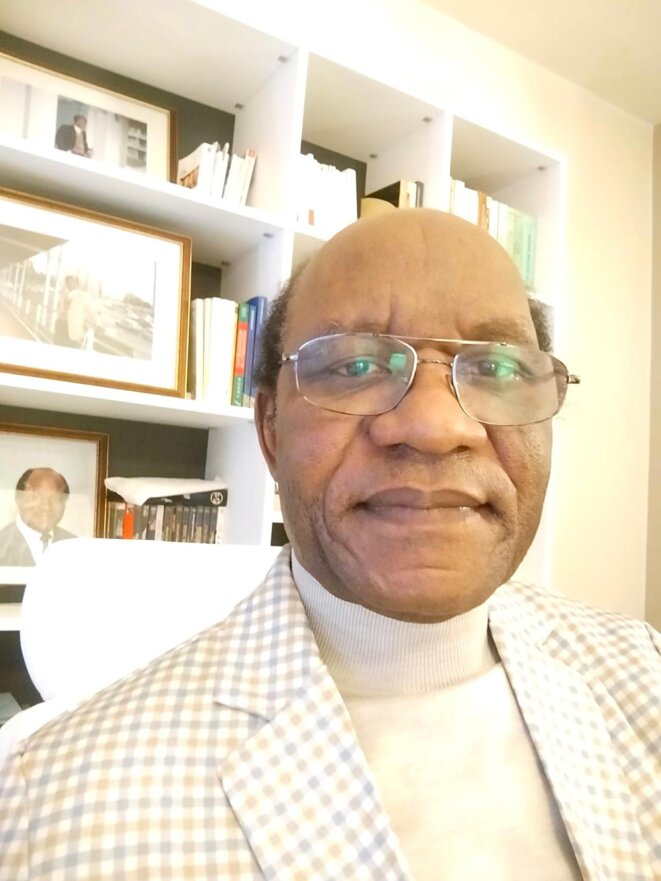Texte du 23 novembre 2011
Bien que les choses apparaissent évidentes, il ne manque toujours pas du monde, de bonne ou de mauvaise foi, pour s'interroger encore sur la nature du régime politique qui a succédé à Pascal Lissouba,définitivement élu président de la République le 31 août 1992, et militairement évincé le 15 octobre 1997 par Sassou-Nguesso et des forces armées armées étrangères, principalement angolaises et tchadiennes, avec le soutien tactique et financier des réseaux français.
Explication, suite à la question suivante, la première d'une dizaine d'autres à suivre, de Monsieur Mingwa Biango, responsable du site Congo Liberty, le 23 novembre 2011 :
" Vous êtes constitutionnaliste et beaucoup d’observateurs disent que la Constitution actuelle de Sassou Nguesso est non seulement illégale, mais antidémocratique. Quel est votre avis à ce sujet ? "
Ce n’est pas la bonne approche, ne fusse-que parce qu’en Afrique bien souvent l’étiquette n’est en rien conforme au contenu, même si elle en donne une indication. Toutes les constitutions, aujourd’hui comme hier, y compris sous le monopartisme où l’on torturait et tuait aussi copieusement, se parent, à travers quelques dispositions, d’une façade démocratique sans toutefois réussir à s’affranchir des vestiges autocratiques. Ainsi, par exemple, toutes les constitutions congolaises, depuis l’indépendance, prévoyaient tout un titre sur les libertés publiques. En général c’était le titre 2.
La bonne approche c’est d’abord le mode d’établissement d’une Constitution, qui s’apprécie par l’organe d’élaboration et le contexte. En termes simples, qui a fait le texte et comment ? Selon que l’organe initial d’élaboration de la Constitution est ouvert, c’est-à-dire constitué en collège formé après débats ou consultations, sans emprise personnelle ou partisane, et dans un contexte démocratique, ou au contraire si le texte initial qui en général sert de socle est octroyé, selon la volonté du ‘prince’, vous aurez un mode d’établissement soit démocratique soit autocratique. La suite, après cette période initiale, c’est une affaire de respect strict des règles et formes.
Les deux dernières Constitutions congolaises (de 1992 et 2002) illustrent bien ces deux modes d’établissement. Nous connaissons tous le débat au sein de la conférence nationale pour le maintien ou pas de la dernière Constitution du mono de juillet 1979 jusqu’au choix de l’Acte fondamental du 4 juin 1991 qui préfigurait la Constitution du 15 mars 1992. Avec des bas et des hauts, cette première Constitution qui prévoyait des possibilités de modification, c’est-à-dire d’amélioration, est indiscutablement démocratique, et personne ne vous dira jamais le contraire. A l’inverse, après la débâcle démocratique de l’été 1997, l’avènement de l’Acte fondamental du 24 octobre 1997, socle de la Constitution du 20 janvier 2002, et qui a tout l’air d’une colombe sortie du mouchoir d’un magicien, porte tous les signes de ce qu’on appelle en droit constitutionnel un texte octroyé, c’est-à-dire un régime unilatéralement défini par un individu ou un groupe, en toute opacité, selon ses propres intérêts d’abord. La particularité de l’acte octroyé, et de ce qui en découle, est qu’il reste perpétuellement soumis aux caprices de son auteur. Vous comprenez ainsi que prévu pour deux ou trois ans par ses auteurs, l’Acte de 1997 a tout de même vécu cinq ans, de la même façon que vous comprendrez toute l’effervescence autour de la ‘Constitution’ de l’heure pendant tout l’été 2010 pour l’adapter aux nouveaux désirs du chef qui n’ont été refrénés qu’en raison du mouvement dans le monde arabe.
Les Congolais se rappelleront que le forum organisé par la suite, au printemps 98, lieu dit-on de débat, n’a pas changé une virgule à ce texte de 1997, démontrant par là-même, comme par le passé, la poudre aux yeux qu’aura constitué le forum, que les règles sont en réalité arrêtées d’avance par un petit temple, et la soumission de l’ensemble du peuple à la volonté d’un individu ou d’un petit groupe. La suite, y compris la construction et le scénario du texte de janvier 2002, n’est que mise en scène puisque, selon les règles d’usage, rien objectivement, sauf bien sûr le coup d’État qu’ont du mal à assumer les pontifes du régime, ne peut expliquer le passage de l’une à l’autre au mépris des formes impératives, ou pourquoi ce nouveau texte et pas le précédent démocratiquement adopté en 1992 !
En effet, le texte dont vous me parlez est d’inspiration et de souche autocratique d’abord en raison de son mode d’adoption comme je viens de vous l’expliquer, mais ensuite et surtout à propos de son contenu car beaucoup de dispositions du régime de 2002 constituent un recul que, dans mes écrits, j’ai résumé en une expression, un présidentialisme forcené et archaïque (1), avec, notamment : un mandat sans précédent de sept ans alors que l’ère est à la réduction de la durée des mandats ; un régime présidentiel formel sans vice-président contrairement au modèle américain de référence et au régime présidentiel congolais de la 1ère République (Constitution du 2 mars 1961); des ‘sages’ tous nommés contrairement au dispositif de 1992 et dont on ne s’étonnera par conséquent pas qu’ils se permettent le moment venu de petits arrangements ; le retour au dispositif des ordonnances et des pouvoirs exceptionnels dont la nocivité dans notre histoire économique et politique est établie…
Bref, au Congo, depuis octobre 1997, c’est, grosso modo, l’ancien régime ressuscité, parce que nous vivons, au-delà d’une façade démocratique affichée par certaines dispositions constitutionnelles comme par le passé, une véritable transition autocratique dont on ne peut tout à fait maîtriser l’issue, comme il en va de tout régime issu et fondé sur la force et le sang.
------------------------------------------------------------------------
1. Félix Bankounda, La Constitution congolaise du 20 janvier 2002, une Constitution mort-née, Politeia, numéro 3, 2003