Malaise démocratique
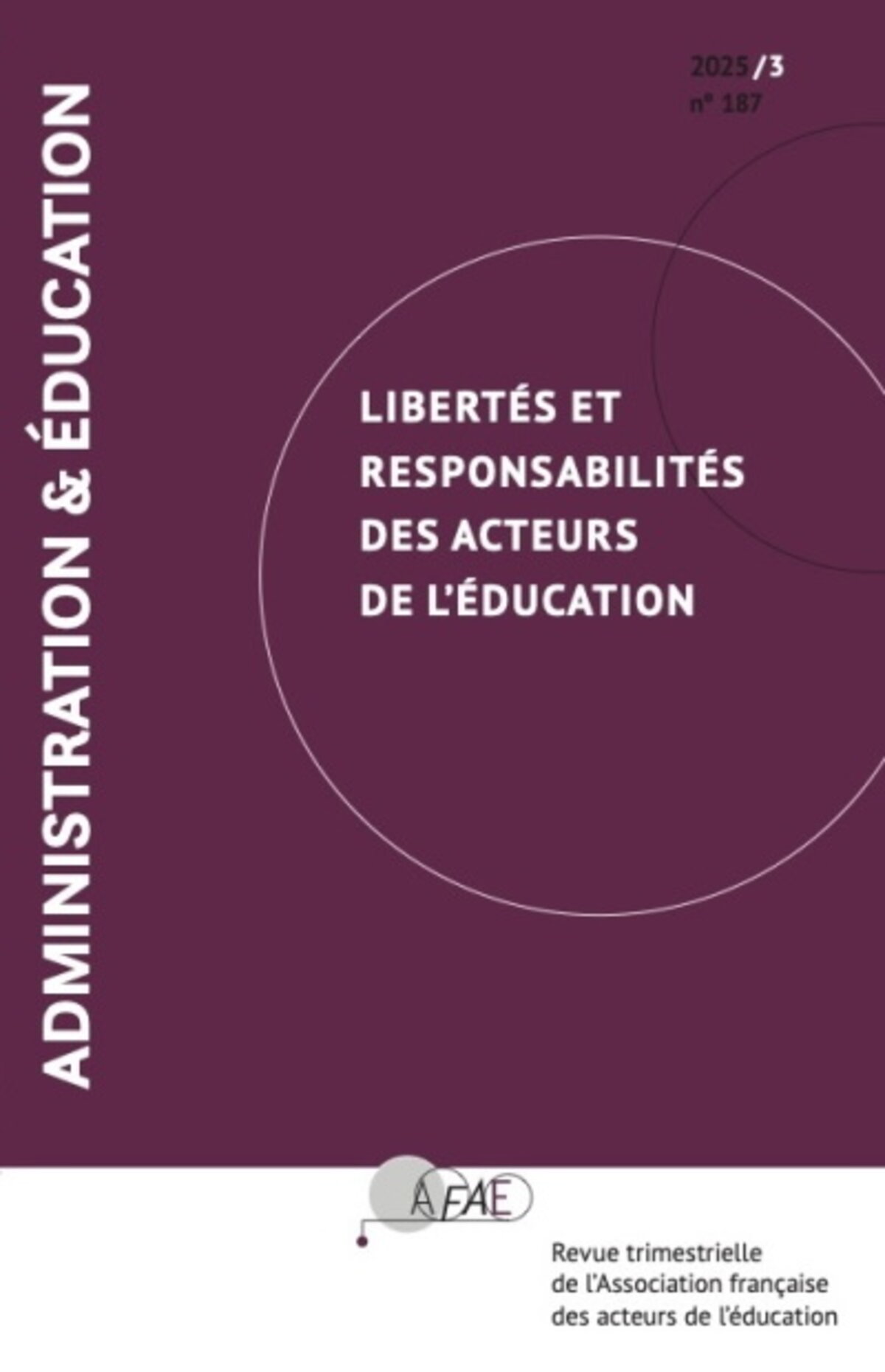
Agrandissement : Illustration 1
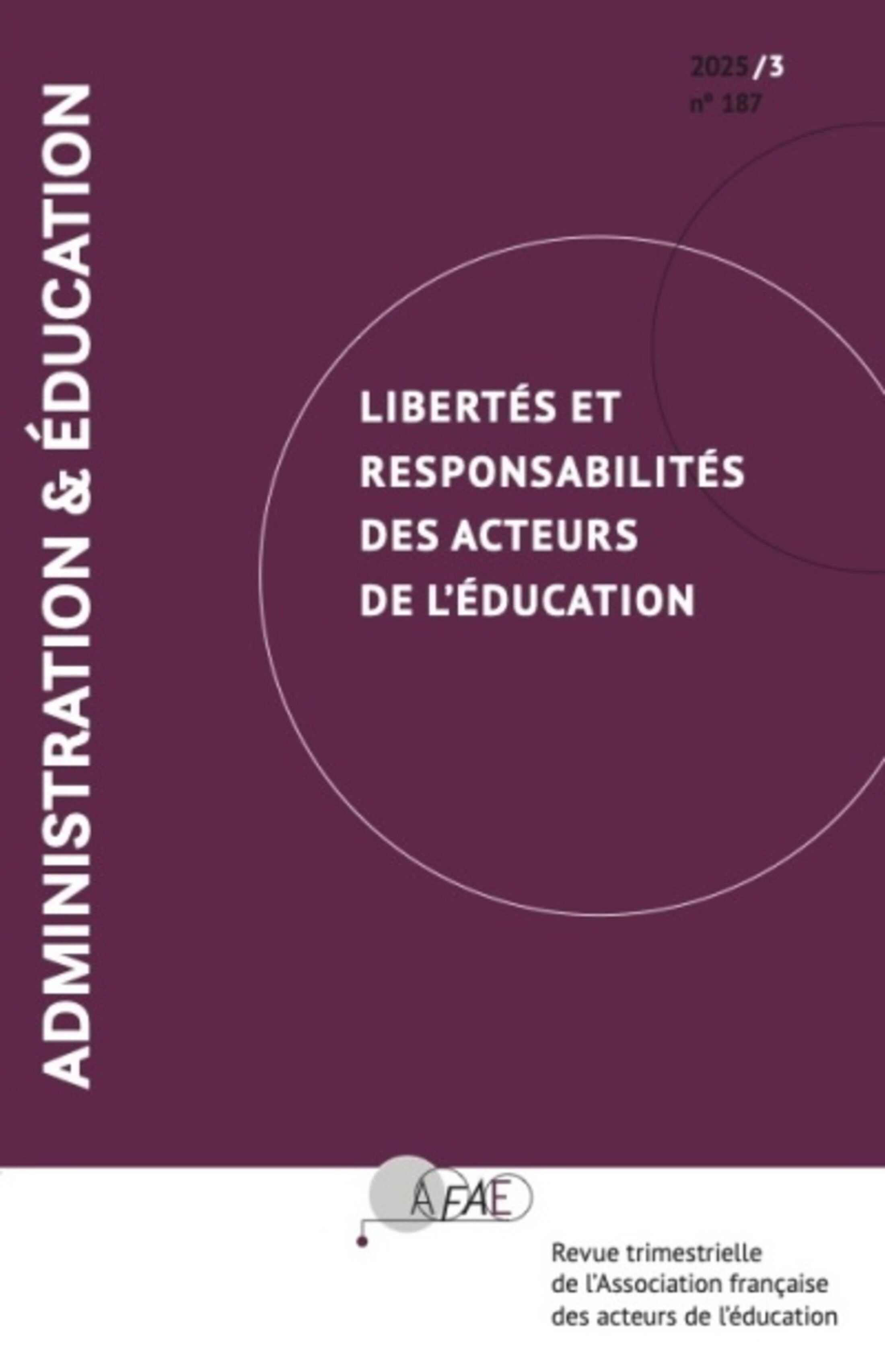
"Quelles libertés ? Quelles responsabilités pour les acteurs de l’Éducation ? Quels sens la liberté donne-t-elle à la responsabilité et vice-versa ?" En présentant le numéro 187 d'Administration & éducation, la revue de l'AFAE, F. Moulin Civil, présidente du Conseil scientifique de l'éducation nationale, tente de raccrocher cette édition au numéro de mars 2005 consacré au même sujet. Mais le numéro de 2025, issu du colloque de Montpellier, évoque "un paradoxe français" là où celui de 2005 abordait directement la question : "De la classe à l’établissement : responsabilité individuelle, responsabilités collectives". Vingt ans plus tard, plus aucun article injonctif sur les responsabilités des acteurs de l'éducation. Le numéro de 2025 nage dans la déploration et le dépit. Que sont libertés et responsabilité devenues ?
Pourtant l'AFAE ouvre grand les angles d'attaque. Pascale Bertoni et Raphaël Matta-Duvignau rappellent les contours juridiques de la liberté pédagogique des enseignants et de l'autonomie des établissements. Thomas Coutrot, un économiste, en traitant la question sous l'angle du rapport au travail et du "lean management", est déjà dans la rupture avec la problématique classique de la responsabilisation des acteurs.
A partir de là, toutes les interventions développent la crise. Ecoutons Frédérique Weixler, inspectrice générale, ancienne conseillère de N Vallaud-Belkacem, parler du "malaise démocratique quasi-existentiel" dans la communauté éducative. "Si l’institution enjoint aux personnels d’encadrement de développer leur leadership et leurs compétences managériales, les enseignants se vivent plus souvent comme le réceptacle de décisions prises sans qu’ils y aient été associés. La liberté pédagogique est ainsi conçue plutôt au niveau individuel de l’enseignant et l’autonomie (ou la marge d’autonomie) de l’établissement comme une prérogative de l’équipe de direction. Dans le même temps, on observe depuis quelques années un glissement du terme « décision » vers des mots-valises : pilotage, management, leadership, concertation… Ce flou sémantique évite d’interroger notre rapport au pouvoir... Les enseignants qui bénéficient de la liberté pédagogique, c’est-à-dire de l’affirmation de l’indépendance du savoir par rapport à l’autorité politique, se sentent cependant le réceptacle des politiques éducatives plutôt que leurs coauteurs". Ils sont aussi sous la pression des "performances" à atteindre.
Autre illustration du "malaise démocratique, la seule participation enseignante à ce numéro, lesdeux pages accordées à Franck Pichot, professeur de SVT. Il conclut ainsi son intervention : "ma prise de parole a voulu montrer qu’au-delà des discours officiels sur la liberté pédagogique, nous évoluons dans un cadre de plus en plus contraint, frustrant, et parfois même absurde. C’est dans cette impasse que j’ai ressenti le besoin de réorienter ma trajectoire professionnelle, dans l’espoir de retrouver un espace d’expression plus libre". Le seul enseignant invité aspire à passer dans le supérieur et à déserter l'enseignement scolaire. Tout un symbole !
"L' exposition permanente au risque de la faute"
Roger-François Gauthier, ancien membre du Conseil supérieur des programmes, dresse un tableau apocalyptique de l'éducation. Il évoque sa déception et sa colère et la "démission des organisations humaines à organiser l'éducation". "Comme tout s'écroule on ne sait dans quelle direction aller". Il appelle l'Ecole à des renoncements pour redéfinir les savoirs à enseigner dans un projet humaniste.
Vincent Stanek, recteur, ancien conseiller pédagogique de JM Blanquer, vole encore plus haut. "Dans la sphère de l’éducation, jamais les principes d’autonomie, de responsabilisation, de décentralisation, de déconcentration, de confiance n’ont été à ce point affirmés et jamais, dans le même temps, on n’a entendu de démentis aussi vigoureux à ces affirmations, et qui font plutôt le constat d’une déresponsabilisation, d’une infantilisation, d’un manque de confiance, etc., de la part de l’institution scolaire", affirme t-il, fort dépité. A cela une raison : la responsabilité serait "le préalable de la culpabilité". "Cette figure d’une responsabilité hantée par la culpabilité, assombrie par la possibilité de la faute n’est-elle pas malheureusement de plus en plus répandue ?... La responsabilisation peut être liberticide quand l’accumulation des responsabilités fait que l’exercice de la liberté au sens de la capacité d’initiative est vécu comme une exposition permanente au risque de la faute". Dans cette vision très catholique, il interprète la sous-traitance par les professeurs de la vie scolaire à des professionnels, "la tentation de déléguer à l’AESH tout le poids de son inclusion au milieu ordinaire".
Et là on mesure à quel point, même l'AFAE, ancienne association des administrateurs de l'éducation nationale, est sortie des rails du new management ! La question de la responsabilisation des acteurs qui ne leur donne que la liberté de gérer au moins cher le système éducatif ressort du colloque de Montpellier particulièrement essorée !
Quelle liberté face au populisme éducatif ?
On pourra s'appuyer sur l'article de G Chaix, ancien recteur, pour donner du sens à cette évolution. Il aborde la question en historien en s'appuyant sur les travaux de Xavier Pons, nouveau directeur de l'IFE. Dans "La fabrique des politiques d'éducation" (PUF 2024), Xavier Pons montre comment l'Ecole est passée de "la communauté de politique publique", où institution, experts et acteurs professionnels pilotent le système éducatif à un modèle décommunautarisé où s'appliquent les règles du New Public Management sous l'oeil d'experts étrangers au monde éducatif. Il annonçait l'arrivée, depuis N. Sarkozy et surtout JM Blanquer, d'un nouveau modèle : celui du "puzzle accéléré".
"Cela renvoie à une façon de fabriquer les politiques éducatives où on avance par petites touches successives sur des dossiers qui, en apparence, sont techniques et déconnectés les uns des autres, mais en fait dessinent un changement profond du système", me disait-il en 2024. "Mais comme on analyse séparément chaque pièce c'est seulement quand on a un nombre suffisant de pièces que l'on comprend le paysage d'ensemble. En science politique on parle d'incrémentalisme : on réforme par petits changements successifs... C'est la dernière pointe du néo libéralisme".
Dominée par ce modèle, l'Ecole n'est plus à même de débattre sur la question "liberté/responsabilité". L'évolution du système éducatif échappe totalement aux acteurs du système éducatif, même de très haut niveau comme les auteurs de ce numéro. Ils ne sont plus que les rouages, désolés ou en colère, de bouleversements qu'ils doivent porter en n'ayant ni liberté ni responsabilité. Gérald Chaix fait un inventaire rapide de ces bouleversements : autonomie des établissements avec injonction envers les enseignants à se "mobiliser autour du projet d'établissement", pour reprendre les termes de la Cour des Comptes, réformes des lycées et des collèges, dont on mesure actuellement pleinement les effets négatifs. Comme X Pons, il y voit un "populisme éducatif" caractérisé par le fait que " les gouvernants proposent un programme d’action publique flattant les attentes perçues de la population sans tenir compte des propositions, des arguments et des connaissances produites dans le cours de l’action par les corps intermédiaires ou les spécialistes du sujet".
Dans cet univers dominé, il reste une lumière et un espoir de reconquête. C'est celui de la responsabilité de chaque adulte éducateur face au petit homme. Face au populisme éducatif, il y a là un levier de liberté, éternel.
François Jarraud
Administration & éducation, n°187, "Libertés et responsabilités des acteurs de l’éducation".



