Une autonomie inévitable ?
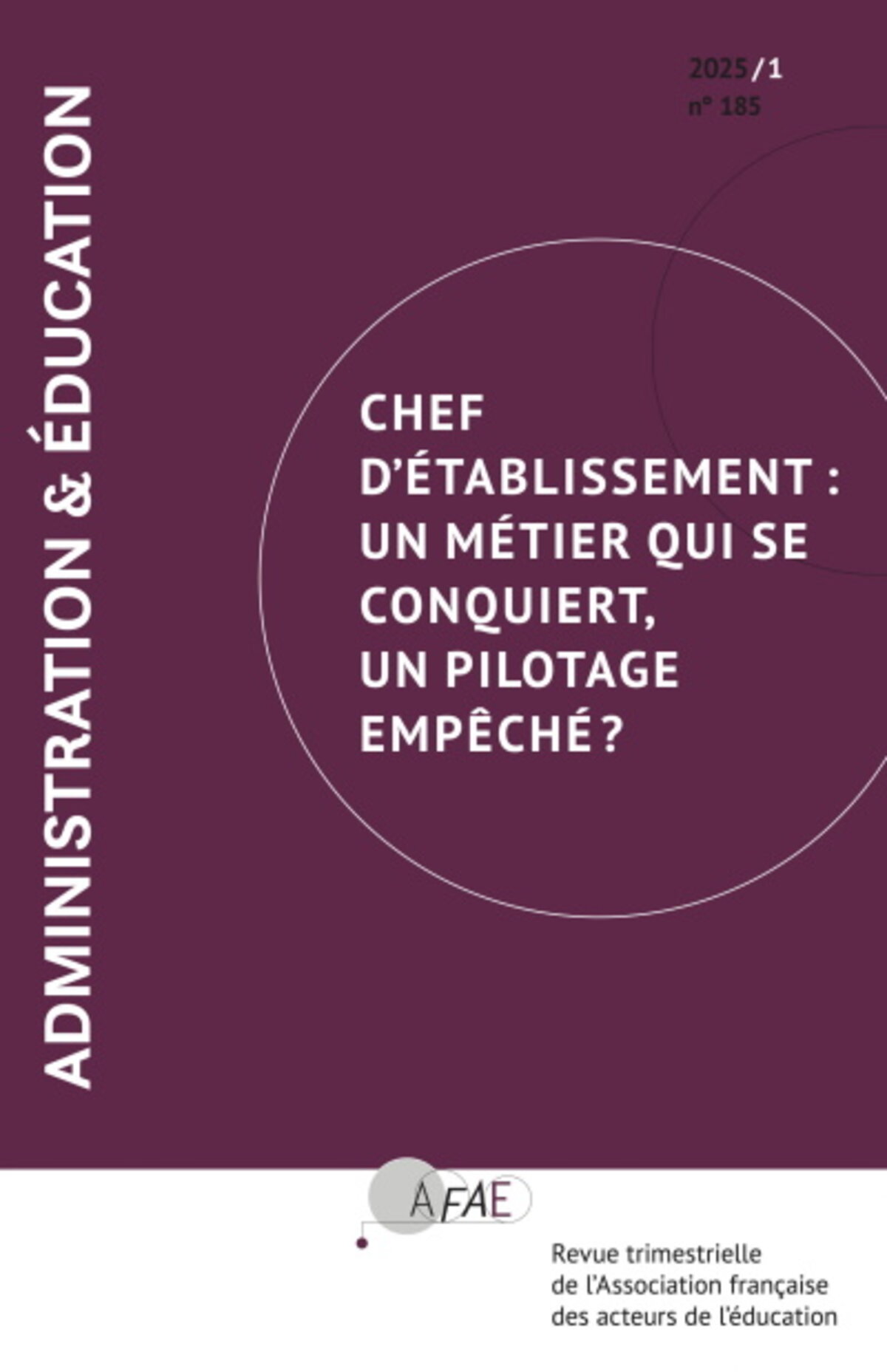
Agrandissement : Illustration 1
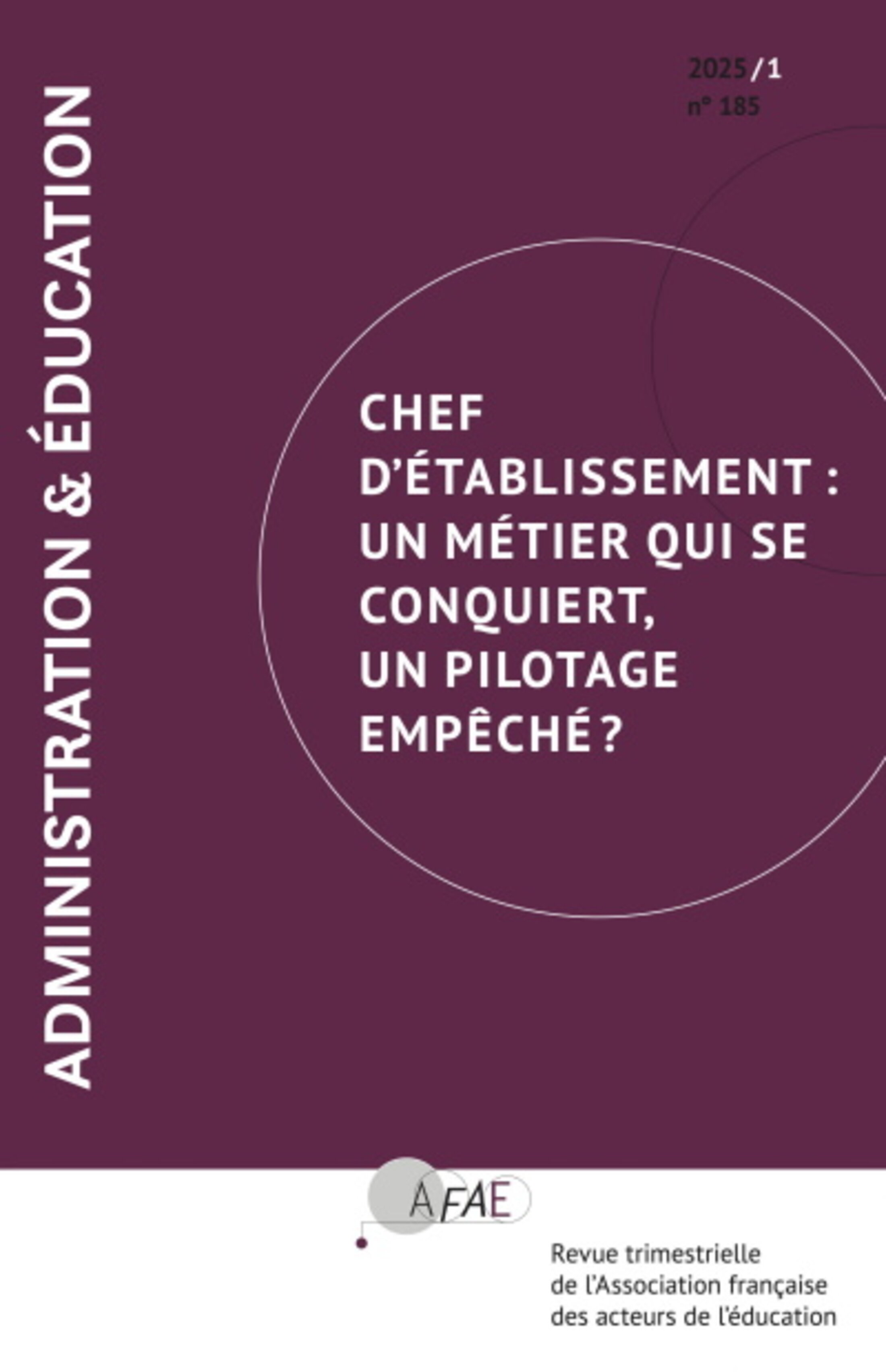
"Chef d’établissement : un métier qui se conquiert, un pilotage empêché ?" Après l'imposition du Choc des savoirs par G. Attal, le numéro 185 de la revue de l'AFAE met les pieds dans le plat. Les articles, en toute liberté, ne cachent pas que l'autonomie des établissements, promise depuis le décret de 1985 et la loi d'orientation de 1989, n'est pas au rendez-vous.
Notons que la revue, coordonnée par Claude Bisson-Vaivre, Barbara Martin et Éric Tournier, n'interroge pas vraiment le principe de l'autonomie des établissements. Au contraire, elle est présentée comme la meilleure organisation possible pour l'Education nationale. Ainsi, A. Boissinot, ancien recteur, ancien conseiller de F Bayrou, ex directeur de cabinet de Luc Ferry, nous explique qu'il y aurait la bonne et la mauvaise autonomie. La mauvaise c'est celle qui voit les établissements autonomes mis en concurrence avec ce que cela entraine comme inégalités sociales. Et la bonne c'est "une forme d’autonomie qui n’est pas un éclatement du système dans une logique d’évaluation concurrentielle des établissements, mais la recherche d’un meilleur équilibre entre le cadrage national et les initiatives locales, d’une distinction plus claire entre les fins définies par l’État et les moyens à mettre en oeuvre par les acteurs. L’autonomie n’est pas une indépendance d’entités rivales, mais une tension entre libertés et responsabilités". Une vision qui semble assez utopique. A. Boissinot regrette que cet équilibre soit pris entre "la tradition individualiste de la "liberté pédagogique" des enseignants" et "la volonté de recentralisation".
Pourtant il y aurait à dire sur cette autonomie. On se rappelle le remarquable échec de la réforme suédoise qui avait poussé le plus loin l'autonome des établissements en désétatisant le système éducatif et en accordant une pleine autonomie de gestion et pédagogique aux établissements. PISA lui-même montrait que le niveau des élèves avait fondu. Plus récemment, une étude réalisée par Natalie Irmert, Jan Bietenbeck, Linn Mattisson et Felix Weinhardt dans 16 pays montre qu'elle bénéficie aux élèves les plus favorisés et nuit aux moins favorisés.
L'autonomie sous pression budgétaire
Une table ronde associant des personnels de direction (perdirs) et une directrice d'école, totalement assimilée aux perdirs, oriente ce constat. La plus grande difficulté pour eux c'est de faire passer des réformes qui leur tombent dessus à un rythme accéléré. "L’autre mission, qui devient de plus en plus importante, est de lisser des réformes et des mesures qui se succèdent à un rythme souvent effréné", déclare un principal. Entendez qu'il ne s'agit pas seulement du contenu des réformes. Mais aussi de leur contenant budgétaire. Les personnels de direction expliquent que leur autonomie budgétaire est rognée en même temps que la pédagogique. Tous voient leur DGH sérieusement diminuer. Et la mise en place des réformes se fait partout en diminuant l'offre pédagogique. Ici, au collège, on supprime les postes vacants pour alimenter les groupes. Là, dans un lycée, en contraignant les choix des élèves. Partout, les projets des enseignants sont réduits. Et cela s'aggrave avec la baisse des moyens donnés par les collectivités territoriales.
Le leadership des chefs d'établissement semble donc surtout menacé par la gestion budgétaire et les injonctions de l'administration centrale. On se rappelle que la mise en place des groupes de niveau du Choc des savoirs, ignorait le décret de 1985 sur l'autonomie des établissements. Autonomie renforcée avec les projets d'établissement inscrits dans la loi d'orientation de 1989. Les chefs d'établissement semblent coincés entre leur devoir de loyauté et l'autonomie légale et promise.
Plusieurs articles de chercheurs élargissent cette analyse. E. Murier, L Progin, L Ria montrent que le plus difficile pour les chefs d'établissement est plutôt la notion de leadership. Ainsi seulement 10% voient ce leadership comme "convaincre et faire adhérer". Ils se voient plutôt en pilotes et entraineurs. Dans leurs activités, les moins réalisées concernent les relations avec les enseignants. " Le premier frein rencontré par les personnels de direction est le manque de reconnaissance de leur légitimité pédagogique du côté des équipes enseignantes", estiment les chercheurs. Christine Nison renforce ce constat. Elle rend compte d'une enquête menée auprès de plus de 2000 personnels de direction. " Comment peuvent-ils être perçus comme pilotes pédagogiques lorsque leur domaine de compétences dans les ressources humaines, par exemple, est restreint au strict minimum ?", interroge t-elle. L'enquête montre aussi "l'emballement de l'institution", une "machine folle" qui multiplie les réformes et transforme les chefs d'établissement en "simples exécutants des consignes systématiquement verticales". Enfin elle souligne le manque de formation des personnels de direction au leadership. " Les activités du chef d’établissement sont donc souvent langagières et le management prend une dimension stratégique. À ces rôles-là, le personnel de direction n’est pas nécessairement préparé."
La Cour des Comptes et l'Inspection au chevet des perdirs
Ce numéro d'Administration et éducation sort alors que plusieurs rapports récents ont remis les chefs d'établissement au coeur de la réflexion ministérielle. La Cour des Comptes, en janvier 2023, dans un rapport intitulé "Mobiliser les communautés éducatives", demande de renforcer leurs pouvoirs. Elle souligne qu'ils ne gèrent guère que "de 2 à 5% de la DGH". Ainsi sur 5 938 000 heures payées pour les IMP, 5 884 000 heures sont déjà fléchées par le ministère. Cela laisse peu de moyens pour le projet. Sans surprise, la Cour découvre que la moitié des établissements n'ont pas de projet d'établissement. "La démarche de projet stricto sensu, dont le socle demeure la réflexion pédagogique, a progressivement disparu ; sa mise en oeuvre semble dépendante de l’appropriation de la démarche par les chefs d’établissement, qui l’appréhendent trop souvent avant tout comme une obligation réglementaire que comme une nécessité interne à l’établissement", relève la Cour. Elle demande de donner aux chefs d'établissement un rôle dans la rémunération des enseignants afin d'imposer leurs choix pédagogiques. Et de gérer les établissements dans le cadre de contrats tripartites (avec l'Etat et la collectivité locale) basés sur les résultats des élèves.
En septembre 2024, l'Inspection générale publie un rapport "Etre chef d'établissement dans le 2d degré aujourd'hui", qui, s'il reste mesuré dans ses recommandations, ne cache rien des ambitions du métier. "La reconnaissance de leur statut de cadre de terrain est un sujet récurrent, dans lequel la rémunération n’est qu’une partie de la problématique. S’y ajoutent la confiance que leur accorde l’institution et, en conséquence, l’autonomie de décision, mais aussi leur accompagnement professionnel et personnel dans l’accomplissement de leurs tâches et la construction de leur parcours. La perte de sens exprimée par un grand nombre d’entre eux est révélatrice d’un manque", écrit l'Inspection. Elle relève la baisse importante des candidats aux concours de perdirs.
Une telle réflexion avait eu lieu en 2008, marquée par une publication de l'OCDE (Improving School Leadership) sur les directions définissant le leadership comme un pouvoir d'influence sur les personnels. En 2006, Anne Barrère avait déjà mis l'accent sur le manque fondamentale du métier dans un ouvrage de référence (Sociologie des chefs d'établissement : les managers de la République, PUF). Tout en reconnaissant qu' "ils sont plutôt hostiles au double système actuel ou une lourde bureaucratie les exhorte à l'autonomie. Ils aimeraient une clarification du type de contrôle dont ils sont redevables", elle nous disait que "c'est le rapport aux enseignants qui reste le plus impensé. Certains construisent une professionnalisation en articulation avec les enseignants. D'autres pas. Aujourd'hui le métier est au coeur de contradictions qui dépassent les chefs d'établissement".
Quelle définition pour le leadership ?
Depuis quelques mois, les pressions s'accentuent sur un métier qui semble en étau entre trois mâchoires. D'abord les réformes impulsées par le ministère à un rythme de plus en plus rapprochés. Le dernier Baromètre Unsa montre qu'une majorité de personnels de direction n'y adhèrent plus. Ce n'est donc pas seulement le rythme qui pose problème. La seconde est la pression budgétaire. Depuis 2022 elle s'est énormément renforcée. La marge d'autonomie des perdirs s'est réduite avec la baisse des moyens versés par l'Etat et, maintenant, les collectivités territoriales. Les dernières annonces gouvernementales annoncent un nouveau et massif tour de vis.
La troisième, et la plus déterminante, c'est la relation avec les enseignants. C'est là que va se définir le sens donné au mot leadership. Certains rêvent d'avoir la carrière et la paye des enseignants en main pour affirmer un pouvoir pédagogique. D'autres voient le leadership comme une capacité à soutenir les projets enseignants et à créer une synergie commune. Il semble que le moment de la mise à jour soit arrivé.
François Jarraud
Chef d’établissement : un métier qui se conquiert, un pilotage empêché ? Revue Administration & Éducation – No 185 – 2025/1



