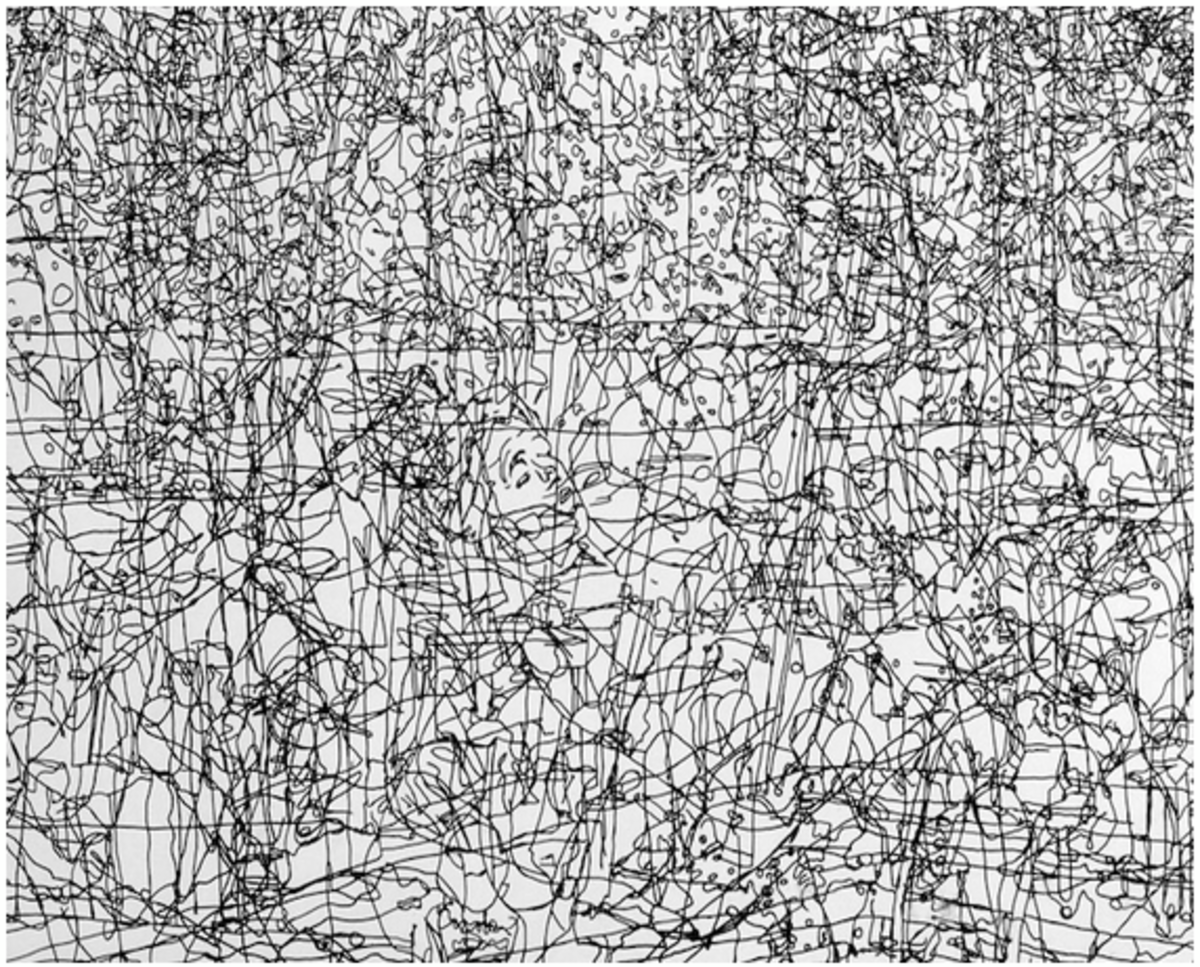
L’allégorie privilégiée du monde numérique est sans contestation possible celle du réseau. Contre l’idée de centralisation, et même de décentralisation – qui implique toujours l’existence de pôles prévalents – la distribution est devenue l’idéal organisationnel de toute une génération de technophiles. Car le réseau porte en lui tout un programme, politique et économique. Il intègre à la fois une critique des injustices inhérentes aux structures formelles et pyramidales et une remise en cause de la performance de l’entreprise sous sa forme bureaucratique et verticale.
C’est d’ailleurs tout le paradoxe de l’histoire même du réseau Internet, dont le développement fut initié et financé par les militaires américains, puis mené à terme par une multitude de chercheurs qui en furent les premiers utilisateurs. Dans son ouvrage Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand, un homme d’influence, Fred Turner est largement revenu sur cette histoire, en mettant l’accent sur les origines idéologiques et sociales de la révolution numérique. Il y décrit la gestation de cette révolution, entre les laboratoires de Stanford, la contre-culture hippie et les néo-entrepreneurs de la Silicon Valley. La biographie du personnage hors norme de Stewart Brand, témoin actif de cette révolution, ayant constamment joué un rôle de passeur entre ces différentes cultures, permet de mieux comprendre comment ce réseau de communication financé par l’administration militaire américaine a pu devenir le socle d’une transformation structurelle de nos systèmes de communication et de production. Car dès son origine, il est perçu comme porteur de valeurs. Bien avant son développement technique, Marshall McLuhan décrivait déjà le « village global » réticulaire censé émerger des nouveaux moyens de communication. De la même manière, Gilles Deleuze ou Félix Guattari ont formalisé dans Mille plateaux l’idéal du réseau, au même moment où étaient développés les premiers ordinateurs personnels et le réseau Internet. Ils proposaient alors, selon Alain Supiot, un nouvel “idéal normatif” : “celui des réseaux et de l’ajustement mutuel, des identités flottantes et des frontières évanescentes”.
Aux systèmes centrés, incarnés par les États territoriaux, ils opposent des systèmes acentrés, réseaux d’automates finis, où la communication se fait d’un voisin à un voisin quelconque, où les tiges ou canaux ne préexistent pas, où les individus sont tous interchangeables, se définissent seulement par un état à un tel moment, de telle façon que les opérations locales se coordonnent et que le résultat final global se synchronise indépendamment d’une instance centrale.
Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, 2015.
The Whole Earth Catalog, fondé par Stewart Brand, La Redoute pour les hippies
Ces travaux ont largement inspirés la contre-culture et les ingénieurs des universités américaines. Ces derniers étaient profondément convaincus de la capacité de leurs inventions à changer le monde – et cela de manière positive. Ils croyaient dans les valeurs de liberté, mais aussi d’égalité qui fondent les protocoles techniques qui régulent la transmission des informations qui circulent entre réseaux d’ordinateurs.
Richard Brautigan – All Watched Over by Machines of Loving Grace
Elles fondent par ailleurs les méthodes de travail que ces pionniers de la révolution numérique vont employer eux-mêmes : engagement par projet, horizontalité, ouverture et méritocratie sont les maîtres mots des communautés scientifiques distribuées qui oeuvrent à la stabilisation du protocole TCP/IP (le protocole central du réseau Internet aujourd’hui encore). L’instrument de discussion emblématique de ce mode de fonctionnement était le « request for comments », envoyé à des mailing-lists très larges pour améliorer collaborativement les suggestions individuelles ou collectives. David D. Clark, qui participa à ces groupes de travail, résuma leur fonctionnement ainsi : “We reject : kings, presidents and voting. We believe in : rough consensus and running code.” (Nous rejetons : les rois, les présidents et le vote. Nous croyons au consensus et au code qui tourne).
Dès le départ néanmoins, l’idéal du réseau ne devait pas s’arrêter au domaine technologique seulement. On peut parler d’un véritable effort d’évangélisation mis en oeuvre pour soutenir la réticularisation progressive du monde. Ce terme est d’ailleurs lui-même utilisé dans la Sillicon Valley, où chaque startup doit avoir son Chief Evangelist Officer. Stewart Brand, encore lui, incarne parfaitement ce rôle, puisqu’il fondera en 1987 le Global Business Network (GBN), afin de “contribuer à redéfinir le mode d’organisation des grandes entreprises en libérant à certains de leurs salariés des marges d’autonomie et en les invitant à travailler de façon horizontale en s’ouvrant à des savoirs multiples, hétérogènes et circulants”. Leur objectif affirmé est d’installer le “culte du réseau, de la transversalité et de la mentalité élargie dans le plan stratégique des entreprises”.
Ces idées se diffuseront largement au sein des théoriciens du management qui prônent dès la fin des années 1980 la sortie du modèle de production fordiste, toujours avec l’idée d’une révolution technologique inévitable à l’appui. Le “guru” américain du management, Tom Peter, expliquait ainsi, dans son livre Liberation Management: Necessary Disorganization for the Nanosecond Nineties (1992), l’importance de transformer les organisations hiérarchiques en petites équipes de projets ad hoc, flexibles et autonomes, dans le contexte de la “nouvelle économie” des années 1990, issue d’une accélération technologique entraînant la transition d’une vieille industrie manufacturière vers une économie de services.
Encore une fois, il ne s’agira pas de s’arrêter à la transformation de l’entreprise, ou même de l’économie. Stewart Brand participera ainsi à la création du magazine Wired, essentiel dans la diffusion de la culture du réseau. Le succès fut tel que pour le sociologue espagnol Manuel Castells, « le réseau constitue la nouvelle morphologie sociale de nos sociétés ». Qu’est-ce qui peut justifier une telle affirmation? Pour Castells, les technologies de l’information et de la communication ont profondément transformé l’organisation économique et sociale. Elles ont en effet distribué les capacités de produire, en commençant bien sûr par la production immatérielle. Pour Giorgio Griziotti, les progrès de l’informatique et surtout la diffusion des ordinateurs personnels, bien avant Internet, représentent l’émergence d’une première “intellectualité de masse”. Ces derniers sont en effet capables d’effectuer des programmes jusqu’alors extrêment difficiles d’accès et réservés aux entreprises.
On touche ici à un point crucial, puisque la critique du capitalisme s’est forgée autour de celle d’une distribution inégalitaire des moyens de la production. Or la révolution numérique distribue le capital fixe entre autant d’individus qui possèdent les outils de production, et qui peuvent ainsi devenir des producteurs relativement indépendants. Cet argument paraît d’autant plus pertinent qu’on annonce l’ère des personal fabricators, notamment avec l’arrivée des imprimantes 3D et le déploiement des “makerspaces”. Ainsi, chacun pourra imaginer un nouveau produit – et le produire – sans même devoir se préoccuper du processus de fabrication.
Les gains de productivité distillés par les économies d’échelle laissent place, grâce à la production numérique personnelles, à des leviers économiques d’une autre nature. Les coûts unitaires ne varient plus selon le volume de production et la personnalisation de chaque bien produit n’est pas davantage un obstacle rédhibitoire.
Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau, Michel Lallement, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social, 2018.
C’est ce qui permet de faire miroiter un nouvel idéal, celui du maker, de l’artisan-industriel et de la fin de la disjonction entre acte de production et de consommation.
Des makers nantais ont construit un respirateur Open-Source pour le CHU de Nantes en avril 2020.
Il s’agit d’un élément essentiel de la figure du réseau, puisque celui-ci désigne un ensemble de relations entre des éléments de même nature. C’est ce qui lui permet de se recomposer aisément, de manière itérative. Et c’est ce qui l’oppose à l’organigramme traditionnel hérité de la « fabrique » industrielle, fondé non seulement sur la hiérarchie mais sur la spécialisation : un élément peut difficilement y reprendre la place d’un autre. Cette opposition a inspiré une métaphore largement utilisée pour évoquer l’obsolescence des modes de production industriels : la Cathédrale et le Bazar, titre d’un essai d’Eric Raymond en 1999. La métaphore est mobilisée pour démontrer qu’il ne s’agit plus de contrôler la production dans une entreprise fermée et verticale, mais d’organiser le bazar de la production des multiples travailleurs autonomes, ce qui est rendu possible par l’interconnexion généralisée, c’est-à-dire “la disponibilité et l’échange des logiciels pilotant leurs outils et leurs créations” ( Pierre Veltz, La société hyper-industrielle, 2017).
C’est ici que la forme du réseau vient profondément bousculer le modèle industriel. Une grande question pour une entreprise est en effet de savoir quand est-ce qu’il faut internaliser une activité (salarier des personnes) ou l’externaliser (recourir à une autre entreprise pour effectuer la tâche). Cette question est un des objets d’étude de la théorie de la firme en économie, dont Ronald Coase a jeté les fondements. Ce qui détermine notamment ce choix sont d’un côté les coûts de transaction liés à l’externalisation d’un côté (estimation des prix, négociation et écriture des contrats…), et de l’autre les coûts d’organisation dans la firme (gestion du personnel, structuration interne…). Dans l’ère industrielle, l’internalisation par le salariat était plus rentable que le recours aux marchés et au commerce traditionnels. En effet pour produire des biens à l’ère industrielle, il était indispensable de regrouper la main d’œuvre dans les usines de manière uniformisée, d’optimiser l’utilisation des machines et d’encadrer le temps de travail, son organisation et son intensité, tout en offrant – graduellement – des garanties en matière de droits et de représentation sociale. Progressivement, les coûts de recours au marché ont été réduits par l’apparition d’institutions de régulation des échanges, telles que le renforcement des droits de propriété. La confiance dans les transactions a augmenté, rendant l’externalisation de la production moins coûteuse qu’auparavant. Il faut d’ailleurs rappeler ici que cette évolution n’a rien de “naturelle” : c’est par l’intervention de l’Etat, appelé à remplir une mission de tiers garant de la protection de la propriété privée et de la sécurité des transactions, que le marché se développe.
Le numérique vient parachever ce développement puisqu’il réduit massivement les coûts de communication et de transaction. Des innovations organisationnelles ont été développées pour remplir précisément cette fonction. Il s’agit des fameuses plateformes numériques, qui permettent d’organiser de manière ouverte le travail des producteurs, ainsi directement mis en relation avec leur clients. Si elles encadrent ces activités, les plateformes prétendent ne pas intervenir directement et rejettent le statut d’employeur. C’est l’aboutissement technique de l’idéal du réseau : à travers la plateforme, chaque unité de production, chaque travailleur, chaque consommateur est libre de se connecter ou de se déconnecter en fonction de ses besoins et de ses envies. Le travail se trouve ainsi débarrassé des règles qui encadraient ses modalités et sa durée dans la firme, mais aussi des contraintes liés à la spécialisation voire les besoins de qualification. Le travailleur en réseau sur Uber, Etsy ou JobDesk n’a plus de patron ; il est censément libre de choisir ses clients et son temps de travail, il peut naviguer d’une activité à une autre et constamment se “réinventer”. Le réseau permettrait ainsi de rêver à une sortie progressive du salariat et des rigidités de la firme au profit d’une interconnexion de travailleurs libres et autonomes, possédant les moyens de production et branchés sur un réseau fluide et en perpétuelle recomposition.



