… Grise, un peu fraîche, masquée et distanciée, la matinée de cette année a été consacrée à la pluie : intitulées « Cycle de l’eau et biodiversité en ville », les rencontres techniques ont porté sur la nouvelle façon de gérer les eaux qui tombent du ciel sur la ville. Ne plus les évacuer vite et bien vers des tuyaux invisibles, leur laisser plutôt le temps de s’infiltrer dans le sol, voilà une nouvelle manière de considérer l’eau comme un élément de l’aménagement du territoire.
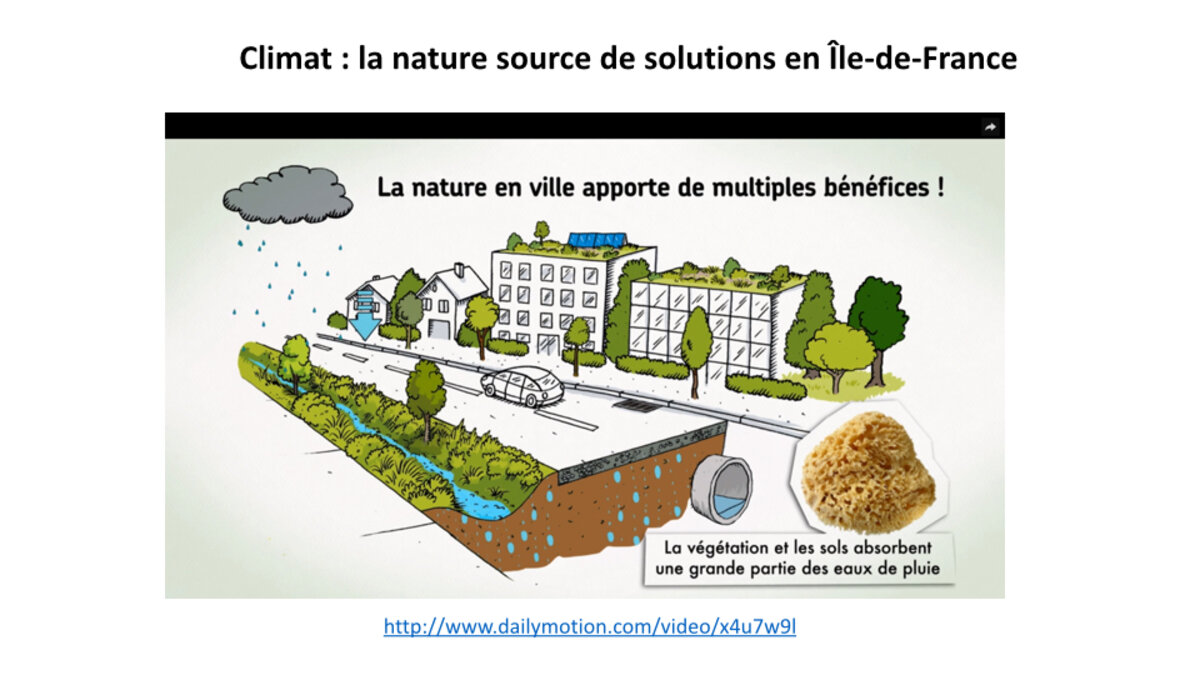
Agrandissement : Illustration 1

Sous le haut patronage de Bélaïde Bedreddine, adjoint au maire de Montreuil, vice-président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge de l’écologie urbaine et Président du conseil de direction du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (le Siaap), mais surtout infatigable défenseur de la nature pour tous, les débats ont démarré par la mise en perspective de Bernard Barraqué. Figure de l’eau en France et dans le monde, ce directeur de recherches émérite au CNRS et à AgroParisTech a rappelé ce que coûte l’eau en ville. Quelques évidences qui, comme souvent, sont rangées dans les tréfonds de notre conscience collective : « Tout notre système repose sur la facturation de l’eau qui a permis d’étendre le réseau de distribution, d’augmenter les volumes distribués et la qualité de l’eau. L’offre technique s’est améliorée, et ce, à coût modéré, car l’inflation a réduit le prix réel. » Nous avons la chance de vivre dans un pays où il suffit de tourner le robinet… et de tirer la chasse pour disposer d’une eau potable à laquelle peu de Terriens ont accès. Sans aucun effort, si ce n’est de réduire notre consommation, afin de diminuer le gaspillage aujourd’hui mal vu, qui finit par se voir sur nos factures : « or, la baisse de la consommation réduit les revenus des services publics de l’eau, tandis que la multiplication des normes accroît les coûts. » On nous demande de faire des efforts sur notre consommation de l’eau, mais cela fait entrer moins de sous dans la caisse qui paie le service de l’eau, c’est un beau cercle vicieux.
Une eau de plus en plus chère
D’autant plus gênant que les prix de traitement augmentent de façon inquiétante, ce dont témoignent volontiers les maires des petites communes. Responsables de la qualité de l’eau distribuée à leurs administrés, les élus ruraux n’ont pas toujours les budgets pour répondre aux coûts croissants imposés par la réglementation, d’autant moins que les dotations de l’État aux communes sont chaque année plus réduites. Les agences de l’eau compensent, mais jusqu’à quand ? Les factures vont devoir augmenter, alors que la situation financière des gens n’est pas fameuse. En outre, en ce qui concerne les réseaux, « les solutions techniques deviennent trop chères, et il n’y a pas d’aides pour rénover des infrastructures vieillissantes, » ajoute B. Barraqué. Y aura-t-il bientôt une eau des villes propre et abondante, et une eau des champs à la quantité et la qualité aléatoires ? C’est la crainte des maires ruraux, partagée par beaucoup de spécialistes. Dont Bernard Barraqué qui pose la question de l’accès futur à l’eau des plus démunis. Neuf millions d'entre nous, 1 million de plus depuis le début de la crise virale, ont déjà du mal à manger correctement, devront-ils aussi un jour se serrer la ceinture pour boire et se laver ?
La réalité est celle-là, parce qu’on vit sur une courbe ascendante qui nous a fait accroire qu’elle allait être éternelle. Le vieillissement des infrastructures, le grossissement de la population, la multiplication des usages sont en train de pousser notre système de distribution à ses limites techniques. Une évolution somme toute naturelle, qu’accélère le changement climatique, insiste Bernard Barraqué : plus d’eau en hiver, moins en été, plus d’événements extrêmes, les pluies sont moins prévisibles qu’avant, plus brutales, et la demande est toujours plus forte quand il y en a de moins en moins en été. En montagne, il neige moins, ce qui a des conséquences sur le débit des rivières ; et sur les littoraux, la hausse du niveau de la mer provoque des mélanges avec les nappes phréatiques. « En 2007, un rapport de l’ONU a chiffré les coûts mondiaux d’adaptation pour l’approvisionnement en eau des zones urbaine : 11 milliards de dollars par an jusqu’en 2030 ! En plus du coût de la mise à niveau des réseaux existants dans les pays du sud, estimés entre 32 et 40 milliards, par an. » Est-il possible de trouver des solutions moins onéreuses ?
Dans le monde, le gros tuyau n’a plus la côte
Comme d’autres spécialistes, en 2015 Bernard Barraqué a participé à un groupe d’études constitué par la Banque Mondiale, chargé d’évaluer l’impact des événements extrêmes sur l’approvisionnement en eau des grandes villes. Copenhague par exemple. En juillet 2011, un orage exceptionnel a causé 700 millions de dollars de dommages dans la capitale du Danemark. « Le réseau d’égouts avait démontré qu’il ne pouvait plus absorber ce genre d’aléas. La ville a calculé qu’une crue centennale ferait demain passer la zone inondable de 595 à 742 ha. Elle a donc mis en place cinq scénarios d’action possibles. » Élargissement des égouts, reprofilage des rues, terrains de jeux rendus inondables, batardeaux aux portes d’entrée des maisons etc., tout a été étudié par la municipalité danoise. « Eh bien, l’agrandissement du réseau d’assainissement a obtenu un rapport coût-avantage bien moins avantageux que les solutions plus simples… » résume M. Barraqué. Le traditionnel génie civil, le tout-tuyaux, coûte plus cher que ce qu’il fait économiser en dommages, selon l’étude. En gros, une gestion de l’eau en surface revient sur la durée moins cher, moyennant une hausse des taxes locales et des factures d’eau.
New York a fait également l’objet d’un rapport. Après l’ouragan Sandy de 2012, la municipalité avait calculé qu’à ne rien faire, l’avenir dessiné par la mer qui monte et les vents qui forcissent promettait des dommages annuels de 1,7 à 4,8 milliards de dollars. « Le plan d’adaptation local a estimé les investissements à faire autour de 15 milliards de dollars sur 10 ans. 80 % visent à améliorer les infrastructures, le reste, c’est notamment la reforestation des monts Catskills, en amont de la ville, afin de réduire l’érosion des sols, et donc la turbidité de l’eau qui arrive à New York » laquelle a un impact sur l’écoulement général et la capacité des unités de potabilisation.
À Barcelone, l’étude a conforté le choix de la ville d’investir dans le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées. Là-bas, ce n’est pas les inondations qui menacent, mais la sécheresse. « Toutes les solutions envisagées se sont révélées avantageuses, parce que les dommages résultant des déficits en eau dépassent largement les coûts d’évitement, » sauf ceux du fantasmagorique tuyau reliant le Rhône à Barcelone, au coût faramineux. « En termes de coût-efficacité, les mesures sur la demande obtiennent les meilleurs scores, et la réutilisation des eaux usées est meilleure que le dessalement. »
Réinviter la pluie dans le paysage
Et en Seine-Saint-Denis ? Bernard Barraqué a regardé la carte et les territoires. Un réseau de 700 km de long, qui dessert 37 000 branchements. 33 bassins de retenue, 99 chambres de dépollution, 139 stations de pompages. Lors des orages d’été, le débit de l’eau de pluie sur un département aussi urbanisé dépasse les 150 m3 par seconde, soit deux fois celui de la Seine… Ça ruisselle en Seine-Saint-Denis. « Il y a longtemps qu’on sait, ici, qu’il faut retenir l’eau de pluie avant et dans le réseau », et pas l’évacuer le plus vite possible vers des tuyaux que l’on n’a plus ni les moyens ni le temps de changer régulièrement. « Il s’agit de réinviter la pluie dans le paysage, » défend joliment Bernard Barraqué : « les permis de construire ne doivent plus dépasser le plafond de ruissellement actuel de la parcelle, et tout doit être fait pour que l’eau de pluie s’infiltre par le sol, dans le paysage… »
Ouvrir la chaussée
S’infiltrant, elle abreuve des organismes vivants. Écologue à l’Agence régionale de la biodiversité (ARB), chargé de mission économie et biodiversité, Marc Barra fait le lien entre l’eau de pluie et la biodiversité. L’une pour l’autre, l’autre par elle. « La priorité, c’est maintenir ou recréer de la pleine terre et des espaces de nature en ville dont on manque cruellement. C’est substituer des infrastructures grises, les tuyaux, par des vertes, à l’image de ce que fait le département du 93 dans certains parcs. » Nombreux sont les exemples de gestion de l’eau par la nature, ou ce qui y ressemble. À Rouen par exemple, 10 ha ont été protégés dans le PLU sur un site destiné préalablement à l’urbanisation. Idem à Épinay-sur-Seine sur 1,5 ha : « ces surfaces se trouvent en fait dans des zones d’expansion de crue, en milieu urbain, comme les Prairies Saint-Martin, dans une boucle de la Vilaine, à Rennes. » Plutôt que d’y construire, la ville normande a laissé jardins, champs et bois. Ainsi l’eau peut-elle monter à loisir, elle s’étale, se voit, puis disparaît, abreuvant quelque biodiversité. À Sarcelles, on a fait mieux encore, car on a… supprimé une route. Le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique Croult et Petit-Rosne a retiré une portion de voirie pour remettre à jour la rivière, dans le but de recréer des milieux naturels fonctionnels, notamment une zone d’expansion de crues.
« Tout cela va avec l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN). Il serait une avancée considérable mais en l’état, il ne se préoccupe pas beaucoup de la nature en ville ni des sols urbains ! Mais ça avance, le ministère est en train de revoir sa définition de l’artificialisation pour laisser la place aux espaces verts urbains. » Car ouvrir une route, une cour d’école, un parking afin de laisser la terre, dûment couverte de végétations, en capacité de s’imbiber d’eau de pluie ne rentre pas dans la comptabilité des espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) qui est assez basique : un parc urbain, un potager, une cour d’école transformée en prairie est considérée comme un espace artificialisé, au même titre qu’un parking. « Il faut que ça change, car le gisement est énorme. » Il y a les équipements sportifs, innombrables, dont les abords pourraient être utilisés. Il y a aussi les parkings. En théorie, cela fait 818 ha rien que sur Paris. Transformer une partie de ces patinoires à eau de pluie est une manière de créer de nouveaux espaces de nature en ville. Mieux capter la pluie par la vie, mieux faire vivre par la pluie. Poussant en pleine terre, dans un sol qui n’est pas recouvert de macadam, un arbre pousse plus profond, plus haut, plus vaste, il pompera plus d’eau, certes, mais captera plus de carbone et retiendra plus de polluants atmosphériques. Et puis il fera de l'ombre, et, se vaporisant sous l'effet de la chaleur, l’eau qui s’en évaporera par le banal mécanisme de la transpiration, rafraîchira l'air ambiant. Dans les villes bien vertes, l’effet îlot de chaleur urbain (ICU) est moins prononcé.
« Attention cependant, ce n’est pas parce qu’on laisse du sol à nu pour capter l’eau de pluie que l’on a obligatoirement de la nature ! », nous prévient Marc Barra, photos à l’appui. Il y a des noues végétalisées qui ne sont que des caniveaux mal chevelus, des bandes de terres tondues ou plantées de variétés exotiques. « Quand c’est bien fait, c’est tout bénéfice pour la nature, et la collectivité : un gros tuyau, c’est un coût de 583 euros par mètre cube, une noue mal faite, 231 et une, bien faite, c’est à peine 75 euros… » Le retour de l’eau en ville doit se faire au bras d’une belle nature, pas en simple trait bleu d’un tableau dessiné par un paysagiste.
La vie revient plus vite que les écosystèmes
Avec ces solutions fondées sur la nature, comme on dit à l’Onu, les moustiques sont à la fête. En période Covid, l’eau qui stagne peut générer des questionnements. Directeur de l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), Samuel Jolivet nous rassure : « ils sont un des maillons les plus importants des chaînes alimentaires, ils nourrissent poissons, chauve-souris, grenouilles, et plein d’invertébrés aquatiques. Dans un milieu fonctionnel avec des chaînes alimentaires complètes, ils sont régulés. » Encore faut-il qu’il, le soit, fonctionnel, et pas un simple paysage qui fait joli. Quant au moustique tigre, qui fait peur en ces temps pandémiques, ils n’affectionnent que les eaux sans support biologique, sans matières organiques, c’est-à-dire le peu qui se trouve au fond d’un pneu ou d’une coupelle abandonnée.
Samuel Jolivet nous l’assure, la biodiversité peut revenir vite dès lors qu’on la laisse tranquille. Un trou, au fond une bâche, de l’eau, du temps, et la résilience de la nature suffit à ramener des espèces en ville. « Déjà, les bassins de rétention d’eau de pluie, ce sont des milieux de substitution pour que la nature arrive à retrouver une toute petite place en ville. » Au moins, pour les libellules, qui sont les animaux qui manquent, de nos jours. Jadis, eux et leurs cousins les éphémères apparaissaient en vastes nuées, en « mannes » qui au bord des rivières, rendaient glissantes les chaussées. Ce n’est plus le cas en nos temps où les pare-brise ne se salissent plus tant des insectes écrasés. « La biodiversité qu’on trouve sur des étendues d’eau urbaine reste accidentelle. Il ne faut pas oublier que la perte d’habitats est réelle, la perte de fonctionnalité l’est tout autant, les milieux naturels sont exsangues. »
On part de loin. La ville peut paradoxalement améliorer les choses. « Il faut rappeler à quel point l’homme s’est développé avec l’eau autour de lui, dans ses villes, il y a eu un changement de paradigme avec les temps industriels, puis avec l’urbanisation massive des années 1960 et 1970, et l’on a complètement oublié ce qui se passe dans une mare. » L’eau a été chassée des villes parce qu’on a appris à la maîtriser dans les réseaux, et puis l’expansion urbaine et agricole ont eu raison de 80 % des zones humides. « Avec les zones d’eau pluviale en ville, la faune revient, mais ce n’est pas forcément la faune emblématique. On peut avoir l’impression qu’il y a de la diversité, alors que c’est la biomasse qui a augmenté. » Ce n’est pas parce qu’il y a à nouveau des insectes que leur milieu de vie est fonctionnel. Mais c’est déjà cela. L’eau a finalement autant besoin de la ville que celle-ci a besoin d’elle.
Révolution à l’agence de l’eau
Les agences de l’eau participent au financement de ces nouvelles infrastructures. Une révolution pour celles qui durant près de cinquante ans ont financé des réservoirs enterrés et des gros tuyaux. Mais comme le dit Frédéric Muller, chef du service investissements territorial Seine Marne et Oise à la Direction Territoriale Seine Francilienne de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), les faits sont têtus : « les modèles nous disent que l’évapotranspiration augmente alors que les précipitations baissent. La ressource sera donc de moins en moins disponible pour les différents usages. Et puis il faut savoir qu’ici, sur le territoire couvert par le Siaap, lorsqu’il pleut, c’est une zone dite active de 250 km2 qui envoie vers les usines des centaines de milliers de cubes d’eau. Ce qui coûte en réactifs, en traitements. » Réduire à la source la pluie qui arrive dans les usines ne peut que faire du bien aux factures payées par chacun de nous.
La laisser s’infiltrer au pied des arbres a un autre avantage : « une étude récente de Santé publique France montre que les risques pour la santé liés à la canicule sont jusqu’à 18 % moins élevés pour les communes les plus arborées. » Sous l’impulsion du Préfet de région Île-de-France, qui se trouve être également préfet coordinateur de bassin et président du comité de bassin de l’AESN, une stratégie d’adaptation a été élaborée. Adoptée à l’unanimité en 2016, elle est conforme à celles des grandes villes qui ont été étudiées par Bernard Barraqué : élaborer des stratégies « sans regret », c’est-à-dire, en jargon technique, peu coûteuses et utilisant peu de ressources (peu de béton, de tuyaux etc.) ; multifonctionnelles (alors qu’un réservoir enterré ne sert qu’à stocker, une zone d’expansion naturelle de crue permet à la fois de lutter contre l’effet ICU et d’améliorer la biodiversité en ville) ; atténuantes au regard du changement climatique - on évite par exemple d’utiliser des pompes, au profit d’un écoulement par gravité ; et enfin, si possible, des stratégies solidaires entre les différents usages et territoires (les décisions prises ici doivent avoir un impact positif en amont et en aval).
« Voilà pourquoi nous finançons des mosaïques végétales en dalle d’immeubles, des bandes végétalisées au milieu de parkings, des toitures végétalisées, des travaux de renaturation des berges de la Marne et de l’Yvette etc. » Le taux d’aide monte jusqu’à 80 %, selon « l’effort de déconnexion du réseau d’eau pluviale » que les solutions fondées sur la nature promettent de réaliser. Moins de ruissellements, plus d’argent. Dans la limite des pluies classiques, celles qui tombent les trois quarts du temps : personne ne dit que les noues végétalisées et autres parcs urbains inondables éviteront les inondations lors d’une tempête. Les gros tuyaux resteront indispensables pour faire face aux pluies diluviennes.
Le Siaap ne veut plus de pluies sur son réseau
La société a fait le choix de moins en mettre dans ses tuyaux, de laisser l’eau s’infiltrer à l’air libre. Avant, elle la considérait comme un déchet, elle la faisait disparaître, on la mélangeait ici et là aux eaux usées, et on envoyait le tout à la station d’épuration. Aujourd’hui, on voit que les eaux pluviales peuvent rendre des services. Grâce par exemple à des solutions mises en place par le Siaap. Le service public de l’assainissement francilien, c’est 6 usines de traitement, et presque un million de mètres cubes de stockage, qui couvrent les besoins de Paris et de sa petite couronne. « L’histoire remonte au début du siècle précédent », raconte Bilel Afrit, chargé de mission Politique de l’eau, Service partenariat et politique de l’eau, à la direction de la stratégie territoriale. « Les champs d’épandage remontent au début des années 1900, c’est en 1940 qu’on a construit la première centrale d’épuration, à Achères, mais c’est surtout durant les années 1970 et 1990 que les équipements ont été créés, » le dernier étant Grésillons. Aujourd’hui, la capacité de traitement est supérieure au volume d’eaux usées produites, qui est à peu près stable depuis 1990. Un exploit, d’autant que « le débit d’étiage de la Seine est tout petit, avec 95 m3/s, bien plus petit que ceux du Rhin et du Rhône, alors que la population est très importante : chaque habitant peut bénéficier par jour d’1,2 m3, contre 18 pour un riverain de Lyon et… 65 pour un de Strasbourg ! » Moins de débit, plus de concentration de pollutions, pourtant, une eau de bonne qualité grâce à des équipements qui ont encore le temps de voir venir.
Malgré tout, estime Bilel Afrit, le Siaap doit se tenir prêt à affronter une baisse prévisible de 30 % du débit de la Seine, à cause du changement climatique. Cela ne l’inquiète pas, car l’objectif du quatrième contrat de bassin du Siaap, signé en 2019 et opportunément intitulé « eau et climat » n’est rien moins qu’en 2024, année des Jeux olympiques, l’on puisse se baigner dans la Marne et la Seine. Une vieille promesse, jamais tenue, qui engage cette fois-ci la collectivité car des épreuves des jeux doivent se tenir dans les deux cours d’eau. Est-ce réalisable ? « Pour respecter nos objectifs de qualité environnementale, il ne nous faudrait aucune artificialisation supplémentaire, donc atteindre l’objectif ZAN, sinon, on ne tiendra pas. Pour l’objectif baignade, par contre, c’est plus que cela, c’est 5 % de notre territoire qui devrait être… désimpermébailisé. » Déjà, les aménagements du Grand Paris doivent se débrouiller tout seuls : « ils sont obligés de gérer leurs propres eaux pluviales, ce qui fait qu’ils n’auront pas d’impacts sur notre zone de collecte. En fait, tout ceci correspond au quatrième objectif de notre contrat : inverser la tendance à l’augmentation des surfaces imperméabilisées raccordées à notre réseau. » En clair, le Siaap ne veut plus accepter de nouvelles eaux pluviales. Pour bien le faire comprendre et faciliter les choses, il proposera début 2021 un outil numérique dénommé « parapluie » simple d’accès, gratuit, qui permettra à un aménageur de dimensionner correctement son mode de gestion à la source des eaux pluviales.
Le département médiateur
Autre acteur de l’eau, bien que ce ne soit pas de ses compétences, le département de la Seine-Saint-Denis ne reste pas les bras croisés. Vu du ciel, il est presque entièrement artificialisé, tant la densité urbaine y est élevée. Directrice territoriale, chef du bien nommé bureau de l’Eau dans la ville et responsable également du bureau d'appui aux politiques d'écologie urbaine au département de Seine-Saint-Denis, Danielle Amate rappelle qu’en un siècle, sa collectivité s’est urbanisée comme aucune autre, perdant ses « zones marécageuses » où affleuraient les nappes. Ceci expliquant plus ou moins cela, « nous avons connu des crues majeures, historiques, en 1953, 1955, 1980, 1992 et 2013, et encore, pour des pluies pas exceptionnelles, voilà pourquoi la lutte contre les inondations a toujours été une question centrale. Nous avons creusé des bassins de rétention, mais dès 1992 nous avons mis en œuvre une politique de maîtrise des apports aux réseaux, de façon à ne pas les saturer. » Il y a presque trente ans, déjà. Le département s’était rendu compte que la construction de ces bassins ne pourrait jamais compenser la croissance démographique. D’autant qu'ils n’étaient pas en bon état : dimensionnés de manière à emmagasiner l’équivalent de 10 litres par seconde et par hectare, soit 350 m3 de stockage par hectare, les bassins de rétention dits… de « nouvelle vague », dont un, gigantesque, sous le Stade de France, ont avoué lors d’une enquête conduite en 1997 que leur entretien était inadapté ou inexistant pour les deux tiers d’entre eux. « Depuis lors, on évite la construction de gros bassins en aval, et on privilégie les ouvrages visibles et rustiques, ainsi que la déconnexion. » La ville perméable, c’est l’idée du département.
Pour la réaliser, il faut d’abord la rendre évidente. Le département a créé pour cela en 1990 une cellule de liaison « eau » entre ses différents services, histoire d’atteindre une relative cohérence. Ensuite, en 2014 « un zonage pluvial a été annexé au règlement d’assainissement, ce qui permet au département de donner son avis sur les Schémas déménagement et de gestion de l’eau (Sage), le Schéma régional de continuité écologique (SRCE), le schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) et bien évidemment les plans locaux d’urbanisme (PLU). » Nul aménageur et élu ne peut plus depuis être sans connaître la doctrine départementale. Le CD93 délivre aussi son avis « pluvial » sur les permis de construire, avec une certaine réussite car le nombre d’entre eux qui contient une maîtrise du ruissellement ne cesse de croître : ils étaient un tiers environ en 2017.
Madame Amate reconnaît qu’il reste de gros progrès à réaliser, notamment pour « inciter les aménageurs à intégrer l’eau pluviale dès le stade de la conception, pour travailler sur l’existant, ce qui est plus difficile que de prendre en compte les eaux pluviales dans le neuf, et il y a encore des efforts à faire pour que les collectivités se coordonnent entre elles. »
De l’entrisme assumé, pas de bâton, toutefois. Ni même de carotte : le département ne subventionne pas, il accompagne. « On ne peut faire que cela, car on n’a pas la compétence assainissement ! Nous sommes à la bonne échelle pour être un médiateur de l’eau. » À Aubervilliers, rue de la Commune de Paris, il a ainsi fortement aidé à la transformation du parking d’une résidence d'accueil de jeunes travailleurs de 230 logements en une « tierce-forêt. » Des arbres avec du sol autour, à la place de voitures, ce sont de jolies bannières pour le département.
La Bièvre, une utopie qui prend vie
Le département limitrophe du Val-de-Marne a été plus loin. Grâce à lui une rivière va retrouver le soleil. Longue de 36 km, traversant 5 départements et 16 communes, elle prend sa source à Guyancourt et se jette dans la Seine au point d’Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris, voici la Bièvre. « Ce n’est pas un torrent alpin, elle a un très faible dépit, elle s’écoule selon une très faible pente, et avec le temps elle a été transformée en égout, » raconte Benoît Kayzer, chef de projet à la Direction des espaces verts et du paysage du Département du Val-de-Marne. Les tanneries, les lavoirs, les boucheries en avaient fait une bauge. « Au XIXe siècle, il fallait assainir et éloigner la maladie de la ville. Alors, au début du XXe siècle, la rivière a été refermée, et en 1950 dans le Val-de-Marne, il a fallu en quelque sorte l’enfermer dans un tuyau. » La rivière perdit son statut administratif de cours d’eau, car elle n’était plus qu’un réseau d’assainissement à partir de Massy. Un arrêté préfectoral en 2007 lui a fait retrouver sa dignité de rivière. « Elle est quand même très canalisée, à Antony, elle se retrouve même dans un bassin d’orage, et après elle est invisible, recouverte, inconnue. »
Voilà qui nourrit la frustration des habitants les plus anciens ou nostalgiques, et éveille la curiosité d’autres. Pourquoi ne pas la revoir, la Bièvre ? À Arcueil, entre Gentilly et le cimetière, longeant le Parc du Coteau de Bièvre et le centre sportif Raspail, un tronçon enterré de 600 m a été repéré comme susceptible d’être rouvert. L’idée a fait son chemin, et dès 2010, des réunions avec les habitants ont été organisées. « Ils disaient qu’ils voulaient de la fraîcheur ! »
Soutenue par les élus locaux, l’idée est devenue projet. « Cela va coûter 10 millions d’euros, pris en charge à 20 % par le conseil départemental du Val-de-Marne, le reste par le Grand Paris, l’agence de l’eau Seine-Normandie et la Région. » Deux fois moins cher au kilomètre qu'un tronçon de tramway. La livraison est envisagée pour fin 2021. Les engins ont commencé les travaux, malgré le covid. Ils ne sont pas aisés, car « il faut rétablir un lien avec la nappe, les berges, le cours d’eau libre lui-même. Pour ce faire, on aurait dû passer par le gymnase et le terrain de foot, mais faute de foncier disponible, il était impossible de les déplacer, alors il nous a fallu passer à côté, ce qui a impliqué de soutenir les sols, de faire du soutènement sous le terrain de football et le gymnase, avec des pieux de 15 m ! »
Éliminer une infrastructure écologique telle qu’une rivière, cela prend quelques heures de pelleteuses, la restituer, cela demande beaucoup plus, et des dépenses gigantesques. Bonne fille, la Bièvre remise à nu ne remplacera pas le réseau d’assainissement existant : son débit sera contrôlé de façon à ce qu’il ne perturbe pas le système. En cas de pluies majeures, la rivière grossira, mais peu, l’essentiel du surplus continuera d’être destiné vers le réservoir de 25 000 m3 situé sous le terrain de foot. On a bien fait de ne pas le déplacer celui-là. « Dans quelques mois, on aura une rivière à la place d’une dalle en béton : pour moi, c’est une utopie qui prend vie. »
Irriguer à nouveau la culture collective
Un peu plus au nord et à l’est, voici le syndicat Marne Vive. À cheval entre le Val-de-Marne, la pointe sud de la Seine-Saint-Denis et un peu de Seine-et-Marne au-delà de Torcy, il a établi un Sage qui s’est donné comme objectifs la baignade et une approche paysagère de l’eau. « Au préalable on avait lancé en 2015 un référentiel des paysages de l’eau, » explique Christophe Debarre, chargé de mission « eaux pluviales. » En janvier 2019, une étape importante a été atteinte par l’approbation d’un Plan de paysage. Aucune valeur juridique, c’est un référentiel « avec des objectifs de qualité paysagère pour chaque secteur du bassin. » Sur la Marne urbaine par exemple, qui va de Neuilly-sur-Marne à Maisons-Alfort, l’OQP4 vise à créer ou préserver les lieux de nature conviviaux « et ressourçants », qui favorisent l’accueil et le ralentissement de l’eau. L’OQP5 des plateaux et vallons, qui dominent la Marne au nord et à l’ouest du territoire syndical, investit en ce qui le concerne la mémoire et notre imaginaire : « Cela veut dire marquer plus fortement les vallons et vallées en restaurant les cheminements, identifier les possibilités de franchissement des rus, expliquer le conditionnement des ouvrages d’art, ou encore créer des itinéraires de promenade historiques liés à l’eau. » Ces objectifs nécessitent beaucoup d’animation territoriale, et des opérations pilotes comme celles conduites à Chelles, Montreuil, ou encore Boissy-Saint-Léger.
Dans cette dernière ville, il y a le quartier de la Haie Griselle, « dont le centre commercial va être détruit. Or, c’est par sa toiture que l’eau de pluie alimentait un étang, auquel les gens sont très attachés. L’étang, c’est l’identité du quartier. Du coup, la circulation de l’eau prévue vers les caniveaux va être redirigée vers l’espace vert, là où il y a l’étang. » À Chelles, c’est la rivière des Dames qui devrait, comme la Bièvre, retrouver l’air libre.
Le syndicat est passé à l’action, mais il a l’impression d’être déjà en retard. « On milite tous pour une gestion à la source des ressources en eau, la pleine terre, l’atténuation des îlots de chaleur, les reméandrages des rivières canalisées et le retour de la baignade en Marne. On améliore, mais on court derrière la réglementation. » L’objectif de retour de la baignade en 2022 implique par exemple de mettre en conformité les réseaux, or, il en reste 10 % qui ne sont pas en séparatifs, et il faudra réduire l’imperméabilisation. La route est longue.
Se baigner, un jour
Paris promet d'y arriver avant tout le monde. Nessrine Acherar n’y mettrait pas sa main à couper, mais la capitale devrait selon elle être « baignade" en 2024. Cheffe du Pôle Pilotage et Expertise, adjointe au Chef du Service de l’Équipement à la direction de la Jeunesse et des Sports de la ville, Me Acherar prend exemple sur l’opération bassin de la Villette. « Le code de la santé publique et la directive-cadre européenne définissent la baignade naturelle comme une baignade dans une eau qui n’est pas désinfectée ni renouvelée, et circule librement. » Les contrôles sont permanents : autosurveillance par une station d’alerte qui délivre des résultats bactériologiques chaque matin permettant de décider, ou non, de l’ouverture à 11 heures, plus des contrôles par un laboratoire indépendant une fois par semaine. « On publie aussi un profil de baignade, qui est un document réglementaire : il identifie les sources de pollution, et ce qu’on peut faire pour les réduire. » Installer des sanitaires sur le port pour les plaisanciers de la halle nautique située en face du bassin, par exemple. « Depuis 2017, c’est un équipement qui a du succès : on est entre 70 000 et 100 000 personnes sur deux mois d’exploitation, chaque année, utilisé par les riverains et les touristes. » Ça marche, mais c’est fragile, car très dépendant de ce qui vient de l’extérieur, et de ce que les baigneurs amènent. La baignade dans les eaux d’Île-de-France sera peut-être possible bientôt, mais d’abord, dans des environnements circonscrits comme le sont les bassins de la Villette ?
Récupérer les engrais dans nos eaux noires
Avant, les eaux de pluie étaient considérées tels des déchets, aujourd’hui, elles le sont comme une ressource multiple. Poussons la logique jusqu’à appliquer le même traitement à nos eaux usées. Et si ce qui part de la douche, du lavabo, de l’évier et des toilettes nous revenait dans la douche, le lavabo, l’évier et les toilettes ? Derrière le fantasme de la vie en autarcie se trouve la recherche d’une utilisation plus rationnelle de la ressource en eau potable. Compte tenu des contraintes évoquées durant cette matinée, est-il raisonnable de tirer la chasse d’eau potable, de se laver à l’eau potable, d’arroser le jardin à l’eau potable ? Chargée de recherche et animation
du programme OCAPI, à l’école des Ponts Paris tech, Marine Legrand a la réponse : « Non seulement on doit économiser la ressource, en plus, recycler nos eaux usées permet de récupérer de l’azote et du phosphore dont les champs ont besoin. » La nouvelle gestion de l’eau remet en cause le triptyque chasse d’eau, tout à l’égout, station d’épuration, et permet d’envisager la remise en circulation de l’azote, du phosphore et du potassium, le fameux trio fertilisant des plantes de culture.
Voilà qui a inspiré le nom du programme de recherches auquel Marine Legrand participe. Ocapi, pour Optimisation des cycles carbone, azote, phosphore en ville. Démarré en 2014, le programme est entré dans sa seconde phase en 2018. « Nous essayons de voir s’il est possible, et acceptable, de séparer à la source les flux qui constituent les eaux usées. De revaloriser ces déchets que sont les matières fécales humaines. » Les eaux grises (douche, évier, lave-linge…), et noires (les toilettes).
Madame Legrand nous rappelle que cela se faisait… avant. « Les toilettes sont apparues au cours du XIXe siècle, toutefois, les eaux noires étaient répandues dans les champs. À Paris, on transformait ces matières sur la chaussée de Bondy, en séparant solide et liquide, puis en les faisant sécher. Cela a été abandonné quand on a autorisé petit à petit le raccordement des toilettes au réseau d’eau, pour des raisons sanitaires. ». L’usine de potabilisation d’Achères a été le coup de grâce. Et l’industrie a suppléé au manque de cette manne en matières organiques en synthétisant des engrais. « C’est quand même stupide ! Les stations dépuration détruisent ce qu’il y a de bon dans les urines et les fèces, ce qui coûte de l’énergie, et ce qu’il y a de bon, l’industrie en fabrique dans ses usines en consommant de l’énergie ! » Du gaspillage créateur de valeur, diront les économistes.
« Aujourd’hui, il faut séparer les flux en distinguant les usages de façon à restaurer les cycles de l’eau. » Ce qui veut dire gérer les eaux pluviales à la source en développant l’infiltration, les collecter à domicile pour le jardin, la douche et l’évier, réutiliser à la fois la chaleur et l’eau des eaux ménagères issues de la machine à laver et du lave-vaisselle pour les toilettes… le lave-linge et le lave-vaisselle, et séparer à la source nos urines et nos fèces pour les besoins de l’agriculture. Filtrées, séchées, les urines peuvent servir d’engrais tandis que nos fèces, bien traitées pour éviter la contamination microbienne, peuvent donner un excellent compost.
Une autre révolution est-elle en cours ?
Ce dernier usage semble étrange à nous autres occidentaux qui avons tout fait pour éliminer de notre vue ce qui paraît si sale. « Il y a un indéniable facteur beurk », non pas tant pour le fait de retirer nos matières fécales de l’eau que de les utiliser ensuite pour faire pousser des légumes. Dans l’assistance lycéenne de ces rencontres techniques, l’effet beurk semble cependant peu développé. Anthropologue de l’environnement, Marine Legrand travaille justement à « concilier la valorisation des ressources et l’état des mœurs. En fait, l’effet beurk a évolué. Avant c’était l’idée même de séparer le caca et le pipi qui dérangeait, aujourd’hui c’est plutôt celle de faire caca dans l’eau potable qui est considéré comme dégoûtant. » Après celle du regard porté sur l’eau pluviale, une seconde révolution serait-elle encore ?
Des expériences nombreuses, un peu partout dans le monde et en France ont montré qu’un temps d’adaptation était nécessaire. Selon Marine Legrand elles démontrent qu’un mouvement de fond est en train de se structurer, notamment en France grâce aux militants et praticiens de l’écoconstruction et du compostage. « À Paris, il y a le projet Petit pipi aux Grands voisins [ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul], qui teste des urinoirs secs masculins, et féminins. Dans les deux cas il faut s’asseoir et changer sa façon de faire pipi. » À Grenoble, un immeuble en habitat participatif est déjà équipé de toilettes sèches séparatives, qui produisent un compost géré en commun. À l’école des Ponts, où travaille Me Legrand, les résidus des toilettes sont utilisés sur le jardin partagé de l’école. « Il y a aussi le projet d’écoquartier Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, qui sert de démonstrateur. » Située lui aussi sur le site de l’ancien hôpital du même nom, l’opération devrait démontrer qu’en séparant ainsi les eaux, on renoue avec des pratiques anciennes, avec nos connaissances en microbiologie d’aujourd’hui. L’agence de l’eau accorde des subventions, reste à maîtriser les prix. Séparer pour récupérer dans le neuf, c’est faisable, pour quelques euros de plus par mètre carré (Marine Legrand estime le surcoût à deux euros), en rénovation, c’est autrement plus compliqué : il est difficilement envisageable de créer des réseaux séparés dans les immeubles anciens étriqués de Paris et de la Seine-Saint-Denis.
Le sujet interroge Bélaïde Bedreddine, qui, écoutant Marine Legrand, a calculé que si 10 % de la population francilienne pratiquaient la séparation dans les eaux noires, cela ferait une station d’épuration en moins, soit, 300 à 400 millions d’euros économisés. Le vice-président de la région a rappelé qu’à Los Angeles, on réinjecte dans la nappe une partie des eaux usées, tellement la métropole a sollicité son fleuve, qui n’en circule plus jusqu’à la mer. En conclusion, le vice-président de la région a souhaité évoquer le rôle de l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, sans lequel la Seine aurait été traversable à pied à Paris lors des épisodes caniculaires de l’été 2019. Les relâchers des quatre barrages sur la Marne et la Seine ont évité le pire. « Tout cela c’est bien, mais voilà, t ce que nous faisons c’est en définitive pour éviter de polluer l’océan, non ? Or, on peut avoir 5, 6, 7 traitements en Île-de-France, on peut récupérer les eaux usées, soutenir les débits, si on laisse les pays riverains de l’Atlantique sans les mêmes systèmes, ce qu'on fait ne servira à rien. » L’eau est le premier de tous les miroirs, elle nous renvoie au visage nos contradictions, a écrit Erik Orsenna, que cite Bélaïde Bedreddine. L’eau va partout, quand on tire la chasse, ou lorsqu’on la guide, tombant du ciel, vers une zone humide plutôt qu’un tuyau, on accélère simplement sa transition vers la mer. La pollution que l’on s’évite ici nous arrivera de toutes façons de là-bas. Les rencontres techniques de la Seine-Saint-Denis se sont placées au milieu de l’Atlantique, entre Bobigny et Haïti.



